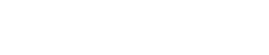- Ouishare, 2016
- Oushare, 2016
En 1844, un groupe de tisserands de Rochdale, à côté de Manchester, créent la 1ère coopérative de denrées alimentaires.
Trois ans plus tard, Frederick Raiffeisen, bourgmestre d’une petite ville de Weyerbusch en Allemagne, constatant la crise alimentaire dans laquelle se débattent ses concitoyens et leur impossibilité à accéder au crédit, crée la première boulangerie coopérative, puis mettra en place quelques années plus tard la première caisse de crédit mutualiste, où les prêts sont rendus possible grâce à une logique de solidarité entre les sociétaires.
C’est ainsi que le milieu du XIXe siècle accouche en plein révolution industrielle de ce qu’on appellera en France l’économie sociale, puis l’économie sociale et solidaire (l’ESS). Une économie, qui regroupe les coopératives, les mutuelles, les associations et les fondations.
Le trait commun de tous ces acteurs, et des penseurs qui ont conceptualisé cette économie sociale comme Robert Owen, Proudhon ou Charles Gide, c’est d’une part d’avoir voulu changer le capitalisme de l’intérieur, sans remettre en cause l’économie de marché, et d’autre part, d’être parti de la question du contrôle des moyens de production, de leur gouvernance. Mais contrairement à la pensée marxiste contemporaine, au lieu d’aspirer à une centralisation du contrôle de la production entres les mains de l’État, ils ont imaginé des modèles décentralisés, où le pouvoir est distribué – entre les salariés dans une coopérative, entre les bénévoles dans une association, entre les mutualistes pour une mutuelle.
Un siècle et demi plus tard, le début du 21ème siècle, en pleine révolution numérique, accouche de ce qu’on appelle l’économie collaborative. Comme l’ESS, les acteurs et promoteurs de l’économie collaborative entendent transformer le capitalisme de l’intérieur. Comme l’ESS, ils imaginent, cette fois-ci en s’appuyant sur des technologies numériques, penser sur un modèle décentralisé, distribué. Mais à l’inverse de l’ESS, l’économie collaborative ne s’intéresse pas tant aux moyens de production et à leur gouvernance, mais à la consommation et sa refondation. Après 50 ans de société de consommation, et en pleine transition écologique, leur horizon utopique n’est pas tant de produire pour tous, mais de consommer mieux. Mieux, c’est-à-dire plus humainement, plus écologiquement, plus frugalement.
En 2016, où en sommes-nous ?
L’ESS est à la fois un succès et un échec. Un succès car elle a survécu aux tribulations de l’histoire, à l’écroulement des économies administrées et là où elle agit, permet parfois – mais pas toujours, ne faisons pas d’angélisme – de porter une économie plus humaine, plus juste ; c’est aussi partiellement un échec, car elle occupe un poids finalement relativement marginal dans l’économie contemporaine.
L’économie collaborative, encore toute jeune, est également un succès et un échec pour les raisons exactement inverses. Un succès car elle pèse d’un poids économique qui ne cesse de croître et dérange les acteurs économiques historiques, et parce qu’elle invente des services qui simplifient nos vies quotidiennes. Un échec, car sa valeur ajoutée sociale en termes de transformation des modes de consommation reste marginale. Un échec car elle se fait avaler progressivement par un certain capitalisme radical, le capitalisme informationnel, qui au lieu de construire un monde distribué, horizontal conforme aux visions des pères fondateurs des technologies numériques des années 1980, fait pousser des monopoles planétaires.
L’une comme l’autre échouent à transformer un capitalisme qui plus que jamais nous emmène à dévorer notre écosystème et plonge des pans entiers de population dans la pauvreté, la précarité et la désespérance.
Alors, faut-il attendre encore 150 ans pour la prochaine tentative, laisser l’ESS vaquer aux marges et l’économie collaborative rejoindre la partie la plus prédatrice du capitalisme ? Et continuer de rêver d’un autre monde sans le faire ?
Bien évidemment vous tous qui êtes là, vous témoignez du refus de l’attentisme et de la résignation, d’une envie de faire bouger les lignes, sinon vous ne seriez pas à la OuiShare Fest.
Mais aujourd’hui nous avons besoin d’audace. L’audace de penser en dehors des cadres conceptuels habituels. Nous sommes depuis 2 siècles enfermés dans une pensée binaire, construite autour du marché et de l’État, comme si rien d’autre ne pouvait exister. Et la seule liberté que nous nous autorisons consiste à faire bouger le curseur un peu plus vers le marché ou vers l’État selon que l’on penche à droite ou à gauche. Aujourd’hui, nous pouvons avec le mouvement des communs, faire reconnaitre une troisième voie, une voie qui existe déjà depuis toujours dans les pratiques mais qui vit dans l’ombre du marché et de l’État, entre oubli et négation.
Que sont ces communs ?
Ce sont des communautés, petites ou grandes, à l’échelle d’un quartier ou de la planète, qui s’organisent sur un mode ascendant pour apporter des réponses aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, du partage des connaissances au développement durable, de la sécurité alimentaire à la réinvention de la monnaie. Certaines existent depuis des siècles – les communautés paysannes qui gèrent en commun le système d’irrigation des rizières en Asie, celles qui organisent les pâtures selon des règles coutumières en Afrique, les communautés de chercheurs qui partagent leurs savoirs. D’autres sont fraichement écloses comme les communautés du logiciel libre, de l’open hardware, celles qui alimentent en données OpenStreet Map ou OpenFoodFact, celles qui construisent des monnaies locale ou qui cultivent des jardins partagés, ou encore celles des enseignants qui partagent leurs ressources éducatives libres…
Les communs vous en connaissez tous et il est probable que vous y contribuiez d’une manière ou d’une autre. Quand vous corrigez un article sur Wikipedia, quand vous troquez des semences avec des amis, quand vous vous organisez avec vos voisins pour emmener les enfants à l’école à tour de rôle, quand vous publiez en ligne un article en Creative commons, vous contribuez aux communs.
Tout en étant les vecteurs d’une innovation sociale impatiente, d’un encouragement à l’action poussé par la dynamique d’un collectif, ces communautés construisent un autre rapport à la propriété des ressources dont elles ont la gestion, qu’il s’agisse d’un code logiciel, de l’ADN d’une plante ou d’une base de données ouvertes, une propriété partagée, construite autour d’un bouquet de droits d’usages plutôt que sur une propriété exclusive. Une approche qui rend au partage la plénitude de sens qui a souvent été détourné, appauvri dans la « sharing economy ».
Aujourd’hui les pratiques des communs connaissent un nouvel élan porté à la fois par les constats d’échec du politique et par le numérique. Côté constat d’échec, je n’ai pas besoin de vous faire un long dessin : de l’incapacité à construire la transition climatique à l’épuisement de la démocratie représentative et à son invasion par l’extrême droite dans tant de pays européens, de l’accroissement des inégalités à l’incapacité d’accueillir sur nos territoires les peuples en souffrance extrême… les constats sont sans fin.
Mais les communs sortent de l’ombre et se développent aussi portés par le numérique.
Pourquoi ? D’abord parce qu’ils renouent avec l’utopie originelle des technologies numériques, celle d’une information libre de circuler, celle d’un espace contributif ouvert, celle d’une forme d’empowerment, d’un gain en capacité d’agir individuellement et collectivement rendu possible par la technologie. Une utopie dont on voit la trace inscrite au cœur même du Web et de son fonctionnement : parce qu’il s’appuie sur des protocoles ouverts, parce que le principe de neutralité préside à la circulation de l’information dans les réseaux, internet est un commun « by design ». Ensuite parce que le numérique permet de construire des communautés déterritorialisées : les pratiques d’échanges et d’auto organisation ne sont plus limitées aux voisinages, soudées aux territoires, elles peuvent s’en évader et se construire dans la multiculturalité, c’est le bon côté de la mondialisation. Enfin, parce que le numérique en dissociant les informations de leur support physique, le morceau de musique du disque, le livre du papier, en permettant de se les échanger sans s’en séparer, en fait des candidats à la circulation et au partage.
Mais le numérique n’est pas intrinsèquement vertueux, gardons-nous de tout déterminisme. Ce n’est pas parce qu’ils peuvent s’appuyer sur le numérique que les communs peuvent apporter les réponses dont nous avons besoin, mais par la force des communautés qui construisent ces communs et par leur capacité à inventer de nouvelles formes de gouvernance que les communs peuvent être porteurs d’alternatives.
Pour ne plus être dans l’ombre du marché et de la puissance publique, ces pratiques ont aujourd’hui besoin de se solidifier, de faire preuve d’une créativité institutionnelle au moins aussi importante que celle qui a permis d’inventer les coopératives ou les mutuelles il y a 150 ans, mais aussi d’une créativité financière, pour sortir du joug de financeurs qui ne rêvent pas d’un autre monde.
Elles peuvent également utilement croiser avec les pratiques de l’ESS comme avec celles de certains acteurs de l’économie collaborative, sans s’y dissoudre.
Pour finir je dirais que les communs ne sont certainement pas l’alpha et l’omega, la réponse à tout. Les communs ne lutteront pas contre Daech, ne porteront pas à eux seuls la transition énergétique.
Mais ils peuvent agir à côté du marché et de l’action publique, parfois en synergie avec eux, parfois en résistances à ces derniers, pour qu’il fasse bon vivre sur cette planète pour le plus grand nombre.