La bataille de la communication en Tunisie, un enjeu de pouvoir
Répéter que la liberté de communiquer est la clé de la démocratisation de la société peut paraître banal. Mais il arrive que les évidences gardent leur pertinence malgré l’érosion des mots. L’expérience tunisienne confirme cette vérité. En 56, au lendemain de l’indépendance du colonialisme français, le nouvel Etat indépendant avait un bon prétexte pour légitimer le recul de la liberté d’expression - qui était, il faut le reconnaître, plus développée sous le protectorat français- : la construction du nouvel Etat national ne souffre pas de dissidence et l’établissement de son autorité s’accommode davantage de l’unanimisme. C’est ainsi qu’on a vu disparaître les quelques journaux qui avaient accompagné la résistance au colonialisme au profit de l’organe du parti Neo-Destourien. Monopole de l’espace public
On admettait alors sans difficulté le fait que la légitimité dont bénéficiait le Neo-Destour, principale coalition qui a conduit le pays vers l’indépendance, l’autorisait à monopoliser l’espace public et interdire toute expression plurielle ; La Tunisie avait payé cher cette démarche. Toute la dynamique sociale et politique qui s’était développée durant la lutte nationale a été marginalisée, laissant place à une logique de pouvoir implacable. La machine de pouvoir qui s’était mise en place poursuivait une finalité propre, broyant tout ce qui s’opposait à elle, toute forme de contre pouvoir. Durant deux décennies, la société était sans voix ; seule s’élevait celle des étudiants qui remplissaient les prisons et servaient de gibier à la machine de torture. A la fin des années 70 - début 80, et sous la double pression du mouvement syndical et étudiant, l’édifice se fissure et Bourguiba, « le père de la nation » comme on l’appelait alors, pour reprendre une terminologie puisée dans le dictionnaire patriarcal, est contraint de concéder à la société quelques parcelles de libertés. Une ONG de droits de l’homme, la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH) est autorisée à exister et deux journaux indépendants sont autorisés à paraître (Errai et Le Phare), d’autres encore vont suivre. Ces concessions étaient fatidiques pour la structure autoritaire du régime. Ce sont ces journaux avec l’organe de la centrale syndicale Echaab, qui vont jouer un rôle déterminant dans la vie politique future et favoriser le développement de contre-pouvoirs. Ils vont constituer le creuset où une société civile autonome allait se déployer ; La société s’exprimait par le biais de ces journaux qui rendaient compte de cette nouvelle dynamique avec toute sa complexité et ses faux pas et favorisaient en retour son développement par un effet d’entraînement. De nombreuses associations professionnelles ou de droits civiques voyaient le jour, toutes n’avaient pas l’agrément des autorités mais parvenaient à se faire tolérer en s’imposant sur la scène publique, provoquant un effet d’entraînement vers de nouvelles initiatives. Durant les années 1980, la petite Tunisie cristallisait l’espoir d’un pluralisme possible pour un Maghreb fondu dans le béton du monolithisme politique. Elle voyait fleurir, durant cette décennie, une presse libre qui balisait la voie à une société civile dynamique et des contre-pouvoirs réels.
Le retour de manivelle
L’Algérie et le Maroc, regardaient en direction de cette petite Tunisie qui offrait l’exemple à ne pas suivre. Mais la contagion était irrépressible. Ils vont s’engouffrer à leur tour, quelques années plus tard, chacun à sa manière dans des expériences de pluralisme. Mais rien n’est jamais acquis définitivement. La Tunisie connaît une grande défaite après ce printemps civil et subit une régression historique. En 88, Ben Ali prend le pouvoir par un coup d’Etat « médical » et après deux ans d’Etat de grâce, il opère un brutal revirement politique en 90, déployant une terreur policière inédite, prenant pour prétexte la lutte anti islamiste. Amnesty International avait recensé à cette époque plus de 10 000 citoyens (sur 9 millions d’habitants) qui ont été arrêtés et torturés, nombre d’entre eux sont morts sous la torture. Là encore c’est par le biais des medias que la mise au pas de la société s’enclenche. Le premier acte de ce coup de force a été donc le bâillonnement de la presse. Profitant de la première guerre du Golfe, il élimine tous les medias libres et place sous contrôle la presse privée. Usant de procédés nouveaux, puisant dans un nouveau registre répressif : Monopole d’Etat des ressources publicitaires et sanction des récalcitrants. Saisies répétées en imprimerie des journaux d’opposition qui finissent par couler financièrement. On tue proprement, sans faire couler le sang. On disait à l’époque, en Algérie on tue les journalistes, en Tunisie, on tue le journalisme. Durant toute cette période aucun journal n’a été suspendu suite à une mesure administrative. Le gouvernement s’appliquait à ne prendre aucune mesure répressive qu’on pouvait mettre à son compte. Pourtant il réussissait une désertification de l’espace médiatique sans frais. Avec les journaux, tous les journalistes indépendants ont été évacués de cet espace médiatique, s’exilant vers d’autres professions ou d’autres terres plus clémentes. Ceux qui résistaient se retrouvaient en prison pour des prétextes divers. Au même moment où la presse était réduite au silence, de nombreux titres « privés » envahissaient les kiosques, véritable presse de caniveau et organes de désinformation (El Hadeth, El Iilan, El Moulahedh, Achourouq, Assarih...) chargés de diffamer et de porter atteinte, en toute impunité, à l’honneur des opposants et des défenseurs de droit humains. Tous sont financés par les caisses noires du ministère de l’intérieur et sont dirigés par des agents du ministère de l’intérieur devenus « journalistes ». Un arsenal de nouveaux textes de lois est venu couvrir d’un voile de légalité cet arbitraire. Après le code de la poste promulgué en 98 qui autorise l’administration postale à confisquer tout courrier postal ou électronique pour « trouble à l’ordre public », un nouveau Code des communications entrait en vigueur en 2001. Ce code organise les normes de cession des concessions de communication, jusqu’ici monopole d’état, aux privés, et place en passant toute activité d’émission, de réception ou d’exploitation de tout matériel de communication, sous contrôle des Ministres de la défense et de l’intérieur (art 52 et 56). Une « Agence nationale des fréquences » est crée, ainsi qu’un « Conseil national des communications ». Désormais l’exploitation d’une radio libre sans autorisation de l’Agence est passible d’une peine de cinq ans de prison ferme (art 82). Alors que jusqu’ici les radios n’étaient pas soumises à autorisation préalable. Est punie de la même peine toute personne qui se connecte à un réseau satellitaire (pour tout usage, même téléphonique par exemple) sans avoir reçu l’agrément de l’Agence (art 82). Plusieurs demandes d’agréments de radios libres ont été déposées auparavant, aucune n’a reçu l’autorisation d’émettre, et ceci en flagrante violation de la loi qui était libérale avant la promulgation de ce code. La presse libre réduite au silence, la terreur policière pouvait se dérouler sur la société civile et l’écraser. Les partis politiques d’opposition avaient démissionné de leur rôle et la résistance se limitait à un carré de défenseurs de droits humains. Les droits des femmes, héritage de la période bourguibienne, se sont mués en un « féminisme d’État », dont le corollaire est la confiscation de sa citoyenneté. Il a fallu attendre la fin des années 1990 et le début des années 2000 pour que la société civile renaisse de ses cendres et commence à faire face à la dérive autoritaire du régime. Après ces longues années où la terreur avait gelé toute initiative de la société civile, enfermée dans la loi du silence, celle-ci s’éveillait, dénonçait les violations systématiques commises au nom des « impératifs de stabilité » et de « lutte contre l’islamisme » et revendiquait ses droits fondamentaux.
Internet, voie privilégiée pour contourner la censure
C’est ainsi que la première association autonome de droits humains, le Conseil national des libertés (CNLT) voyait le jour en 1998, au moment où la LTDH était mise au pas par le pouvoir et ne jouait plus son rôle en tant qu’association en charge des droits humains Elle s’en relèvera au congrès de 2000 suite au mouvement de désobéissance civile déclenché par le CNLT. Dans le sillage d’autres ONG naissent et travaillent sans recevoir le visa légal ; Il faut souligner que depuis 1989, aucune ONG autonome n’a reçu de visa légal alors que les autorités se prévalent d’avoir 8444 ONG ! Le CNLT que les autorités refusent de reconnaître à nos jours , défiait l’interdit et se posait en observatoire de l’état des libertés. Ses premiers rapports qui mettaient au jour les violations graves et systématiques des droits humains ont déstabilisé le pouvoir. Utilisant Internet comme fenêtre pour braver l’interdiction de communiquer ; pour la première fois en Tunisie une ONG autonome créait son site web , disposant ainsi d’une grande visibilité internationale. Cette opportunité de communiquer par Internet malgré le verrouillage a été une grande chance pour le CNLT qui pouvait de ce fait se protéger contre la répression. Le régime de Ben Ali se présente comme un régime démocratique et évite de brouiller son image par des actes de répression classiques et flagrants, recourant à des procédés plus sophistiqués pour neutraliser ses dissidents, comme la surveillance policière collante, la coupure de leurs moyens de communication (Tél, fax, Internet) et le tarissement de leurs ressources en leur interdisant de travailler.
Après le 11/9 Le prétexte de la lutte contre le cyber terrorisme
Les attentats du 11 septembre seront une aubaine pour Ben Ali qui voit se légitimer à l’échelle internationale sa politique du « tout-sécuritaire ». Le mot « terrorisme » se déploie désormais comme une arme fatale pour réduire au silence toute voix dissidente. L’été 2002, la machine s’emballe et pas moins de huit procès politiques se succédent en moins d’un mois, avec la chasse aux « cyberterroristes ». Le procès le plus emblématique de ce tournant a été sans conteste celui du jeune Zouhayer Yahyaoui, un animateur d’un site Web dissident, TuneZine, qui a été condamné à deux ans de prison ferme en juin 2002. Et l’année 2004 a vu une série des procès d’autres jeunes internautes, notamment ceux de Zarzis et de l’Ariana, accusés de « terrorisme » pour avoir navigué sur le Net et condamnés à treize ans et seize ans de prison ferme. Pour les défenseurs de droits humains, cette lutte « antiterroriste » s’est traduite par une offensive tous azimuts et un recul des maigres acquis qu’ils avaient arrachés les années précédentes. La surveillance policière s’est renforcée. Ce sont presque des commissariats qui sont désormais placés devant leurs domiciles, contrôlant et intimidant les visiteurs. L’écoute téléphonique est quasi systématique et touche presque tout le monde, y compris les taxiphones publics. Les fax sont souvent détournés de leurs destinations au profit de la police politique. La police de l’information se prévaut de disposer d’un matériel sophistiqué lui permettant de mettre sur écoute toutes les lignes téléphoniques de la Tunisie et d’enregistrer durant sept jours d’affilée toutes les communications arrivant et partant de la Tunisie ! La liberté de circulation à l’intérieur du territoire est soumise au bon vouloir de la police. Le passeport est une faveur. La correspondance ainsi que la messagerie électronique sont confisquées. Internet est sous haute surveillance. Il faut savoir qu’Internet est la principale fenêtre des Tunisiens dans ce contexte d’absence totale de liberté de presse et d’information. C’est par le Web que les Tunisiens s’informent sur ce qui se passe chez eux ; C’est là qu’ils découvrent la solidarité internationale ou le combat d’une poignée de dissidents qui osent défier la dictature. Face à ce nouvel espace incontrôlable, le régime a mis au point une nouvelle technique consistant à parasiter les sites dissidents émettant de l’étranger, par l’infiltration de « faux démocrates » en mission commandée, souvent sous le couvert de l’anonymat, plus virulents par leurs insultes vulgaires à l’attention du pouvoir, mais dont la fonction réelle est d’intoxiquer le milieu démocratique en exil, semer la zizanie et discréditer les opposants dans le but de montrer qu’il n’y a pas d’alternative à Ben Ali.
Les TIC, comme instruments de censure
De nouvelles technologies ont été acquises par la police de l’information pour rendre les sites « subversifs » de plus en plus inaccessibles, même avec les proxys. Et les publinets (cybercafés) sont étroitement surveillés par une cyberpolice vigilante : ceux qui rechignent à devenir des délateurs de leurs clients voient carrément leurs licences d’exploitation retirées. Ainsi, en 2003, un gérant de publinet à Zarzis, qui avait refusé d’interdire l’accès à Internet à des opposants, comme le journaliste Abdallah Zouari , s’est vu fermer son commerce pour... « absence d’accès aménagé pour les handicapés » ! Abdallah Zouari est un journaliste d’Al Fajr qui est actuellement en résidence surveillée à 500 km de sa famille ; Il est actuellement en grève de la faim pour réclamer le droit de vivre dans la même maison que sa femme et ses enfants qui résident à Tunis. Le régime autocratique tunisien s’applique à neutraliser toute forme de communication qui lui échappe ; Parcequ’il sait pertinemment que c’est par la communication que passe toute forme de contestation de son pouvoir absolu et que c’est par la communication que les contre pouvoirs s’organisent. Interdire la communication est le meilleur moyen de laminer tous les contre-pouvoirs, en déployant une stratégie d’étouffement, de marginalisation et de contrôle, qui rendent ces bourgeons démocratiques totalement inopérants. Les espaces où se déploie la résistance au contrôle étatique (justice, médias, partis politiques, associations) sont soumis à un véritable rouleau compresseur. Usant d’une batterie d’instruments répressifs sophistiqués, dont la principale est le tarissement des ressources et la punition collective qui fait du dissident un paria. Pourtant l’image d’une Tunisie démocratique, d’un « pays stable qui réussit » continue d’être servie par les instances internationales et se déploie comme un mur contre le combat d’une poignée de dissidents qui ont à faire la preuve en permanence, que leurs droits fondamentaux sont confisqués et que les citoyens tunisiens « méritent » comme les autres peuples leur liberté.
©© Vecam, article sous licence creative common
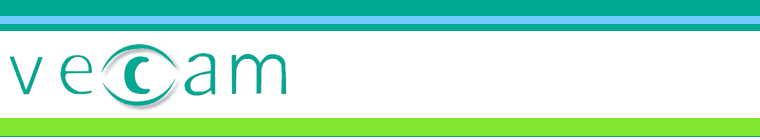

 Réflexion et propositions
Réflexion et propositions Contributions à débattre
Contributions à débattre Imprimer la page
Imprimer la page