Formes et dynamiques des accès publics à Internet en Afrique de l’Ouest : Vers une mondialisation paradoxale ?
Article extrait d’un ouvrage collectif "Technologies de la communication et mondialisation en Afrique" à paraître aux éditions Karthala en juillet 2004.
Un accès universel, ubiquitaire, équitable et financièrement abordable aux infrastructures et aux services TIC, constitue l’un des défis de la société de l’information et devrait être l’un des objectifs de tous ceux qui participent à son édification.
Extrait de la déclaration du Sommet mondial de la société de l’information, Genève 10-12 décembre 2003
Parmi les technologies de l’information et de la communication, Internet a tendance à occuper seul le devant de la scène alors qu’il fait appel à une technologie, l’ordinateur et les logiciels associés, qui est complexe, difficilement modifiable, relativement coûteuse, dépendante d’infrastructures de base (téléphone et énergie électrique) très inégalement réparties, qu’Internet est réservé aux lettrés, et diffuse le pire et le meilleur sans garantie de contrôle sur les sources. Et pourtant, avec de telles caractéristiques, le réseau a fait l’objet en Afrique d’un véritable engouement. Comment comprendre un tel paradoxe ? Effet de mode lié au mimétisme prôné par les médias et les projets ou besoins réels ?
Cet article, basé sur des recherches de terrain menées en Afrique de l’Ouest, plus particulièrement au Sénégal, au Mali et au Burkina Faso, se place du point du vue de l’offre de service. Il traite plus particulièrement des formes d’accès à Internet et de leur diffusion à l’échelle locale dans une démarche géographique qui croise deux éléments, la territorialité du phénomène et le jeu des acteurs concernés. Retrouver le lieu c’est mettre en avant la pluralité et la spécificité des formes locales des processus mondialisants, y associer les jeux d’acteurs c’est insister sur les composantes stratégiques de ces processus reflet de dynamiques homogénéisantes plus globales .
Selon que l’on se situe en Afrique et dans les Tiers Monde en général, ou en Europe et dans le monde occidental, la question de l’accès aux NTIC se pose de façon très différente. Pour certains pionniers de l’Internet aux Etats-Unis, le modèle d’une société de l’information idéale serait celui de l’internaute en communication virtuelle avec le monde entier mais sans communication physique avec ses semblables, restant chez lui devant son ordinateur (le pire des mondes étant de respirer le même air que les autres , le lieu est alors gommé indifférencié. L’accès et l’usage individuels dominent dans les pays « développés » tandis que l’accès public est très minoritaire sauf dans des quartiers peuplés d’immigrés fonctionnant sur le modèle du Sud comme le montre plus loin Claire Scopsi à Paris. En Afrique par contre, dans ce que Olivier Dolffus appelle, « les mailles interstitielles du système monde » , l’appropriation des NTIC se fait à l’inverse du modèle dominant occidental ; le mode d’accès aux outils de communication est essentiellement collectif étant donné le faible niveau de vie moyen des populations comparé au coût du matériel et de la communication elle-même. Mais outre le facteur économique deux autres facteurs entrent en jeu pour déterminer les formes que prend l’accès ; la distance au centre, en relation avec le niveau de connexion aux réseaux matériels, et le type d’acteurs, public, privé ou associatif qui gère les espaces.
Pour développer les possibilités d’accès à Internet, des actions volontaristes sont mises en oeuvre par la « société civile », la plupart sous l’impulsion d’interlocuteurs occidentaux. Elles se focalisent sur les accès communautaires et associatifs conformément à l’idéologie occidentale de « réduction de la pauvreté », devenu le prêt-à-porter d’aujourd’hui pour le développement. L’analyse révèle une distorsion entre le volontarisme de projet et la réalité du fonctionnement socio-économique des pays ; Internet commence à se diffuser à l’intérieur des territoires dans des catégories sociales de plus en plus diversifiées mais selon un mode tout à fait spécifique, l’accès collectif privé.
Un tissu de petites entreprises privées s’est créé en priorité dans les grandes villes tandis que les accès communautaires ou associatifs peu nombreux ont tendance à être relégués dans les espaces périphériques des mégalopoles et dans les villes secondaires. Un autre caractère particulier de l’appropriation des outils de communication en Afrique, la prédominance du marché de l’occasion, a aussi un impact sur le tissu urbain. L’approvisionnement en ordinateurs et en téléphones importés avec leurs accessoires induit la multiplication d’espaces de vente spécifiques dans des lieux stratégiques. Ainsi, loin de s’affranchir du territoire, les lieux dédiés aux NTIC deviennent les nouveaux marqueurs du paysage urbain et peuvent même induire des recompositions socio-spatiales inédites remettant en cause le modèle de la « ville ».
D’un point de vue économique, aujourd’hui après quelques années de croissance, ces modes d’accès se perpétuent avec beaucoup de difficultés. L’accès public en Afrique connaît une crise reflétant à la fois les contraintes locales et les enjeux plus globaux liés à la connexion des pays et à la rentabilité de l’activité.
L’accès : un problème persistant
La question de l’accès universel très loin d’être réglée ne mobilise pas vraiment les bailleurs de fonds comme l’ont montré les débats préparatoires au SMSI, même si on a pu lire dans le premier projet de résolution élaboré par le bureau de la société civile que tous les villages devraient être équipés en 2005 ce qui relevait davantage de la méthode Coué que du réalisme. L’accès reste le problème essentiel concernant les TIC pour les pays Africains même si les situations nationales sont extrêmement variées. Le besoin de communiquer à distance existe partout bien qu’il fasse appel à des outils différents selon les lieux. La « fracture numérique » est d’abord géographique, elle se retrouve à toutes les échelles et se calque sur les disparités existantes. Quelques points de repères permettent de situer l’ampleur du problème et la diversité des situations selon les échelles.
A l’échelle planétaire, l’Afrique apparaît toujours insignifiante et l’écart se creuse avec les autres continents. La croissance moyenne du nombre des internautes dans le monde en 2000 était de 43% contre 40% en Afrique soit deux fois moins que celle du nombre des abonnés au téléphone mobile. Une forte demande existe mais elle se heurte au manque d’infrastructures téléphoniques et à leur inégale répartition ce qui se traduit par le fait que le taux de branchements au web soit le plus fort au monde par rapport au nombre d’abonnés au téléphone. Selon les données de l’Union Internationale des télécommunications (UIT), Internet est présent dans tous les pays mais sa progression se ralentit, elle est passée de 33,48 % de 2000 à 2001 et à 14,6% de 2001 à 2002. On estimait à 4,51 millions le nombre d’internautes en 2000, 6,78 en 2001, 7,94 en 2002 sur 592 millions pour l’ensemble du monde.
A l’échelle continentale la part de l’Afrique du sud a diminué mais reste prépondérante : 39 % des internautes sont en Afrique du Sud, 16% en Afrique du nord et 29% au sud du Sahara.
A l’échelle nationale, le continent n’a pas échappé au bouleversement mondial des télécommunications avec le démantèlement des opérateurs historiques, l’ouverture de leur capital et la libéralisation des secteurs rentables, Internet et téléphonie mobile. Des grandes manœuvres en cours résulte une insertion très inégale des NTIC selon les pays. L’accès et l’usage d’Internet épousent en Afrique comme ailleurs les lignes de clivage socio-territoriales dans des configurations caractérisées par une extrême hétérogénéité reflet du "mal développement". Internet est d’abord l’apanage des centres villes des capitales et de leurs élites mieux connectés aux centres mondiaux qu’à leur propre hinterland, mais de nouveaux territoires en réseaux se renforcent ou se dessinent. C’est le cas au Sénégal qui dispose d’un réel maillage du territoire en lignes téléphoniques de qualité et où Internet est potentiellement utilisable jusque dans des espaces périphériques comme la région du Fleuve. L’Afrique du Sud blanche et riche s’arrime au nord et à l’Asie et le pays polarise sa région tandis qu’à l’intérieur les clivages ethniques demeurent. Le Gabon est le type même d’un territoire lacunaire où seuls trois pôles urbains connectés émergent. En Guinée les carences de l’Etat induisent une multiplication des connexions indépendantes non contrôlées. Les pays les mieux connectés sont les petits pays, îles touristiques et riches où le maillage est plus facile, Seychelles, Maurice mais aussi le Cap vert et la Gambie. Dans un pays pauvre vaste et hétérogène comme le Mali le rêve de son ex Président en 2000, de connecter les 703 nouvelles communes s’est avéré illusoire jusque là. Mais la situation des infrastructures évolue rapidement ce qui peut changer la donne. Pour des pays enclavés comme le Mali et le Burkina Faso l’installation de réseaux à fibres optique à partir du nouveau câble côtier Sat3 et la création d’un réseau de satellites africain (RASCOM) vont offrir des possibilités considérables d’amélioration de la connexion même si la présence d’infrastructures est une condition nécessaire mais pas suffisante pour développer les usages. Au niveau local, nous avions constaté en 1998 à propos du Sénégal, que les formes de communications variaient considérablement selon les échelles spatiales et sociales, imbriquant outils anciens et nouveaux selon des modes avant tout pragmatiques : de l’absence totale de téléphone que remplaçait la simple parole donnée sur un grand marché frontalier du Sud, à une entreprise de télétravail de Dakar Plateau, les univers de la communication étaient très diversifiés. Qu’en est il cinq ans après, la situation a-t-elle fondamentalement changé avec la diffusion des NTIC au Sénégal et ailleurs en Afrique de l’Ouest ?
I - Un phénomène urbain
En Afrique encore plus qu’ailleurs étant donné les lacunes des réseaux d’infrastructure, l’usage des nouvelles technologies est un phénomène urbain. Loin d’être déterritorialisé, il dessine une « géographie ultra sélective » , en créant de nouveaux modes d’occupation de l’espace, des lieux bien identifiés qui partout témoignent d’une adaptation aux pratiques sociales de populations pauvres et donc à une économie informelle qui domine largement. Mais l’ampleur de ces recompositions diffère selon les pays et selon les villes en fonction de leur importance démographique, de leur poids économique, de leur situation géopolitique et aussi des formes de développement des infrastructures et de déréglementation en cours dans le secteur. Le développement d’Internet est très lié à la structure urbaine elle même. « Une ville polycentrée comme Accra, très étendue et dont les quartiers sont séparés les uns des autres n’implique pas la même configuration territoriale en terme d’implantation des fournisseurs d’accès, des télécentres, des infrastructures qu’une petite ville comme Lomé. Le centre ville de Lomé fourmille de télécentres, ils sont visibles et très accessibles. Plus on s’éloigne du centre moins il y en a. A Accra, on peut parcourir des kilomètres sans la moindre trace visible d’un cybercentre (il faut savoir où ils se trouvent car on tombe rarement sur eux par hasard, sauf peut-être les télé-boutiques Africa On Line et la publicité est pratiquement inexistante), mais leur dispersion accroît leur proximité pour un plus grand nombre d’habitants. De manière générale à Cotonou aujourd’hui (comme à Bamako par exemple) ce n’est pas le câblage qui va aux opérateurs mais les opérateurs qui doivent s’implanter sur le tracé des liaisons existantes. Lorsqu’une législation souple permet de s’affranchir de cette contrainte spatiale, il est possible de disposer d’une station terrestre de liaison satellite, sinon l’implantation des entreprises se fait selon des règles strictement techniques, qui ne sont pas forcément adaptées ni aux besoins commerciaux ni à un développement territorialement équilibré de l’accès internet. » (Eric Bernard)
I-1 Dans les plus grandes ville
Des accès privés de divers types
Dans les milieux privilégiés des plus grandes villes, Internet est un outil extraordinaire d’ouverture et de participation au savoir mondial par les informations de toutes natures qui s’y trouvent. Les entreprises multinationales, les organismes liés à l’international sont branchés, au moyen de réseaux particuliers sécurisés, paraboles VSAT, réseaux privés comme au Gabon, et sont à l’abri des aléas du contexte commun, (coupures d’électricités, insuffisance de la bande passante).
Dans le secteur moderne des économies, l’informatisation des entreprises progresse, mais deux pays seulement se seraient lancés dans les téléservices, le Ghana et le Sénégal qui dispose d’un réseau performant et peut ainsi profiter après la Tunisie et le Maroc de délocalisations de services d’entreprises françaises à forte intensité de main d’œuvre grâce à la baisse des coûts de télécommunications et à leur passage par le réseau IP. Dakar compte moins d’une dizaine de ces entreprises . Exemple même de la mondialisation, la société anglaise Premium concept center international (PCCI), qui fait du télémarketing uniquement pour des sociétés françaises, dispose au Sénégal depuis avril 2002 d’une plateforme de 300 postes de travail et compte aller progressivement jusqu’à 3000 postes. Pour être recruté il faut un niveau minimum bac plus 2, un accent neutre et se présenter sous un nom bien français. Les jeunes femmes employées gagnent 180 euros de salaire de base mais peuvent atteindre plus du double grâce à des primes. Ce genre d’emploi peu valorisant en France est perçu à Dakar comme un métier de haute technologie qui procure une reconnaissance sociale. Un autre exemple est celui de la Sénégalaise de saisie informatique (SESI) qui comptait en janvier 2002 quarante opérateurs et dix ingénieurs qui numérisent, indexent, mettent en page et corrigent des articles scientifiques en français et en anglais pour des éditeurs européens pour des salaires allant de 183 à 762 euros.
Ce type de service délocalisé n’apporte rien à la population en dehors des revenus distribués et les espoirs mis dans les téléservices de proximité au Sénégal ont été déçus mis à part quelques exemples comme la pesée des bébés à Saint Louis qui permet le suivi de la santé d’enfants tant que le projet est subventionné par une ONG française Afrique initiative.
Mais pour qui ne dispose pas d’un accès au bureau le recours à des accès publics est la solution la plus commune car rares sont les personnes y compris les universitaires qui ont les moyens de s’offrir un ordinateur personnel ses accessoires et le coût de la connexion, un budget qui se situe entre trois à sept fois selon les pays le PIB annuel par habitant. Les coûts élevés incitent donc à créer des accès publics ; les télé-cybercentres (accès à la fois au téléphone et à Internet, les cybercentres, (accès uniqument à Internet) , se sont multipliés pour proposer la navigation et surtout l’accès à la messagerie électronique principal usage d’Internet en Afrique où l’adresse électronique n’est pas un luxe mais un moyen efficace et peu coûteux pour joindre parents amis et clients ; on considère qu’une même adresse peut servir pour cinq à dix personnes.
Le développement des cybercentres privés concerne avant tout les capitales. Dans les centres villes des capitales, centres d’affaire de Dakar ou d’Abidjan ou de Libreville se trouvent les cybercentres « high tech » fréquentés surtout par les touristes, les étrangers, les hommes d’affaire, les étudiants. Dans les zones résidentielles périphériques de la classe moyenne se situent plutôt de petits établissements mixtes donnant accès à la fois au téléphone et à Internet. Plus on va vers les quartiers pauvres, plus les cybercentres privés se raréfient, quelques accès communautaires associatifs les remplacent. L’exemple du quartier d’affaire de Dakar est caractéristique d’une répartition d’établissements modernes, tandis qu’à Ouagadougou ce sont les petites boutiques qui dominent.
Au centre de Dakar une rude concurrence
Le Sénégal comptait 184 cybercentres en juin 2001 et à peine 100 un an auparavant, soit une progression de 84% et Dakar représentait 60% du total pour un quart de la population ce qui correspond à la polarisation des activités économiques modernes sur la capitale. Dans la ville elle-même les disparités sont fortes . Le « Plateau », centre d’affaires comptait 18% des cybercentres en 2002, contre 14% pour Pikine, le vaste quartier populaire avec plus de la moitié de la population.
Sur le Plateau le nombre de cyber centres s’est considérablement accru depuis l’ouverture du premier en 1996 (le Métissacana) et ils ont changé de nature. De 1997 à 1999 outre le Metissacana on trouvait un accès Internet dans quelques boutiques faisant télécentres avec un ou deux ordinateurs, - un système qui a quasiment disparu du centre ville -, et deux centres modernes, le business center ouvert en 1997 qui appartient à un groupe sénégalais avec 21 postes, puis en 1998, le télécentre de la société nationale des télécommunications, (SONATEL), Telecom Plus a ouvert une salle informatique avec 8 machines. Aujourd’hui après une période d’euphorie en 2000 et début 2001, on décèle une pause car la concurrence est rude. L’hyper centre, comptait 13 cybercentres en juillet 2001, dont douze concentrés sur un périmètre d’environ un km2 autour de la rue commerçante principale, la rue Ponty. Deux avaient disparu en mai 2003 de cette rue Ponty dont l’un détruit en même temps que l’immeuble et le café bien connu qui l’abritait. Un peu plus loin dans une rue adjacente, s‘était installé face à un hôtel, un nouveau petit télécentre/cyber.
Ces espaces sont de deux grands types :
- six cyber purs, c’est-à-dire ne proposant pas d’autres services que la connexion à Internet (et une éventuelle formation à l’outil), que l’on peut répartir en trois sous-groupes en fonction du nombre d’ordinateurs connectés : quatre ont entre neuf et treize postes, trois entre 20 et 21.
![]() cinq télécentres/cyber, qui proposent donc deux services : l’utilisation d’un poste téléphonique et la connexion à Internet (services auxquels il faut parfois ajouter l’utilisation d’un fax, la possibilité de faire des photocopies, un service de dactylographie). Le critère du nombre de postes occupés n’est pas vraiment opératoire, puisque les quatre premiers (Telecom Plus, le cyber café Albert Sarrault et Ecotel) possèdent respectivement 8, 9 et 13 postes connectés. Ce qui les caractérise plutôt est l’aspect moderne voire « high tech » avec climatisation, matériel récent, chaises confortables.
cinq télécentres/cyber, qui proposent donc deux services : l’utilisation d’un poste téléphonique et la connexion à Internet (services auxquels il faut parfois ajouter l’utilisation d’un fax, la possibilité de faire des photocopies, un service de dactylographie). Le critère du nombre de postes occupés n’est pas vraiment opératoire, puisque les quatre premiers (Telecom Plus, le cyber café Albert Sarrault et Ecotel) possèdent respectivement 8, 9 et 13 postes connectés. Ce qui les caractérise plutôt est l’aspect moderne voire « high tech » avec climatisation, matériel récent, chaises confortables.
Le cybercentre du mythique Metisacana premier cyber café d’Afrique de l’Ouest créé par la styliste Oumou Sy , a fermé en juin 2002. Le cyber café était partie intégrante d’un lieu polyvalent conjuguant bar, restaurant, salle de spectacle et d’exposition, cinéma en plein air à l’occasion, situé dans un cadre agréable, plein de verdure et dont le calme contraste avec l’activité du quartier du marché de Sandaga qui l’entoure. C’est surtout un lieu culturel et artistique très important dans la vie dakaroise où chaque année se tient le Simod, festival de mode très apprécié et très médiatisé, qui connaît un succès grandissant. On assiste alors à des défilés de haute couture auxquels participent des stylistes africains et étrangers. De manière plus large, le Métissacana est considéré comme un point de rencontre des artistes et des personnalités de Dakar. Il est fréquenté par les Sénégalais - hommes d’affaires, étudiants, représentants d’ONG, etc -comme par les étrangers. C’est ce qui lui permet de rester un lieu quasi incontournable, car le cyber café en lui-même est une pièce peu agréable, exigü, un peu sombre et mal aérée.
Le Métissacana fut le précurseur de l’Internet au Sénégal et en Afrique de l’Ouest plus largement. Il a ouvert en 1996 et comptait 200 clients début 1997 avec 1300 connexions payantes par mois, 35000 au total en 20 mois (avril 1998). Il offrait toute la gamme de services associés à la messagerie électronique et au web. En tant que FAI, le Métissacana comptait en 1999 700 abonnés dont 80% de Sénégalais venant pour les besoins d’entreprises privées. Depuis son ouverture, il organisait des animations et des démonstrations publiques d’Internet dans les grandes villes du pays et dans les établissements scolaires et universitaires, et fut le centre d’un projet d’ouverture de 30 télécentres communautaires multimédia dans les principales villes du pays. Le Métissacana possèdait neuf PC 43, très âgés, en mauvais état. Le parc informatique avait besoin d’être renouvelé, car l’accès à Internet y était trop lent, des inconvénients qui l’ont handicapé par rapport à la seconde génération de cyber centres ouverts surtout en 2000, les cyber high tech de sociétés solides. Aujourd’hui sur les 13 cybercentres , huit appartiennent à de grands groupes privés et quatre seulement à des particuliers. Quatre centres sont aussi fournisseurs d’accès avec des formules de connexion variées. L’heure de connexion était de 1000 F CFA la plupart du temps,en juillet 2001, 800 F CFA pour Ecotel. Télécom Plus, Place de l’Indépendance, et NTIC Center, avaient les tarifs les plus bas sur le marché : 500 F CFA l’heure de connexion. Plusieurs formules d’abonnement existent.
Depuis 2001, les prix ont considérablement diminué en raison de l’élargissement de la bande passante et de la baisse des tarifs de la SONATEL. Rares sont les établissements qui proposent l’heure à plus de 500FCFA et 350F est un prix courant. En conséquence s’est produit une valse de créations puis de disparitions d’accès publics car la concurrence s’est exacerbée. En avril 2003 on constatait que, dans une grande avenue d’accès au centre, l’avenue Bourguiba, plusieurs télé-cybercentres avaient été remplacés par des boutiques tenues par des Chinois de Taiwan qui investissent ce quartier pour vendre toutes sortes d’objets à prix très bas. Par contre, on décèle désormais un enchassement de ces lieux dans les quartiers d’habitation ; dans les quartiers résidentiels de la classe moyenne, aménagés en SICAP dans les années soixante dix, le cyber télécentre fait désormais partie du paysage au même titre que la boutique et le kiosque à pain.
A Dakar il n’y a pas de problème concernant la qualité de la connexion si l’ordinateur est efficace et le débit assez large, le Sénégal disposant d’une très importante bande passante et des possibilités d’accès au coût de la communication locale dans l’ensemble du territoire. Pourtant 70% des accès se font par liaison classique RTC alors que Dakar monopolise 90% des liaisons à large bande. Au Mali par contre et au Burkina la qualité des liaisons pose problème et si en principe la connexion peut se faire au tarif local les fournisseurs d’accès hésitent à aller dans les centres secondaires. A Ouagadougou : la prolifération de micro entreprises
Selon Sylvestre Ouedraogo, l’un des pionniers de l’Internet au Burkina, les NTIC constituent des opportunités pour créer des toutes petites entreprises. Aujourd’hui, les cyber cafés sont devenus une affaire du secteur "informel" en Afrique et qui dit secteur informel dit réduction des coûts, innovation, créativité. « Quand je parle du secteur informel dans le domaine des NTIC, je veux parler des micro entreprises que l’on crée ici et là sans souvent disposer des compétences requises et avec du personnel formé sur le tas(et très mal payé). Ces micro entreprises poussent comme des champignons. Il faut toute une typologie pour les classer. On ne peut pas faire 500 m à Ouagadougou sans trouver un télécentre (accès téléphonique) et 1500m sans trouver un petit cyber café avec 2 à 3 postes connectés » . Les centres qui ne proposaient que l’accès à Internet ont des problèmes parce que le secteur informel casse les prix et récupère de l’argent dans d’autres services que les associations ne pratiquent pas : ventes de matériels... et même souvent dans des activités qui ne sont pas perceptibles par l’oeil extérieur : l’élevage par exemple. On ne peut même plus parler de prix élevé à l’Internet dans les grandes villes les prix se situant au dessous des coûts de production (nous avons par exemple en moyenne 2 euros par heure au Burkina et même souvent moins (1 euro et demi). Parler de projet d’accès communautaire dans les grandes villes n’est plus digne d’intérêt. Le secteur des petits accès comme les télécybercentres ainsi que la vente et la réparation des téléphones portables répondent à la forte demande de la population qui ne peut être satisfaite par l’Etat et les ONG et aussi, aux exigences de la clientèle qui ne correspondent pas avec celles des services étatiques ; le besoin d’accessibilité et de proximité...Une des raisons en est la faiblesse relative des coûts d’investissement de base pour entreprendre ces activités et la rapidité de gain que l’on peut obtenir avec de la chance. Ce secteur travaille dans la légalité et paie les taxes (pour ceux qui ont pignon sur rue notamment), il participe grandement au développement et arrive à satisfaire la population. (Sylvestre Ouedraogo).
Des accès communautaires minoritaires
Dans les plus grandes villes, des accès collectifs municipaux se sont mis en place sous l’impulsion de maires dynamiques. C’est le cas à Bamako et à Ouagadougou où la mairie a lancé depuis 1999 une série d’actions dans le domaine des nouvelles technologies. Cinq accès communautaires sont aujourd’hui fonctionnels à Ouagadougou et permettent à la population à revenus moyens d’avoir accès à la formation et à l’usage de la micro-informatique en général et à l’Internet en particulier. Cinquante deux ordinateurs équipent ces centres multimédias qui sont dotés en moyens techniques suffisants pour leurs activités. Ces centres sont répartis dans quatre des cinq arrondissements que compte la capitale et à terme, chaque arrondissement de la ville aura son centre multimédia. Seule la ville de Ouagadougou a bénéficié de ces infrastructures, la mairie de Bobo-Dioulasso par exemple n’en est pas pourvue. Un programme d’interconnexion entre les mairies existe afin d’automatiser certaines tâches. Au Bénin le gouvernement a mis en place en 2002, 21 télécentres communautaires offrant des services Internet, six à Cotonou, cinq à Parakou, 12 à Porto Novo, mais ces centres connaissent déjà de graves problèmes de durabilité et onze seulement étaient opérationnels en juillet 2003. Le système d’information urbain populaire (SIUP) de Yoff au Sénégal est un exemple rare d’une collectivité territoriale qui a su très tôt bénéficier de nombreux financements extérieurs pour former les acteurs locaux à l’utilisation de l’outil informatique afin « d’améliorer leurs capacités de gestion et d’aménagement de la collectivité ». Des centres d’Information Populaires (Cip) équipés d’ordinateurs ont été créés, le site de ce projet fut primé en 1999. Depuis il est devenu celui du SIP, le site des collectivités locales du Sénégal qui ambitionne de « Créer dans chaque collectivité des capacités en gestion de Système d’Information et d’Aide à la prise de Décision ainsi qu’en programmation de pages Web. Les données des SIP servent en même temps aux besoins des élus locaux, qu’à ceux des populations de base et de leurs partenaires partout dans le monde ». C’est une ONG qui l’anime, le Centre de Ressources pour l’Émergence Sociale Participative (Cresp) », qui affiche un’appui de tous les partenaires qui gravitent dans ce milieu et un palmares éloquent, Laureat du prix ALCATEL 2000, Mention d’Honneur Internationale, Meilleur Site Africain sur le développement communautaire 1999 . La création de sites et la « cybercitoyenneté » deviennent un nouveau créneau pour draîner des fonds où s’engouffrent les « courtiers du développement ».
Formule proche, le télécentre associatif s’appuie sur une association ou une organisation à but non lucratif qui, en plus de ses activités dans le développement, met à la disposition du public quelques ordinateurs connectés installés dans ses locaux situés plutôt dans les quartiers populaires. Acacia programme du centre international de recherche du Canada, est au Sénégal par exemple, le principal bailleur de fonds dans le secteur associatif. Il soutient une dizaine de programmes déjà présents sur le terrain ou qui ont une expérience avérée de méthodes et de pratiques participatives dont l’ONG internationale ENDA à Dakar avec son « Cyberpop » qui existe depuis 1998 et dont le but est de démocratiser les NTIC par une action de « formation participante ». Pour ce faire, huit centres de ressources communautaires ont été installés dans les quartiers populaires de Dakar et de sa banlieue, chacun avec un thème spécifique, l’éducation alternative, la médecine traditionnelle... Des jeunes du quartier sont formés à la gestion du centre et à l’utilisation des outils informatiques, selon un processus de formation en cascade où ils formeront à leur tour d’autres jeunes. Autre exemple, Acacia intervient aussi pour soutenir un programme de formation des jeunes scolarisés aux questions de population et de vie familiale au travers d’une ONG le GEEP (groupe pour l’étude et l’enseignement de la population). La phase pilote de son programme a débuté en 2000 et s’opère sur 25 espaces-clubs qui sont équipés chacun d’un ordinateur et installés à l’intérieur même d’un établissement scolaire. Chaque club se compose d’environ cinq professeurs qui encadrent une activité d’Education à la Vie Familiale (EVF). La structure se compose également de quinze élèves tuteurs qui servent de relais pour le GEEP, diffusent l’information dans l’établissement auprès des autres élèves et constituent un réseau de personnes ressources qui sont réparties sur l’ensemble du territoire. L’existence de l’ordinateur connecté a amené le GEEP à proposer des prestations. Avec ses « Coins jeunes » il offre de services de traitements de textes et de connexions qui permettent aux élèves et enseignants de profiter de ces nouveaux outils à prix bas.
Au Sénégal et aussi en Afrique du Sud là où de meilleures conditions de connexion existent pour étendre les usages, une demande croissante d’équipement se manifeste. C’est le cas en particulier dans les collèges où le nombre d’élèves et de professeurs qui viennent utiliser les outils des espaces cyber reste très faible en raison du manque de matériel. « Devant l’attente occasionnée par le fait qu’il n’y ait qu’une seule machine, beaucoup d’élèves sont démoralisés, ne reviennent pas et préfèrent se rendre dans les autres cyber de la ville qui pratiquent l’heure de connexion au même tarif. » (Caroline DULAU )
I- 2 Dans les villes secondaires
La tendance au développement des cybercentres privés en dehors des capitales est plus affirmée au Sénégal qui bénéficie d’un tissu de 11000 télécentres privés qui permettent à 80% de la population d’accéder au téléphone et qui auraient créé plus de 20000 emplois. Beaucoup de propriétaires de télécentres uniquement voués à la téléphonie et associant quelques services annexes de bureutique jusqu’en 2000-2001 ont acheté depuis un ou deux ordinateurs qu’ils connectent au réseau, cherchant ainsi à minimiser les risques liés à une seule activité ., car le coût de l’investissement pour la simple téléphonie est sans commune mesure avec celui d’un cybercentre. A Thies depuis le passage de la caravane de démonstration de l’Internet en 2001 cinq cyber centres se sont ouverts. Mais ces entreprises qui jouent un rôle clé sont fragiles, leur durée de vie peut s’avérer éphémère tant la concurrence est rude, les modes de gestion parfois approximatifs et les conditions de l’environnement difficiles. Au Mali : “ Mieux que rien ”
L’exemple de Sikasso à 400km de Bamako, ville de 90 000 habitants, nœud routier entre Burkina et Côte d’Ivoire montre à la fois l’ampleur de la demande et toutes les difficultés liées à l’éloignement de la capitale. A Sikasso, le premier cybercentre privé SICANET est ouvert depuis janvier 2000, dans l’un de ces petits kiosques très sommaires, en banco qui bordent les routes d’entrée des villes et qui abritent plutôt des gargotes ou ventes d’essence ou réparations diverses. Le gérant, d’une trentaine d’années, a mis sept mois pour trouver ce local, a installé quatre ordinateurs et n’a pu obtenir une ligne qu’en décembre 2000. Il se connecte par l’intermédiaire d’un fournisseur d’accès à Bamako mais son hébergeur se situe en Allemagne où il a étudié et gardé des relations. Le cyber fonctionne depuis janvier 2001 et au bout d’un an il comptait une centaine de boites aux lettres soit environ trois fois plus d’utilisateurs. Beaucoup étaient venus au moment de la Coupe d’Afrique des Nations en janvier 2002 ; Sikasso était un des sites d’accueil et la connexion avait été considérablement renforcée grâce à l’appui international apporté à la Société des télécommunications du Mali (Sotelma). Ensuite, ce fut la déception, les étrangers étaient repartis et avec eux le matériel performant. La lenteur du débit, les coupures de courant étaient le lot quotidien, mais c’était selon le gérant toujours “ mieux que rien ” même si pour obtenir les mêmes services qu’à Bamako en trois jours, il lui fallait un mois. Lors de notre enquête en février 2002 , télécharger un texte de 12 pages prenait une demie heure, mais en une heure sont passés, un religieux évangéliste qui a écrit au Burkina, un éleveur qui a négocié avec quelqu’un de Bamako, deux fonctionnaires et trois élèves qui venaient voir en particulier si le dossier d’inscription demandé moyennant finance quatre mois auparavant par e-mail au Canada était arrivé. Notre interlocuteur a dû leur expliquer que ce genre de pratique frauduleuse pour attirer des étudiants était courante. Les clients du cyber centre soit payaient 500 FCFA pour envoyer et pour retirer un message, soit prenaient un forfait d’une heure pour 1500 FCFA, soit pouvaient s’abonner et avoir leur propre boite aux lettres moyennant 10000 FCFA par mois. Beaucoup de personnes fréquentent Sicanet pour envoyer des messages sans savoir ni lire ni écrire, des militaires, des commerçants ; le gérant joue donc un rôle de médiateur, aide à taper, explique comment cela fonctionne. Cette fonction essentielle de médiation est adaptée aux sociétés de l’oralité, mais c’est plutôt avec les travaux annexes de bureautique qu’il “ s’en sortait ” car il reconnaissait que le cyber seul n’était pas rentable. A Sikasso où la connexion par satellite pour la téléphonie fixe a été remise en service par la SOTELMA, (société de télécommunications du Mali) quatre cyber centres ont ouvert en juin 2002 en plus de celui qui existait déjà. Deux sont privés, un appartient à la SOTELMA, un autre s’est ouvert avec un financement de la Banque Mondiale. On rencontre le même type d’entreprise pionnière à Kayes ville commerçante tournée vers le Sénégal capitale de la migration malienne, en relation avec la diaspora et qui pourtant est dépourvue de voies de communication routières et téléphoniques correctes.
Mais les villes secondaires sont aussi un lieu privilégié de déploiement des projets pour promouvoir l’accès auprès des populations dites défavorisées. Des centres d’accès communautaires en difficulté en « mileu rural »
Les critères de définition du milieu rural sont variables ; le critère démographique n’est pas vraiment pertinent en Afrique où deux mondes très différents voire opposés coexistent, la ville primatiale qui regroupe une forte proportion de la population nationale, de 10 et jusqu’à 30%, 40%, et le reste du territoire trop rapidement considéré dans les projets comme rural, c’est-à-dire de façon implicite comme voué aux activités agricoles. L’UNESCO par exemple, considère comme « rurale » la ville de Tombouctou capitale régionale qui compte près de 35000 habitants, siège d’un télécentre communautaire polyvalent faisant partie d’un programme d’équipement rural. Des petites villes de 90000 habitants aux activités diversifiées au Bénin ou au Mali sont elles aussi considérées comme appartenant au monde rural. Or il faut faire la distinction entre les villages entièrement voués à l’agriculture et comptant quelques centaines d’habitants et les gros bourgs et petites villes au tissu socio-économique beaucoup plus diversifié.
Il existe dans chaque pays plusieurs types de projets consacrés au développement des NTIC pour le monde rural, soit par des ONG ou associations spécialisées, soit par des programmes pré-existants qui leur ajoutent cette composante, soit par des associations professionnelles d’encadrement, et de plus en plus dans le cadre de politiques de décentralisation où les pouvoirs locaux jouent un rôle actif.
La création de télécentres communautaires polyvalents (TCP) est apparue aux bailleurs de fonds comme le moyen privilégié à développer dans les petites villes . Les projets pilotes de TCP sont nés d’une démarche “ projet ” construite par des agences de coopération multilatérales à la fin des années quatre vingt dix à la suite du plan d’action des Nations unies pour le développement rural intégré. Il s’agissait de fournir à la population en un même lieu différents outils de communication, téléphone, fax, Internet et des services de bureautique et de reproduction, frappe, photocopie, impression. En plus des fonctions de “ télécentre connecté ”, les TCP proposent des formations et toute une gamme de services d’information (accès aux informations administratives locales et nationales) et ils mettent en ligne des expériences et des savoirs locaux.
Ce modèle se rapproche du modèle occidental ciblant le monde rural. Des projets pilotes de TCP ont été financés dans cinq pays africains, Mali, Ouganda, Mozambique, Tanzanie et Bénin. Ils se localisent non pas dans les toutes petites communautés mais dans les gros bourgs ou dans les capitales régionales éloignées de la capitale et disposant d’un système de télécommunication autonome (radio ou satellite).
Le TCP de Tombouctou a bénéficié d’un budget important, jusqu’à 400 000 $. L’implication forte de l’opérateur national des télécommunications et de l’administration locale n’aurait pas facilité l’appropriation du projet par la société civile les premières années . Ensuite, l’opérateur s’est retiré et il demande désormais que le prix de la connexion lui soit versé. L’association qui gère le centre peine à assurer sa survie sur ses propres ressources malgré une diversification de ses activités . En Afrique anglophone (cas de Nakaseke en Ouganda), le modèle “ communautaire ” serait plus en adéquation avec les institutions locales : elles subventionnent une partie du fonctionnement du TCP avec les impôts locaux et en confient contractuellement la gestion quotidienne à une société privée. Cette formule ne semble plus convenir puisque ce centre est désormais considéré comme un échec .
Depuis la mise en place de ce premier modèle, le concept a évolué et la recherche de la convergence entre informatique audio visuel et télécommunications tend à se développer dans les programmes d’équipement des communautés rurales avec l’appui des organismes internationaux .
Un accès indirect à Internet via les radios
En Afrique le moyen d’information et de communication le plus répandu reste la radio, le seul medium qui soit disponible sur toute l’étendue d’un territoire, non pas parce que tout le monde possède un récepteur mais parce qu’il se trouvera toujours quelqu’un à l’écoute et qui vous transmettra la nouvelle qui vous concerne, avis de naissance ou de décès, petites annonces, rendez-vous téléphonique. La radio nationale et les radios locales jouent un rôle essentiel de medium de proximité voire d’interactivité. Pascal Coulibaly en 1998 doutait de l’intérêt d’Internet pour le monde rural malien ; en Afrique ce n’était pas l’Internet qui était l’instrument de la citoyenneté mais bien la radio qui a connu un développement spectaculaire depuis le début des années quatre vingt dix au Mali. « La liberté des ondes au Mali permet l’émergence de débats publics, garantit une meilleure transparence du pouvoir et une démystification de l’Etat tout puissant. Elle permet surtout de lier les savoirs locaux aux savoirs mondiaux en réhabilitant les langues et les modes d’expressions spécifiques à l’Afrique »" Alors qu’en est-il d’Internet ? Pour lui, quand les ressources et les infrastructures nécessaires à la croissance des TIC font défaut et que les indicateurs sociaux restent au plus bas, l’Internet semble peu adapté. Des expériences d’association entre Internet et radios ont été réalisées depuis sous différentes formes ; - la mise en réseau et l’échange de programmes comme l’initiative de la banque on line de l’institut Panos où interviennent douze têtes de réseaux de radios nationales de douze pays différents, - la mise en place de radios en ligne qui sont nombreuses depuis l’Afrique et servent de lien avec la diaspora, - l’association de radios privées avec la presse périodique comme dans le groupe Sud ou Wal Fadjiri au Sénégal, qui avec une liaison Internet permet de répercuter localement les nouvelles internationales et deviennent ainsi des outils très efficaces de diffusion de l’information voire de formation. Mais d’autres expériences vont plus loin que la simple diffusion et essaient de faire d’Internet un outil de développement interactif en « répondant aux besoins des paysans », par l’utilisation de la radio comme interface d’accès indirect à Internet. L’exemple étudié au Mali par Ken Lohento décrit un « centre multimedia communautaire » avec « radio surf » conçu par l’Unesco.
Les « centres multimedia communautaires » CMC ont été définis par l’UNESCO comme l’ensemble constitué par un télécentre communautaire associé à une radio. Le télécentre propose une gamme de services (téléphone, Internet, télévision, video, télécopie, etc.), alors que la radio favorise la diffusion d’informations par et pour la communauté en langues locales. Les organismes internationaux comme le PNUD, la FAO, la commission économique pour l’Afrique, et nationaux, l’Institut de coopération pour le développement des Pays Bas (IICD), le Centre de recherche canadien pour le développement international (CRDI) réunis dans l’initiative global knowledge partnership (GKP) ont demandé à l’UNESCO de mettre en œuvre ce type de projet. Le projet pilote de Kotmale au Sri Lanka a été lancé en 2000 et à partir de 2001 les CMC ont commencé à se créer en Afrique ; en octobre 2003 il en existait quatre, à Koutiala au Mali, à Banikoara au Bénin, à Dassasgho au Burkina, à Kayes au Mali. D’autres sont prévus à court terme au Mozambique, en Tanzanie, en Ouganda et ensuite en Côte d’Ivoire, au Congo, au Sénégal.
Dans ces centres on a cherché à développer un nouveau concept, la « radio surf » qui consiste selon ses promoteurs, en l’exploration en direct de l’Internet depuis les studios d’une radio. Des acteurs du développement local, encadreur agricole, médecin, journaliste, diffusent en langue locale des informations obtenues sur le web. Les personnes intéressées peuvent intervenir par téléphone en temps réel en posant des questions ou en réagissant. A Kotmale, l’émission quotidienne dure une heure autour d’un thème préparé à l’avance par des recherches sur Internet. Un spécialiste est invité et répond aux questions en adaptant les informations trouvées sur le net ; les auditeurs peuvent demander des précisions soit directement soit par la poste ; les informations les plus significatives sont stockées et présentées sur le site de la radio. Mais ces possibilités théoriques s’avèrent plus complexes que prévu à mettre en oeuvre concrètement comme le montre l’exemple de Koutiala au sud est du Mali dans la région de Sikasso (voir la carte de Camille Lancry). La situation de Koutiala est assez caractéristique de celle de petites villes d’Afrique de l’Ouest d’une région plutôt dynamique. Le cercle de Koutiala ville du coton, « capitale de l’or blanc au Mali » compte 383000 habitants dont 74000 dans la commune urbaine ; l’artère principale seule est bitumée ; il existe une seule entreprise proposant des services informatiques dans la ville mais une diversité de petites entreprises commerciales et une dizaine d’ONG interviennent sur le terrain. Le réseau téléphonique analogique est de mauvaise qualité avec de fréquentes coupures (une semaine en juin, une autre en juillet 2003). Koutiala témoigne du dynamisme de la radio au Mali ; on en compte cinq dont une seule commerciale. La radio communautaire associative Jamala créée en 1993, est bien implantée, son but est d’appuyer les activités locales, elle émet en continu pendant seize heures par jour des émissions en langue locale sur un rayon d’une centaine de kilomètres ; elle emploie douze salariés plus une dizaine de bénévoles. Au travers de ses différentes activités, journalisme, activités socio culturelles, la radio interagit constamment avec les communautés locales. Le télécentre polyvalent dit CMC de Koutiala a passé une convention avec Jamana ; il dispose de cinq ordinateurs et de différents matériels pour offrir au public de la formation et toute une gamme de services payants : 1500FCFA pour une heure de connexion, (2,30euros), 350FCFA, (53 centimes d’euros) par page tapée et imprimée, 50FCFA (7centimes) la photocopie : Ces tarifs sont élevés pour la population locale mais il n’y avait pas d’autres espaces publics d’accès en 2003. Durant l’étude de Ken Lohento en juin juillet 2003, le télécentre était fréquenté par 20 personnes par jour en moyenne et par une quarantaine le samedi. L’expérience de radio surf qui a été réalisée sur le thème de l’excision n’a pas été renouvellée. L’animateur a préparé l’émission en utilisant certains sites, exploitant les informations recueillies avec un invité mais les auditeurs n’ont pas téléphoné et il n’y a pas eu non plus de navigation en direct depuis les studios, la connexion étant trop aléatoire. En fait Internet est utilisé pour les besoins de la radio par son animateur, pas en direct mais pour préparer des émissions en enrichissant sa documentation et en faire profiter ses auditeurs. La réception d’informations agro météorologiques locales et de conseils par Internet est aussi une prestation très appréciée que fournit la radio. En fait l’étude montre qu’il existe une synergie entre la radio et l’accès à Internet mais pas encore entre celle-ci et l’exploitation d’un télécentre public dans ses locaux.
Le concept de radio surf apparaît ici comme le type même d’idée occidentale ne tenant pas compte des contraintes locales. Au Sri Lanka, la radio est dotée d’une connexion haut débit subventionnée, pas en Afrique où le problème principal est la qualité, le coût de la connexion et la disponibilité aléatoire de l’électricité, sans parler de problèmes liés à la gestion, à la non disponibilité du personnel etc. En outre on peut s’interroger sur l’intérêt réel d’une navigation en direct sur Internet pour répondre à des questions d’auditeurs. L’intérêt du web est davantage de constituer une immense bibliothèque où puiser pour se documenter et pouvoir préparer ensuite des dossiers sur un thème donné ce qui demande de trier et de traiter l’information plutôt que de l’utiliser dans l’immédiat ; la création de centres de documentation et de bases de données multimedia mises à disposition du public dans les télécentres polyvalents est une possibilité d’usage d’Internet séduisante mais qui requiert des moyens dont disposent rarement de telles structures en milieu rural en Afrique sauf en étant très largement subventionnées dans la durée.
En milieu rural profond, une gageure
Du sommet de l’Himalaya au désert du Ténéré, il est en 2004 possible de relier n’importe quel point de la planète au téléphone et à Internet, à condition d’y mettre les moyens. Les technologies sans fil (boucle locale, systèmes hertziens divers) ont fait leurs preuves techniques, mais elles n’ont pas (encore) fait leurs preuves sur le plan économique et surtout social quand il s’agit de relier des milieux démunis pour lesquels pourtant elles paraissent en théorie les plus adaptées. Si le « saut technologique » peut être au rendez-vous, le « développement » ne l’est pas. Il existe bien ça et là quelques exemples de télémédecine au village ou de zones rebelles qui communiquent, mais au delà de l’effet vitrine voire médiatique, au quotidien, les expériences de cybercentres installés dans des communautés rurales dépourvues de routes correctes, et d’électricité sont peu probantes. L’exemple décrit par le journal Le Monde en juin 2001 de l’installation d’Internet par une ONG américaine dans un village cambodgien grâce à l’énergie solaire et au satellite, est très significatif des dérives possibles. Les villageois étaient mis en relation avec un hôpital de Boston mais pas avec Phnon Penh, le coût de la liaison était exorbitant, 18000 dollars par an et les autorités cambodgiennes n’appréciaient guère qu’une ONG contourne ainsi le monopole d’Etat des télécommunications . L’indispensable interconnexion avec les réseaux nationaux n’est pas facile à réaliser et surtout à perpétuer. L’expérience de l’ONG d’origine espagnole, Borgounet qui fournit depuis trois ans des services de passerelle de courrier électronique par WIFI, de fourniture d’accès et de formation dans la région défavorisée du nord Bénin, montre bien toute la gageure que constitue l’équipement de communautés éloignées. Malgré tous les efforts des ingénieurs de Borgounet, seule la ville de Parakou jouit d’une téléphonie numérisée dans cette région. Les systèmes radio VHF qu’ils ont développé ne sont pas une solution technologique acceptable pour connecter à Internet ceux qui sont au delà de 50km et sans téléphone. Les solutions satellitaires s’offrent, mais elles sont trop chères. Thomas Baboni écrit : « Nous allons continuer à chercher des solutions créatives pour rapprocher le monde rural béninois des NTIC, mais notre conclusion est qu’il importe d’élargir l’accès à un bon réseau téléphonique numérique sur tout le territoire, ce qui devrait être un service basique assuré par l’Etat qu’aucune initiative privée ne peut remplacer ». Le projet s’est concentré sur le chef-lieu de la région et ses bénéficiaires directs ne sont pas les paysans mais les acteurs du développement, les ONG et associations, les écoles, et les sociétés commerciales . La première préoccupation des ruraux est d’obtenir l’électricité, qui est considérée comme une technologie nouvelle. Ensuite, la demande concerne le réseau téléphonique filaire puis des antennes et relais pour mobiles et télévision. Ce n’est qu’après que viennent les demandes d’équipement en matériel informatique et pour l’accès à Internet dans les administrations des collectivités locales et pour les services à la population .
La décentralisation, de nouvelles opportunités ?
La mise en place de politiques de décentralisation dans plusieurs pays donne des opportunités nouvelles d’utilisation des outils informatiques et d’Internet dans les régions. L’acteur essentiel est ici l’Etat et ses émanations, les pouvoirs locaux élus qui administrent les collectivités locales en faisant appel là encore à des projets en particulier en partenariat avec la coopération décentralisée, leurs budgets très limités ne leur permettant pas de monter seuls de tels projets. Selon les pays les situations diffèrent considérablement. Michel Lesourd et Cheikhou Sylla indiquent qu’au Cap vert, les TIC se retrouvent dans les trois grands programmes d’appui à la décentralisation : Plan de modernisation des municipes (Gouvernemental) qui équipe partiellement les collectivités, Plan National de Décentralisation de l’Etat (PNUD), Programme d’appui à l’administration municipale (Banque Mondiale) » . C’est au Mali qu’un projet utopique porté par l’un des leader politiques de ce continent a été envisagé pour permettre de « combler le fossé numérique » . L’ex président Alpha Oumar Konare lors du colloque Bamako 2000, sur « Internet, les passerelles du développement » rêvait de connecter les 703 nouvelles communes au téléphone et à Internet pour renforcer la nation, amener l’administration aux administrés, une manière moins coûteuse pour aménager le territoire que la construction de routes. Des progrès réels ont été faits ces deux dernières années en matière de téléphonie rurale au Mali , mais le programme de connexion n’a pas vraiment démarré sauf dans les cinq villes secondaires qui ont accueilli la coupe d’Afrique des Nations en 2002 car en dehors des problèmes de financement et d’organisation du projet lui-même demeure la question de l’accessibilité de régions isolées pour entretenir et réparer le matériel. Camille Lancry montre bien dans le cas de la région de Sikasso la diversité des situations en fonction de la localisation des agglomérations. Au Cameroun la nouvelle vision de la téléphonie rurale est basée sur l’implantation des télécentres communautaires conçus comme de véritables centres d’affaires intégrant des services postaux, d’épargne, de transferts de fonds, de radio et de télévision communautaire, de centres de jeunesse. 92 télécentres seront implantés par l’Etat dans la phase pilote mais doivent être rétrocédés aux collectivités locales qui peuvent soit les gérer elles mêmes soit les transférer sous contrôle à des groupements d’intérêt commun, soit les céder à des opérateurs privés ; la maintenance devra être assurée d’abord par l’Etat et progressivement des techniciens seront formés et mis à disposition des gérants. Ce programme a débuté par 12 implantations pilotes ; il existe deux autres projets de téléphonie rurale pour 67 localités avec un financement Cameroun Belgique et pour 21 localités avec le Japon. Si ce programme se réalise, sans l’apport additionnel du secteur privé, il n’y aura encore que 161 localités rurales connectées sur plusieurs milliers au Cameroun .
II - Des accès publics en crise
II-1 - Une promotion d’Internet pour les « défavorisés » impulsée par le Nord
Comme le montre l’extrait en exergue de la déclaration adoptée lors du premier sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), affirmer que le monde est devenu une « société de l’information » fait partie désormais de la rhétorique internationale, promue par l’ONU, et tous les types d’acteurs qui gravitent dans le monde du « développement » Etats, société civile et secteur privé inclus sont priés de « relever le défi ». Ainsi, contester les bénéfices d’Internet pour l’Afrique n’est pas de mise et peu de thèmes ont bénéficié dans le champ du développement d’un intérêt aussi large. Pourquoi tant d’honneur pour ce thème des NTIC s’interrogent les militants du forum pour un autre Mali ? . Les raisons sont à rechercher dans l’intense promotion faite dans les années quatre-vingt dix par les instances internationales et nationales, relayée par certains auteurs à succès et en conformité avec la politique des pays riches, Etats Unis en tête. Ils ont crée ce paradigme d’une « société mondiale de l’information » à laquelle chaque pays et tout un chacun devraient participer, pour son bien quelles que soient ses caractéristiques économiques et culturelles. Les enjeux fondamentaux d’une telle promotion sont économiques et politiques et basés sur le substrat culturel d’une hégémonie occidentale ; ouvrir les marchés aux produits et services de communication, d’information et de savoir par le moyen d’une libéralisation contrainte ou forcée, orchestrée par les organisations financières internationales, Banque Mondiale et FMI, et sous-tendue par les accords de l’OMC ; la concurrence entre les opérateurs étant considérée comme le meilleur moyen de s’équiper pour les pays pauvres et de « combler leur retard ». Le rôle de l’Etat dans ce scénario dominant est de faciliter le libre jeu du marché mais surtout pas d’intervenir dans la vie économique.
Mais ce n’est évidemment pas cette version d’une économie libérale dominatrice promue par les pays riches qui fait l’objet de la véritable propagande pour les NTIC. Du « saut technologique » à la « fracture numérique », le discours porté par les organismes internationaux a trouvé là un nouveau moyen d’exprimer sa rhétorique , il fait preuve d’une rare constance depuis plus de dix ans. En 2001 la vision du rapport annuel du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) "Mettre les nouvelles technologies au service du développement humain" résume bien la conception déterministe qui voit le progrès technique comme le vecteur du progrès humain et qui continue à dominer la pensée « globalisée ». Ce rapport affirme que les TIC sont un outil sans précédent pour en finir avec la pauvreté au XXIème siècle, car elles interviennent à presque tous les niveaux de l’activité humaine, qu’elles peuvent être utilisées quasiment partout et pour tous et aussi parce que ces technologies suppriment les obstacles au développement humain - en éliminant les obstacles au savoir, les pauvres comme les riches pouvant accéder à l’information grâce à Internet ; - en éliminant des obstacles aux opportunités économiques car, "Si les acteurs du développement ignorent délibérément l’explosion de l’innovation technologique .. ; ils risquent de se marginaliser ; cela reviendrait à refuser aux pauvres des opportunités" . Mais comment s’y prendre pour que ce dogme théorique se traduise en pratique ? En ce domaine comme ailleurs, s’exerce le volontarisme des « experts » des pays du nord ceux qui savent et qui projettent leur vision du « développement » sur les populations africaines en l’exprimant désormais sous la forme de la « réduction de la pauvreté » .
Partant de l’idée qu’il fallait étendre le « service universel » et que les populations non ou peu solvables avaient tout intérêt pour « accroître leurs capacités » à mieux communiquer et s’informer, La « société civile » s’est très vite insérée dans ce créneau trouvant des accords avec les coopérations bilatérales ou décentralisées et un appui de la part des pouvoirs publics qui ont largement relayé le discours L’exemple le plus significatif pour l’Afrique de l’Ouest est le rôle très actif joué par la fondation du Devenir et la coopération suisse en partenariat avec le gouvernement du Mali, qui dès 1996 créait le réseau Anais pour promouvoir le développement des usages d’Internet par les associations africaines. Ce réseau a organisé en 2000 à Bamako le premier colloque regroupant la société civile, « Internet, passerelles du développement » et aussi en 2002 la première préparation au sommet mondial de la société de l’information toujours à Bamako. Les promoteurs d’Anais ont fait partie du secrétariat du bureau de la société civile dans le cadre de l’organisation de la première phase du sommet mondial de la société de l’information (SMSI) à Genève en décembre 2003. Des projets souvent via des ONG, et associations diverses se sont focalisés d’emblée sur la création d’accès collectifs mais aussi de contenus pour des publics ciblés, « les plus défavorisés », femmes, jeunes, paysans dans des zones marginalisées ; périphéries pauvres des villes et du milieu rural, c’est-à-dire là où se cumulent tous les handicaps et donc où le projet a le moins de chances de fonctionner correctement. La conception du centre de recherche canadien pour le développement international, CRDI qui a joué un rôle pionnier dans la création de programmes TIC en milieux marginalisés en Afrique est caractéristique de cette approche. Le concept Acacia a pris forme dès la Conférence de 1996 sur « la Société de l’Information et du Développement », la première à se tenir dans un pays en voie de développement, l’Afrique du Sud. Selon ses promoteurs, l’initiative Acacia est avant tout un programme de recherche « qui vise à démontrer, à travers une variété d’applications et d’usages, comment les technologies de l’information et de la communication, peuvent contribuer à l’amélioration des conditions de vie des communautés de base en Afrique subsaharienne en s’appuyant sur leur propre vision du développement et dans le respect de leurs valeurs culturelles et sociales ». Mais les principaux acteurs du développement d’Internet en Afrique sont les petits entrepreneurs privés qui ont ouvert les nombreux télé et cyber centres.
II-2 Une difficile adéquation des projets avec les contraintes locales
D’une manière générale, si certaines catégories de personnes commencent à utiliser Internet dans les quartiers urbains populaires et en milieu rural, la grande majorité de la population de ces zones ignore tout de cet outil ou n’en voit pas l’utilité pour le développement de ses activités quand elles se déroulent à l’échelle locale. Parmi les utilisateurs, il peut se manifester une certaine défection et remise en cause de sa pertinence quand les résultats attendus ne correspondent pas aux attentes. C’est le cas par exemple pour les points d’accès décentralisés au « Trade point center » du Sénégal (TPS) qui après avoir fait l’objet d’un engouement de la part des opérateurs économiques, sont maintenant en récession "Un trade point est un regroupement physique et/ou virtuel de tous les pôles qui interviennent dans le commerce extérieur en s’appuyant sur les NTIC. C’est aussi une source d’informations commerciales, un point d’accès à des réseaux mondiaux et un centre d’appui et de conseil aux opérateurs économiques pour l’accès aux marchés internationaux" (note d’information). Le Trade Point Sénégal (TPS), une émanation du système "Trade point" de la CNUCED, a été créé le 28 février 1996 avec le statut d’une fondation d’utilité publique qui lui a permis d’obtenir la collaboration à la fois des secteurs privé et public et de récolter des subventions très importantes. Le TPS présente les informations existant à travers le réseau mondial et concernant les échanges internationaux, avec l’objectif de stimuler l’exportation de produits locaux. Il a décentralisé ses services pour être accessible aux zones éloignées et au plus grand nombre d’opérateurs économiques, grands et petits. Après quelques années, l’évaluation du programme, Acacia l’un des bailleurs de fonds, cite le cas de certains entrepreneurs de la région de Thiès qui dès l’ouverture de l’antenne TPS ont adhéré au système, avec au début un grand enthousiasme, et qui l’ont abandonné depuis. La plupart de ces premiers adhérents fréquentent de moins en moins les antennes car l’offre correspond rarement à leur demande d’informations commerciales et comme la recherche de ces informations est payante, l’utilisation du service diminue. En effet, l’information disponible est destinée à un marché bien organisé et structuré avec de plus une bonne assise financière ce qui n’est pas le cas des économies locales qui fonctionnent sur un mode largement informel. Un autre exemple, celui des femmes mareyeuses de Joal est significatif ; elles ne peuvent pas répondre à la demande de clients virtuels n’ayant ni la qualité ni la quantité de poisson demandé faute de capacités de stockage, et aussi en raison de la déficience de leur organisation .
Les récentes évaluations d’Acacia font ressortir une très faible utilisation d’Internet dans les télécentres multimédia des communautés rurales étudiées au Kenya et en Ouganda. Les technologies les plus couramment utilisées sont le téléphone, le traitement de texte, le fax, le courriel, la navigation sur Internet étant quasiment inexistante. Au Kenya, 73% des personnes déclarent utiliser le téléphone, 18% l’ordinateur pour le traitement de texte, 18% le fax et 3% seulement le courriel. Personne n’avait navigué sur la toile. En Ouganda 6,4% des personnes utilisent le courriel et 9% le traitement de texte, personne la navigation. Acacia a révisé ses programmes en les orientant davantage vers les organisations d’encadrement qui sont les intermédiaires avec le monde paysan mais dont les équipements informatiques sont localisés en ville.
On peut se demander en effet si Internet est bien adapté aux besoins individuels « de développement » des milieux populaires. Par contre son impact est réel au niveau des structures d’encadrement, organisations professionnelles et associations diverses, qui sont désormais équipées d’outils informatiques et utilisent le net, mais davantage pour un usage interne, courrier, relations avec les bailleurs de fonds, que pour s’informer et mieux répondre aux besoins des populations encadrées . Un exemple comme celui du secteur de la pêche artisanale au Sénégal le montre bien. Les outils informatiques sont présents au siège urbain des groupements et fédérations de producteurs à la FENAGIE (Fédération nationale des groupements de pêcheurs) par exemple où un programme de création d’une base de données est en cours mais Internet est rarement utilisé et aucun ordinateur n’existe encore en dehors des bureaux de Dakar. Il est difficile de produire le journal professionnel qui ne parait que très épisodiquement. Par contre le GPS et le téléphone mobile sont utilisés naturellement et quotidiennement par les pêcheurs. .
Après quatre à six ans, se pose la question de la survie des accès collectifs associatifs qui ont été pionniers pour faire connaître Internet mais qui sont confrontés entre autres problèmes, à la « fatigue de l’aide ». Aujourd’hui les télécentres communautaires s’avèrent difficilement rentables que ce soit au Botswana en Ouganda au Sénégal, au Burkina Faso ou au Mali. Avec la fin des subventions, la nécessité de s’auto financer, et le besoin de renouveler un matériel qui vieillit vite, la plupart peinent à trouver leur « modèle économique ». Les promoteurs recherchent alors d’autres financements, s’ils n’en trouvent pas on voit alors le matériel tomber en panne et ne pas être réparé. Une étude récente pour la Banque mondiale, sur les politiques concernant les télécommunications, remet en cause le principe même du projet porté par des bailleurs de fonds externes. Les télécentres ne peuvent pas être rentables car ils sont conçus davantage en fonction d’une vision des bailleurs de fonds qu’en fonction de ce que les communautés sont réellement capables d’assumer. « As part of that we examined existing donor funded telecentres in Uganda, and paid visits to a few - this was a real eye opener. The donor funded telecentres have almost no chance of achieving financial sustainability - they simply were not set up to generate revenue, but to achieve some sort of donor vision of what telecentres should do - not what the communities might actually use and pay for. At one telecentre, the staff did not even keep financial records on the business and seemed to spend most of their time searching for the next donor drop of cash”. (Don Richardson)
On se heurte dans ce domaine comme dans d’autres à la question de fond du développement par projet qui se substitue aux politiques publiques déficientes. Le projet n’ayant pas obligatoirement vocation à être pérennisé, il faut trouver des moyens pour prendre le relais et en assurer la continuité, or contrairement à ce qui se passe pour les accès publics collectifs en Europe, il n’y a que peu de possibilités de subventions pluri annuelles de la part des collectivités locales ou d’autres entités nationales publiques, qui sont trop démunies et le bénévolat dans les associations a ses limites. Les financements accordés par le CRDI par exemple s’échelonnent sur deux ans, trois ans maximum. La coopération décentralisée entre collectivités locales du nord et du sud qui commence à s’intéresser à cette question offrira t’elle des possibilités de e-jumelages durables entre communes ? La question de la durabilité des actions se pose rapidement et avec acuité dans un domaine où les techniques évoluent sans cesse créant une course sans fin et « de fausses fractures synonymes de faux problèmes à résoudre » . A ce problème de fonds du financement s’ajoute la multiplicité des autres facteurs négatifs qui font que les conditions sont rarement réunies pour la réussite de tels projets ; infrastructures adéquates en énergie et télécommunications, capacités à utiliser l’ordinateur, porteur de projet motivé, médiateurs ou facilitateurs compétents, capacités de maintenance des outils et au delà utilité réelle d’Internet pour les populations visées et pertinence des propositions ... Des problèmes qui tiennent au mode de fonctionnement particulier des économies africaines.
L’attention des chercheurs et des intervenants du « développement » est focalisée sur les accès communautaires sponsorisés ce qui entraîne un biais dans l’évaluation de leurs effets. Quelques exemples de réussites ne font pas un développement d’ensemble et si le mode d’accès aux outils de communication est essentiellement collectif étant donné le faible niveau de vie moyen des populations comparé au coût du matériel et de la communication elle-même, il est aussi essentiellement privé.
Au Bénin, au Sénégal, au Cameroun, au Burkina, au Mali, au Togo, les centres d’accès communautaires se différencient difficilement des boutiques privées qui offrent la connexion à des prix de plus en plus bas. En fait le secteur associatif s’il a joué un rôle pionnier dans l’insertion d’Internet en Afrique, a très vite été concurrencé par le secteur marchand, il joue (a toujours joué) un rôle marginal. Pour Sylvestre Ouedraogo les associations ; doivent réorienter leurs objectifs afin d’être complémentaires et non pas concurrentes du privé qu’elles ont aidé par leurs sensibilisation à mettre en place. « Par exemple, on peut s’occuper de la formation de formateurs, de la réflexion sur la sécurité informatique, le droit, les méthodes de recherches d’information sur l’Internet, la production de contenus, la lutte contre la visite des sites pornographiques l’usage des logiciels libres et bien d’autres choses...C’est à ce niveau que l’on doit innover, créer pour répondre à l’attente de la population ».
II - 3 Un secteur privé très fragile
On note déjà une sorte d’essoufflement de l’intérêt pour Internet dans certaines capitales comme Dakar où le prix de l’heure de connexion est pourtant descendu jusqu’à 350FCFA. À l’inverse du téléphone, l’évolution du parc des usagers de l’Internet est lent au Sénégal, 8000 comptes en 1999 pour 11 000 en 2003. Le premier fournisseur privé derrière la Sonatel/France Télécom compte 1000 abonnés quand le Métissacana de Dakar premier cybercafé installé en Afrique de l’Ouest en comptait 1500, en 1999, avant d’être freiné par la carence de bande passante et de disparaître. Il y aurait une centaine de cybercentres à Bamako mais avec un taux de mortalité très élevé et une courte durée de vie. La plupart sont de très petite taille et il en existe trois à cinq très grands. La plupart des villes secondaires ont au moins un télé-cybercentre mais qui souffre de problèmes de connexion et de prix élévés. A Ouagadougou la plupart des boutiques qui avaient proliféré entre 2000 et 2002 ont fermé. Il reste selon nos enquêtes début 2004, une trentaine d’établissements et seuls les plus grands avec au moins vingt machines apparaissent viables, à condition d’associer d’autres activités annexes à la fourniture d’accès. Dans cette ville, les quelques établissements bien équipés, quatre ou cinq, vivent grâce à une clientèle bien particulière, celle des Nigérians qui sont très assidus pour organiser grâce au web depuis le Burkina toutes sortes d’affaires. Les fréquentes interruptions du courant électrique observées au Cameroun compromettent l’avenir des cybercafés, un secteur déjà fragile où la concurrence sévit cruellement et qui voit aujourd’hui son chiffre d’affaires diminuer dangereusement. En juin 2003 à Douala, des délestages ont sévi avec une acuité sans pareille « En tant normal, nous faisions une recette journalière de 60 000 francs CFA (92 euros environ). Depuis le début des délestages nous faisons à peine 30 000 francs CFA (46 euros environ) par jour », révèlait le patron d’un cybercafé situé non loin de l’Université de Douala. Des baisses qui avoisinent 50%, voire plus, inquiétent les patrons qui se demandent comment faire pour honorer tous les engagements liés à l’activité .
Pourquoi de telles situations ? Les systèmes informatiques sont-ils compatibles avec le mode de fonctionnement « informel » des économies africaines ? L’insertion des NTIC pose en fait la même question que d’autres systèmes technologiques, celle du type de moyens, financiers, techniques, institutionnels, humains qu’une collectivité peut se donner pour que soit dépassé le simple stade de l’économie de survie et que s’installent durablement les systèmes techniques territoriaux "véhicules", "systèmes nerveux", du développement et les services qu’ils permettent. Les systèmes d’accès privés à Internet sont très fragiles car difficilement rentables étant donné les coûts de l’investissement et du fonctionnement et des modes de gestion souvent approximatifs. Les raisons d’une telle crise qui tiennent à la fois à des contraintes structurelles et à la conjoncture actuelle d’un système de télécommunication en transition, sont nombreuses ; déficience des réseaux d’infrastructures, prix élevés à tous les niveaux, manque de formation, défauts de maintenance. Le manque d’infrastructure de communication en dehors des villes principales et la mauvaise qualité de la connexion liée à l’étroitesse de la bande passante nationale ou à des liaisons par le réseau téléphonique sont les premiers obstacles. A cela s’ajoute les coupures d’électricité. Les coûts élevés de la connexion et des équipements informatiques en valeur absolue font de l’Afrique un continent où « tout est plus cher qu’ailleurs ». Si en principe la connexion peut se faire au tarif local, les fournisseurs d’accès hésitent à aller dans les centres secondaires, surtout au Burkina et au Mali où les coûts particulièrement élevés de la communication locale et internationale sont dus en partie au monopole de l’ONATEL et de la SOTELMA. Le prix d’achat d’une unité de travail complète équivaut à une année de salaire d’un cadre supérieur de la fonction publique au Burkina. Un approvisionnement en ordinateurs d’occasion est possible à Dakar en particulier, où les grands commerçants Mourides maîtrisent les filières internationales et ajoutent à Sandaga, le grand marché du centre de Dakar, une plateforme de distribution des outils de communication qui engorge le centre de la capitale. Le manque de personnel qualifié et de connaissances en gestion est général surtout pour les petites boutiques, les plus nombreuses, disons avec moins de dix ordinateurs, qui fonctionnent sur un mode en partie informel. Les formes de gestion sont diverses et s’inscrivent dans les relations sociales et dans la culture locale. La plupart des propriétaires sont sans qualification particulière en informatique, la fourniture d’accès s’ajoute à leurs autres activités et ils ignorent tout des techniques de marketing. Ils achètent le matériel eux-mêmes ou par le biais d’un parent, recueillent la recette au jour le jour et tardent à payer leurs factures de télécommunications. Ils recrutent des jeunes souvent de la famille qui sont très peu ou pas rémunérés. Ces jeunes sont capables de montrer comment ouvrir sa boite et naviguer mais ne vont pas au-delà, rares sont ceux qui ont reçu une formation solide en nouvelles technologies. Ces nouveaux médiateurs qui font l’interface entre l’outil et l’usager jouent pourtant un rôle crucial en permettant aux personnes qui ont des difficultés ou qui sont analphabètes, comme les grands commerçants mourides du Sénégal, d’avoir accès au réseau. Le défaut de maintenance est le problème lancinant du sous-développement, il est particulièrement crucial dans ce domaine où le matériel vieillit d’autant plus vite qu’il est soumis à de dures conditions climatiques ; rares sont les établissements climatisés étant donné le coût élevé de l’électricité. Les technologies de l’information requièrent en principe comme les autres des normes tant techniques que juridiques pour être installées et fonctionner correctement dans la durée et sont donc peu compatibles avec l’économie informelle. Il faut des réseaux d’installateurs, des entreprises de services de maintenance distribuant pièces détachées équipements et consommables. Il faut aussi que les personnes physiques ou morales qui cherchent à acquérir de telles techniques possèdent une existence juridique pour bénéficier de prêts, ou encore avoir des recours si l’équipement fonctionne mal. Ces conditions de droit sont rarement réunies en totalité et on voit les équipements tomber en panne et ne pas être réparés.
Les formes d’utilisation du réseau sont multiples, les publics se sont diversifiés, mais ils viennent très rarement des milieux populaires. Les étudiants ne sont plus les seuls comme au début à fréquenter les cybercentres. Etudiants, chercheurs, médecins, commerçants, enseignants, membres d’ONG y vont pour communiquer et s’informer.. L’usage du courrier dans des relations amicales et familiales reste dominant, mais s’y ajoutent les recherches, études, bourses, inscriptions, documentation, la téléphonie, le chat, les commandes. Du point de vue des contenus enfin, l’absence de contenus adaptés au contexte local sur Internet diminue l’intérêt du plus grand nombre pour le réseau ; seuls ceux qui ont des raisons de se relier à l’international fréquentent les cybercentres.
Conclusion : vers une mondialisation paradoxale ?
Du point de vue des acteurs du développement des NTIC, on entend beaucoup moins parler aujourd’hui d’expériences destinées à « brûler les étapes », il s’exprime désormais au travers des listes de discussion et des travaux récents une tendance à vouloir réorienter les programmes vers des zones et des populations plus aptes à accueillir l’innovation et aussi pour le milieu rural, une tendance à mieux prendre en compte la complémentarité des outils numériques. Un certain rejet de l’idée d’amener les NTIC aux pauvres s’est aussi exprimé dans une liste des Etats Unis en partant du constat de la non rentabilité des actions menées ce qui a suscité une polémique ardente parmi les chercheurs dont la plupart étaient aussi des militants associatifs. Les évaluations et diverses « lessons learned » à propos du « digital divide » insistent désormais sur la nécessaire conjonction d’un environnement fait d’un ensemble d’infrastructures, de capacités financières et humaines adéquates et de besoins réels pour un bon usage d’Internet et même quelques voix s’élèvent pour préconiser d’enlever les œillères et de regarder ce qui se passe sur le terrain concret, la prolifération généralisée des petites entreprises privées d’accès public à Internet. . Quelques années d’expérience d’utilisation des nouvelles technologies confirment l’hypothèse d’une forte corrélation avec leur localisation ; les communautés urbaines disposant d’infrastructures de meilleure qualité et de la proximité de marchés plus formels et plus structurés profitent davantage des TIC que les communautés rurales. En milieu rural le critère démographique et économique joue aussi ; dans un gros bourg de plusieurs milliers d’habitants avec un tissu socio-économique diversifié, un centre de communication sera plus viable et rentable que s’il est installé dans un tout petit village isolé où ne vivent que des agriculteurs. Ainsi, si la demande en télécommunications s’est affirmée, elle varie à la fois dans l’espace et aussi dans la durée selon le niveau d’équipement atteint.
Mais la mondialisation dont les NTIC sont les vecteurs aujourd’hui, pose la question de la réorganisation de territoires anciens et de la création de nouveaux territoires selon des critères très différents du modèle de la cité moderne au sens occidental. Les NTIC fournissent aux acteurs économiques un éventail d’opportunités nouvelles qui peuvent leur permettre d’agir en dehors des lois et des systèmes de régulations de l’Etat, et aussi d’engendrer de nouvelles relations entre eux. Jusqu’ici les pays où il existe un maillage du territoire par des réseaux d’infrastructures, sont ceux où les usages des NTIC et d’Internet en particulier se développent le plus, mais on peut se demander si dans un proche avenir les technologies de la communication ne vont pas engendrer la création de zones géographiques où l’Etat est totalement ou partiellement absent mais qui seraient à la pointe « d’une mondialité par le bas ». L’approvisionnement en équipements numériques neufs et d’occasion stimule le commerce africain. Les grands commerçants Ouest africains du Nigéria, du Sénégal, sillonnent la planète entre les centres de l’économie mondiale et les grandes villes africaines. Le centre de Dakar est sous l’emprise du marché de Sandaga, véritable plaque tournante régionale où se vendent toutes sortes de matériels électroniques, du poste radio au téléphone portable et jusqu’à l’ordinateur, importés de manière plus ou moins licite. Sandaga essaime aussi dans d’autres quartiers, près du port par exemple où une cinquantaine de boutiques se sont ouvertes, à la fin de l’année 2000 toutes dédiées à la vente de téléphones mobiles et de leurs accessoires, et juste à côté des bureaux d’Alizée, l’opérateur de télécommunications mobiles de la Sonatel. Les téléphones sont décodés et recodés par des informaticiens et les abonnements sont vendus au tarif le plus faible, celui réservé aux étudiants. Sandaga illustre l’efficacité de systèmes et d’agents considérés comme marginaux, informels ou illégaux par rapport au concept traditionnel de l’économie classique et qui génèreraient autour de 60% du PIB sénégalais. A Ouagadougou, actuellement, des centaines de jeunes ont trouvé un petit emploi (ventes et réparation de téléphones portables, ventes des cartes de recharge téléphonique...) Il existe même des services de recharge électrique au centre ville : quand votre appareil est déchargé, vous pouvez trouver un stand où le brancher.
Va-t-on vers des formes socio-spatiales à la zairoise, territoires écartelés et lacunaires en proie à des forces centrifuges ou les zones rebelles bénéficient de programmes de connexion de l’ONU et où quelques villages isolés en forêt ne sont reliés que par les petits avions des missions mais communiquent par radio ou par téléphone ? Alors qu’aujourd’hui dans beaucoup de pays l’étroitesse de la bande passante nationale est un handicap qui décourage les utilisateurs, les possibilités de communication offertes par les technologies sans fil vont se multiplier et permettre la prolifération d’espaces reliés par les NTIC mais indépendants des systèmes de gestion classiques d’un territoire aménagé. N’est-ce pas déjà le cas de Kinshasa ? Ira-t-on alors vers des formes extrêmes et pathologiques de la ville d’Afrique de l’Ouest, dont Lagos et son marché d’Alaba, marché des produits électroniques, summum de la « réinvention du capitalisme », seraient la préfiguration ? C’est la thèse de l’équipe d’urbanistes de Harvard dirigée par Rem Koolas pour qui Lagos au Nigéria représenterait le paradigme de la ville du futur alors qu’elle n’obéit plus aux critères qui définissent une ville au sens occidental. La mégalopole de Lagos avec ses quinze millions d’habitants, "pose une énigme fondamentale : elle continue d’exister et maintient sa productivité malgré une absence quasi totale des infrastructures, systèmes, organisations et aménagements qui définissent la notion de " ville " au sens occidental... Nous pensons pouvoir soutenir que Lagos représente un cas d’école développé, extrême et paradigmatique d’une ville à l’avant-garde de la modernité mondialisante ”. A la périphérie de cette mégalopole, l’énorme marché électronique international d’Alaba est équidistant du port d’Apapa, (source officielle d’approvisionnement) et de Semme, ville frontalière béninoise (source officieuse). Alaba s’est créé spontanément dans un no man’s land entre des autoroutes. Décrit officiellement comme un secteur « inorganisé », le marché inclut 50 000 commerçants avec un chiffre d’affaires net de plus de deux milliards de dollars par an, et est devenu le plus important marché électronique du continent (75% pour l’Afrique de l’Ouest). Alaba, « entreprise totalement autogénérée » est en relation avec le monde entier "Partout, des antennes de 30 mètres de haut surgissent des entrepôts-boutiques du marché. D’énormes antennes paraboliques trônent de façon précaire sur les toits frêles. Le taux de possession de téléphone cellulaire est incroyablement élevé et c’est à Alaba que l’on trouve la plus importante concentration du pays de ce qu’on appellerait en d’autres lieux des boîtes aux lettres. Lorsque le marché est vide, celui-ci ressemble plus à un centre de communication qu’à un centre commercial... ” (Rem KOOLAS)
Références bibliographiques
![]() BABONI TH., SIMO J., 2003, « Quelles technologies, quelles actions et quels bénéficiaires pour mettre les NTIC au service du développement au Nord du Bénin ? » NETSUDS n°1, septembre 2003.
BABONI TH., SIMO J., 2003, « Quelles technologies, quelles actions et quels bénéficiaires pour mettre les NTIC au service du développement au Nord du Bénin ? » NETSUDS n°1, septembre 2003.
![]() BARRY P., DIOP H.,(2002) « L’impact d’Internet sur le fonctionnement des moyennes et grandes entreprises industrielles » in, DIOP M. C. (dir), Le Sénégal à l’heure de l’information., Paris Karthala-UNRISD, p 97-120.
BARRY P., DIOP H.,(2002) « L’impact d’Internet sur le fonctionnement des moyennes et grandes entreprises industrielles » in, DIOP M. C. (dir), Le Sénégal à l’heure de l’information., Paris Karthala-UNRISD, p 97-120.
![]() BRETON P., 2000, Le culte de l’Internet, Paris, La Découverte.
BRETON P., 2000, Le culte de l’Internet, Paris, La Découverte.
![]() CARROUÉ L., 2002, Géographie de la mondialisation, PUF, Paris.
CARROUÉ L., 2002, Géographie de la mondialisation, PUF, Paris.
![]() CHÉNEAU-LOQUAY A., 2001, « Les relations entre l’État, le droit et les réseaux techniques sont elles obligatoires dans le processus de modernisation ? Réflexion à partir du cas africain », Terminal, n°84, (voir http://www.africanti.org/resultats/...)
CHÉNEAU-LOQUAY A., 2001, « Les relations entre l’État, le droit et les réseaux techniques sont elles obligatoires dans le processus de modernisation ? Réflexion à partir du cas africain », Terminal, n°84, (voir http://www.africanti.org/resultats/...)
![]() CHÉNEAU-LOQUAY A., 2004.a « Commentles NTIC sont-elles compatibles avec l’économie informelleen Afrique », AnnuaireFrançais de Relations Internationales 2004, Volume 5.
CHÉNEAU-LOQUAY A., 2004.a « Commentles NTIC sont-elles compatibles avec l’économie informelleen Afrique », AnnuaireFrançais de Relations Internationales 2004, Volume 5.
![]() CHÉNEAU-LOQUAY A., 2004.b, « TIC et développement africain informel : adéquation de la démarche de l’ONU ? », Actes du colloque, Société de l’information, entre mythe et réalité, 4-5 septembre 2003, CERIME, groupe de recherches interdisciplinaires sur la construction européenne (GRICE), Institut des hautes études européennes, Strasbourg.
CHÉNEAU-LOQUAY A., 2004.b, « TIC et développement africain informel : adéquation de la démarche de l’ONU ? », Actes du colloque, Société de l’information, entre mythe et réalité, 4-5 septembre 2003, CERIME, groupe de recherches interdisciplinaires sur la construction européenne (GRICE), Institut des hautes études européennes, Strasbourg.
![]() CHÉNEAU-LOQUAY A., NTAMBUE R., 2003, « La Coopération à l’assaut de l’Afrique », Société de l’information et coopération internationale : development.com, L’annuaire suisse de politique de développement, publié par l’IUED (Institut universitaire d’études du développement, Genève), décembre 2003 p 45-77 et Cd rom et site complémentaires http://www.iued-wsis.org.
CHÉNEAU-LOQUAY A., NTAMBUE R., 2003, « La Coopération à l’assaut de l’Afrique », Société de l’information et coopération internationale : development.com, L’annuaire suisse de politique de développement, publié par l’IUED (Institut universitaire d’études du développement, Genève), décembre 2003 p 45-77 et Cd rom et site complémentaires http://www.iued-wsis.org.
![]() COULOUBALY P., 2000, Des radios à Internet : le rôle des technologies de l’information en tant qu’outils de transparence et de décentralisation du savoir, « Enjeux des technologies de la communication en Afrique : du téléphone à Internet » Chéneau-Loquay A. (dir), Paris, Karthala p 375-385.
COULOUBALY P., 2000, Des radios à Internet : le rôle des technologies de l’information en tant qu’outils de transparence et de décentralisation du savoir, « Enjeux des technologies de la communication en Afrique : du téléphone à Internet » Chéneau-Loquay A. (dir), Paris, Karthala p 375-385.
![]() DOLFUS O., 1990, "Le Système monde", Mondes nouveaux, tome 1, Géographie Universelle, Hachette-RECLUS, Paris
DOLFUS O., 1990, "Le Système monde", Mondes nouveaux, tome 1, Géographie Universelle, Hachette-RECLUS, Paris
![]() DULAU C., 2002, "L’Internet au Sénégal : Modes d’insertion, différents usages et réseaux de communication mis en place par les ONG dakaroises", mémoire de DEA en Géographie, Université de Bordeaux III, 2002, sur le site http://www.africanti.org/resultats/....
DULAU C., 2002, "L’Internet au Sénégal : Modes d’insertion, différents usages et réseaux de communication mis en place par les ONG dakaroises", mémoire de DEA en Géographie, Université de Bordeaux III, 2002, sur le site http://www.africanti.org/resultats/....
![]() KOOLAS R., 2000, « Lagos, Harvard project on the city », Mutations, ACTAR, Arc en rêve Centre d’architecture, Bordeaux.
KOOLAS R., 2000, « Lagos, Harvard project on the city », Mutations, ACTAR, Arc en rêve Centre d’architecture, Bordeaux.
![]() LAFITE A., 2001« Les cybercafés du centre de Dakar », mémoire de stage IEP Bordeaux deuxième année, septembre 2001.voir http://www.africanti.org/resultats/....
LAFITE A., 2001« Les cybercafés du centre de Dakar », mémoire de stage IEP Bordeaux deuxième année, septembre 2001.voir http://www.africanti.org/resultats/....
![]() LOHENTO K., 2003, "Usage des NTIC et médiation des savoirs en milieu rural africain : études de cas au Bénin et au Mali", mémoire de DEA, Université Paris X, Nanterre, Ecole doctorale Connaissance et Culture, année 2002-2003. En lien sur http://www.africanti.org/resultats/....
LOHENTO K., 2003, "Usage des NTIC et médiation des savoirs en milieu rural africain : études de cas au Bénin et au Mali", mémoire de DEA, Université Paris X, Nanterre, Ecole doctorale Connaissance et Culture, année 2002-2003. En lien sur http://www.africanti.org/resultats/....
![]() MERSADIER G., 2001, Télécentres connectés et développement local en milieu rural africain, situation et perspectives, juillet 2001, http://www.inter-reseau.org/passdev.
MERSADIER G., 2001, Télécentres connectés et développement local en milieu rural africain, situation et perspectives, juillet 2001, http://www.inter-reseau.org/passdev.
![]() MINGES M., 2000, « Counting the Net : Internet Access Indicators », in http://www.isoc.org/isoc/conference...
MINGES M., 2000, « Counting the Net : Internet Access Indicators », in http://www.isoc.org/isoc/conference...
![]() NDIAYE A.,2002 , « Les entreprises sénégalaises face aux nouvelles technologies de l’information et de la communication » in DIOP M. C. (dir), Le Sénégal à l’heure de l’information., Paris Karthala-UNRISD, p 121-142.
NDIAYE A.,2002 , « Les entreprises sénégalaises face aux nouvelles technologies de l’information et de la communication » in DIOP M. C. (dir), Le Sénégal à l’heure de l’information., Paris Karthala-UNRISD, p 121-142.
![]() OUEDRAOGO S., 2002, « Les réseaux et associations de développement dans la dynamique de l’appropriation des Technologies de l’Information et de la Communication : Analyse de la situation au Burkina Faso ». Rapport Yam Pukri 2002.
OUEDRAOGO S., 2002, « Les réseaux et associations de développement dans la dynamique de l’appropriation des Technologies de l’Information et de la Communication : Analyse de la situation au Burkina Faso ». Rapport Yam Pukri 2002.
![]() OUEDRAOGO S., 2003, L’ordinateur et le Djembé, l’Harmattan-IICD.
OUEDRAOGO S., 2003, L’ordinateur et le Djembé, l’Harmattan-IICD.
![]() PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, 2001, "Mettre les nouvelles technologies au service du développement humain", rapport sur le développement humain.
PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, 2001, "Mettre les nouvelles technologies au service du développement humain", rapport sur le développement humain.
![]() RIST G., "Les mots du pouvoir, sens et non sens de la rhétorique internationale", Gilbert Rist (dir), Enjeux, Cahier 13 de l’IUED, Genève.
RIST G., "Les mots du pouvoir, sens et non sens de la rhétorique internationale", Gilbert Rist (dir), Enjeux, Cahier 13 de l’IUED, Genève.
![]() THIOUNE R., M., 2003, « Technologies de l’information et de la communication pour le développement en Afrique », volume 1, Potentialités et défis pour le développement communautaire, Centre de recherche pour le développement international (CRDI) et Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA). 120p.
THIOUNE R., M., 2003, « Technologies de l’information et de la communication pour le développement en Afrique », volume 1, Potentialités et défis pour le développement communautaire, Centre de recherche pour le développement international (CRDI) et Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA). 120p.
![]() TRAORE A., 2001, L’étau, l’Afrique dans un monde sans frontières Actes Sud.
TRAORE A., 2001, L’étau, l’Afrique dans un monde sans frontières Actes Sud.
![]() TRAORE A., 2002, Le viol de l’imaginaire Fayard.
TRAORE A., 2002, Le viol de l’imaginaire Fayard.
©© Vecam, article sous licence creative common
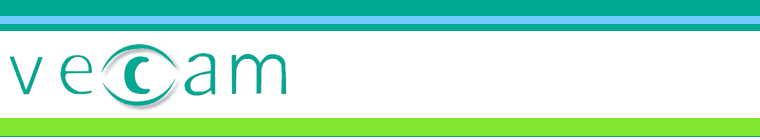

 Réflexion et propositions
Réflexion et propositions Articles / Publications
Articles / Publications Imprimer la page
Imprimer la page
