Petit instantané interrogatif à moins d’un an du sommet
Cet article est une contribution aux Rencontres d’Autrans 2003.
Le sommet mondial de la société de l’information : anachronisme ou temps nécessaire ?
Obtenir des Nations Unies la tenue d’un sommet mondial sur la société de l’information n’a pas été une mince affaire. Il a fallu plusieurs années de démarches actives de différents acteurs (1) pour que le principe en soit adopté. À l’époque (2000), cette initiative avait été saluée comme un pas positif : les enjeux liés aux technologies de l’information et de la communication sortaient enfin de leur starisation économique et de leur clandestinité politique pour prendre place aux côtés des grandes questions abordées dans les précédents sommets de l’ONU (démographie, écologie, genre…).
Qu’en est-il, plus de deux ans plus tard, et moins d’un an avant la première grande étape de ce sommet ? La net économie a fait long feu, les poids lourds du monde des télécoms ne comptent plus leurs pertes, les marchés hier mirobolants sont regardés avec circonspection par les entreprises… Bref l’enthousiasme n’est plus de mise et les acteurs économiques prêts à s’investir dans un sommet, qui constitue avant tout pour eux une affaire d’image, ne sont plus si nombreux. Quant aux gouvernements, ce sommet occupe une bien piètre échelle dans leur agenda diplomatique (que pèse-il dans un contexte de préparation de guerre ?), et pour nombre d’entre eux, il s’agit d’un thème qui n’appelle peu ou pas intervention de la puissance publique, si ce n’est pour déréguler les quelques marchés encore trop contraints à leurs yeux. Les quelques ONG - bien trop peu nombreuses - mobilisées autour du sommet n’en attendent pas grand-chose. Elles tentent pour le moins d’éviter qu’il soit motif à régression dans des champs prioritaires que sont ceux des droits individuels et collectifs ou de la solidarité internationale. Seul l’UNESCO, en lançant un débat en ligne tout au long du 9 décembre et jusqu’au 15 janvier, a su allier l’acte à la parole : en mobilisant les TIC pour nourrir le débat public à l’échelle internationale, l’institution ne se contente pas de " parler sur " mais cherche à expérimenter tout en débattant. Dommage que cette initiative demeure isolée.
Bref à jour J- 333, qui a entendu parler de ce sommet en dehors de quelques cercles restreints ? Et quels acteurs s’engagent vraiment dans cette discussion ?
Qu’on ne se trompe pas à l’analyse de ces constats bien pessimistes. Le principe du sommet reste nécessaire, si ce n’est le sommet lui-même. En effet, la communauté internationale a besoin, plus que jamais, de s’approprier collectivement les grands enjeux liés à la révolution informationnelle et d’en faire un objet de puissance publique. Une fois dissipées les fumées spéculatives de la seconde moitié des années 90, les questions de fond demeurent : comment les technologies interagissent-elles avec nos manières de " faire société " ? Contribuent-elles à d’autres modes d’organisation collective, au sein de l’espace public local, national, international - comme au sein de l’entreprise, de l’association, du mouvement civique et social ? Participent-elles à l’émergence de nouveaux modes de production économique, nous conduisant à repenser des pans entiers de nos systèmes juridiques ? Peuvent-elles servir de leviers à la mise en place de sociétés plus solidaires, plus créatives et plus ouvertes ? Peuvent-elles contribuer à des modèles de développement dans les pays du Sud, respectueux des besoins des populations et de la diversité culturelle ?
Bien entendu ni un ni dix sommets ne peuvent apporter des réponses à ces questions de fond. Mais un sommet peut ouvrir des espaces de débat public jusqu’ici confinés à quelques cercles restreints, éviter que des choix essentiels ne soit faits dans l’ombre au nom de l’expertise et de la technicité et aider à penser la transversalité : de tout temps la technique a interagi (de façon non déterministe, pour le meilleur et pour le pire) avec nos sociétés, c’est le carré " science-technique-politique-société " dont il nous faut nous emparer à l’occasion de ce sommet. N’attendons pas que nous soit tendu le miroir réel ou fantasmé du clone pour nous poser ces questions fondamentales de la maîtrise de la science et de la technique au service du développement humain.
Si ce besoin de débat est nécessaire à l’échelle planétaire, il n’en demeure pas moins indispensable dans l’espace national. Les acteurs français traitant de l’un ou l’autre aspect de la révolution informationnelle sont encore trop peu nombreux, trop éclatés ou cloisonnés. Le sommet peut à tout le moins constituer une occasion de créer un espace de débat entre ces " familles " qui pensent et agissent autour des enjeux sociaux, économiques et politiques des technologies de l’information.
Configuration du sommet : mais qui donc veut innover ?
La configuration annoncée du sommet a dès le départ suscité bien des espoirs : pour la première fois dans l’histoire des Nations Unies, ce sommet serait un espace de travail non pas purement intergouvernemental mais tripartite, c’est-à-dire associant dès le départ aux côtés des gouvernements, des représentants du secteur privé et des acteurs de la société civile. Le secrétariat chargé de la préparation du sommet est lui-même tripartite.
Après cet effet d’annonce qu’en est-il ?
Le premier Prepcom (comité préparatoire du sommet) en Juillet 2002 a été de ce point de vue plus qu’une déception. Les questions de procédures qui devaient occuper la première journée de débat en ont occupé 3, certains pays, le Pakistan étant le plus virulent, refusant toute participation des acteurs de la société civile. Un compromis a permis de maintenir le principe d’un sommet ouvert, mais le ton était donné : la société civile était tolérée…
Second problème : la place des acteurs du secteur privé. Les procédures ONUsiennes prévoient que les entreprises sont représentées par le biais de leurs associations professionnelles. Le sommet de la société de l’information fait exception à la règle : les entreprises participent à titre individuel au " collège " secteur privé, ce qui ne les empêche pas de se faire représenter à travers leurs associations professionnelles, présentes au titre de… la société civile.
Troisième difficulté : la dite société civile sert de fourre tout, dans lequel sont censés travailler de concert des acteurs aux cultures et aux sources de légitimité aussi différentes que des ONGs, des universitaires, des médias… ou des élus de collectivités locales et de Parlements ! Il n’est pas évident de transformer en force cette diversité.
Quatrième problème, très concret : si les séances plénières sont ouvertes à qui veut, les débats réels ont été menés derrières les portes closes de 2 sous-comités (l’un chargé des procédures, l’autre des contenus), réservés aux gouvernements. Les acteurs de la société civile, présents dans l’édifice voisin, n’ont plus alors qu’à courir derrière les papiers produits par ces deux sous comités pour y proposer des amendements, amendements voués à ne pas être pris en compte, puisque le temps que ceux-ci soient rédigés et transmis, d’autres textes intergouvernementaux sortaient. Aucun mécanisme d’interaction entre le travail des gouvernements et celui des acteurs de la société civile n’avait été prévu, pensé, construit.
Enfin cinquième et non moindre problème : l’absence de moyens matériels pour permettre aux acteurs de la société civile, en particulier à ceux des pays du sud de venir aux Prepcom, de travailler à distance, de nourrir leurs sites web etc.
Depuis les choses n’ont pas été en s’améliorant : la conférence régionale européenne de Bucarest a livré une déclaration négociée pendant les 6 mois précédents entre les chancelleries et qui débute par " The Member States of the United Nations Economic Commission for Europe met in Bucharest at the Pan-European Conference on the Information Society (7-9 November 2002) and agreed on the following set of principles and priorities… " : l’approche " multistakeholder "(2) selon le jargon ONUsien n’est même plus de mise, même dans les apparences. Quant à la préparation du Prepcom 2 qui doit se tenir à Genève en février prochain, elle a fait l’objet d’une réunion de préparation " semi clandestine " en décembre dernier, réunion à laquelle participaient les membres " société civile " du secrétariat. Ces derniers n’ont pas jugé bon ou n’ont pas été autorisés (? ?) à donner un quelconque écho de cette réunion aux acteurs de la société civile, ni sur la liste de diffusion ni sur le site web qu’ils animent.
On est donc loin du processus ouvert et transparent tant annoncé ! Mais finalement est-ce donc si grave ? Et qui a véritablement intérêt à modifier ce système ?
Le consensus tacite
En réalité nous sommes pour l’instant revenus au fonctionnement classique de ce genre de manifestations, et dont Johannesburg a été une récente caricature : les experts sont consultés, les chancelleries négocient, les chefs d’État déclarent devant les médias, les entreprises se payent des lobbyistes, les ONG expriment leur mécontentement… Ces dernières vont logiquement être conduites à penser un contre/autre sommet (qui le cas échéant sera certainement relégué dans un autre bâtiment le plus loin possible du lieu où se réunissent les gouvernements) et pourront dire sans mentir qu’elles n’ont pas été écoutées…
Bref tout est bien en terre de démocratie représentative, où chacun occupe sa place de pouvoir et de contre-pouvoir : les gouvernements légitimement élus décident, les entreprises économiquement nanties influencent chaque jour un peu plus et la société civile pauvre financièrement, mais riche en capacité de mobilisation, crée du rapport de force. Contrairement aux idées reçues, ce schéma n’est pas seulement défendu par les acteurs apparemment dominant du système - gouvernements et entreprises -, mais également par grand nombre d’ONG et d’associations, y compris celles qui crient haut et fort que la " société civile n’est pas consultée ".
En réalité, ce qui se joue là n’est ni plus ni moins que l’invention d’un autre mode démocratique pensé pour l’espace international et à l’heure de la société en réseaux. Tout le monde s’accorde pour parler de crise de la démocratie représentative dans les pays occidentaux et de no man’s land démocratique quand il s’agit de l’espace international. L’idée d’un renouvellement démocratique par le biais de formes de démocratie participative fait son chemin dans l’espace local, mais la scène internationale n’arrive pas à s’inventer les formes de sa " gouvernance démocratique ". Les seuls schémas proposés comme alternative à l’intergouvernemental pur sont une projection, ou une translation dans l’espace supranational, de modèles inspirés de l’Etat-nation. De même que les pères fondateurs de l’Europe ont fait un formidable effort d’imaginaire politique pour penser les institutions de ce qui allait devenir l’Union européenne, n’avons-nous pas besoin d’un même effort pour inventer la démocratie planétaire ?
Certes on a vu fleurir ces dernières années dans différents espaces le débat sur la gouvernance, débat le plus souvent biaisé à sa racine du point de vue des acteurs de la société civile. Les exemples sont nombreux de " consultations " qui relevaient plus de la gesticulation médiatique que d’un véritable processus d’écoute réciproque.
Par ailleurs le terme même de gouvernance porte une histoire ambiguë. Le terme, d’abord utilisé dans le champs bien précis de la " gouvernance d’entreprise ", a commencé à se répandre dans les années 90, accolé au qualificatif " bonne ", sous l’impulsion conjointe des différentes institutions financières internationales (FMI, Banque mondiale…) avec pour objectif d’amener les pays dits du Sud à adopter des " bonnes pratiques " dans la conduite de politiques publiques à l’échelle nationale : réformer leurs structures étatiques, dans un sens susceptible de favoriser les implantations des entreprises multinationales et d’attirer les investisseurs internationaux. Concrètement la bonne gouvernance rime avec un État de droit conçu essentiellement de manière à sécuriser les échanges commerciaux, une dénationalisation des entreprises publiques, une décentralisation des pouvoirs publics en général non accompagnée de transferts financiers, un abandon des instruments traditionnels de puissance publiques au nom du libéralisme. Bref la " bonne " gouvernance a d’abord été le nouveau porte drapeau des politiques néo-libérales imposées au Sud par les institutions de Bretton-Woods.
Depuis le mot a fait son chemin, a échappé en quelque sorte aux intentions premières de ses promoteurs et a recouvert progressivement l’ensemble des débats sur la manière dont on tente de gouverner le monde, notamment en matière économique. Le débat sur la gouvernance mondiale a ainsi progressivement relayé celui sur la mondialisation en tant que telle. Aujourd’hui, le néologisme traverse différents territoires, et vient interroger nos pratiques de politiques publiques aussi bien dans la ville que dans les ensembles régionaux - voir le débat sur la gouvernance européenne -. Parce que dans gouvernance il y a gouverner, le mot nous ramène immanquablement à l’art de diriger les affaires publiques, de conduire les intérêts communs, bref à la question de l’exercice du pouvoir. Et si le terme fait florès, c’est parce que l’une des questions essentielles à laquelle l’humanité est confrontée est bien celle-ci : comment construire un nouveau rapport au pouvoir ?
Il n’en demeure pas moins que cette histoire du mot pèse, on peut le comprendre, dans la perception qu’en ont grand nombre d’acteurs, pays du sud, ONG.... Elle met le doigt sur une vraie question qui traverse les débats des collectivités locales, des associations, des mouvements sociaux en ce moment. Nombreux sont les acteurs qui dénoncent, à juste titre nous semble-t-il, le recul du rôle de l’État au profit du secteur privé, la perte de puissance publique, bref le recul de l’intérêt général au profit des intérêts économiques particuliers. De là, l’impossibilité d’ouvrir ce qui apparaîtrait rapidement comme la boîte de Pandore, c’est-à-dire relativiser la légitimité de l’État-Nation au profit d’autres sources de légitimité. Par exemple, comment simultanément réclamer plus de service public pour répondre aux besoins des gens et promouvoir une diversification des responsabilités dans la manière dont sont pensés et construits ces mêmes services publics ? Comment penser une démocratie plus participative sans pour autant déshabiller une démocratie représentative déjà bien mal en point ? C’est à ces questions fondamentales, que se heurtent bon nombre d’acteurs, qui à tout prendre donnent la priorité au choix dont les effets sont directement mesurables dans la vie des gens. On sait bien mesurer le coût social de politiques ultra libérales (l’histoire s’est chargée de nous l’apprendre), on n’évalue pas ou mal le coût collectif de l’inaction démocratique internationale.
Comment sortir de cette impasse ? Tout d’abord, il nous faut prendre ce débat à bras le corps, ne pas le négliger parce qu’il nous dérange. Si la conclusion doit en être une réaffirmation du modèle pouvoir/contre pouvoir, assumons le purement et simplement, sans chercher à prétendre à un autre modèle que le rapport de force mâtiné de dialogue.
Mais si, comme je le crois, nous ne pouvons accepter que des gouvernements, chaque jour un peu plus débordés par des problèmes d’une complexité unique dans l’histoire de l’humanité, s’en remettent aux simples lois du marché et de la diplomatie guerrière, il nous faut inventer ensemble les nouvelles procédures démocratiques.
Ceci peut sembler bien loin du sommet mondial de la société de l’information et pourtant nous sommes en réalité au cœur des enjeux qui devraient constituer le haut de son agenda.
Si les sociétés en réseaux sont le vecteur de nouvelles formes d’organisation du pouvoir - dans l’entreprise, dans l’institution, dans l’association - n’y lisons pas le produit d’évolutions technologiques mais déchiffrons-y les signes d’une maturation de nos sociétés politiques.
Deux premiers " marqueurs " de la société en réseaux nous confirment dans cette intuition :
![]() Les savoirs - l’une des dimensions structurantes du pouvoir - sont diffus, circulables et partageables.
Les savoirs - l’une des dimensions structurantes du pouvoir - sont diffus, circulables et partageables.
![]() Les processus créatifs sont de plus en plus le fruit de démarches coopératives, le logiciel libre en étant le référent.
Les processus créatifs sont de plus en plus le fruit de démarches coopératives, le logiciel libre en étant le référent.
Au sein de la société civile, consciemment ou inconsciemment, on assiste à un déplacement des modes d’organisation pour à la fois intégrer et tirer parti de ces transformations de l’ère informationnelle : positionnement de différents mouvements dans le champ de la contre-expertise citoyenne (3) , apparition de novelles fonctions militantes liées à la production et la circulation de l’information (4) , usage massif des TIC dans les mouvement internationaux (5) , organisation d’une réflexion collective et interculturelle à l’échelle internationale (6) , mobilisation des médias pour l’ouverture d’espace de dialogue inédits entre acteurs " adversaires " (7) , expérimentations de nouvelles formes démocratiques locales (8) …
Tirons parti de ces expériences pour aborder de front la question démocratique. Espérons que les espaces de discussion ouverts par certaines associations (Vecam participe au débat lancé par I3C en France …) ou par les villes (voir entre autres les rencontres de Bilbao et de Lyon) permettront d’avancer sur ces points (9).
En conclusion je dirais que l’échec annoncé du sommet n’est pas grave si nous utilisons le processus préparatoire du sommet pour en faire une occasion collective d’ouvrir de nouveaux espaces d’imaginaire politique.
(1) On notera en particulier les efforts patients de la Fondation du devenir
(2) Multipartenariale, ou tripartite - gouvernements, secteur privé, société civile -
(3) Le mouvement anti-AMI (Accord multilatéral sur l’investissement), considéré comme le point de départ des mouvements alter mondialistes, s’est situé résolument sur ce terrain de la contre-expertise et de la pédagogie.
(4) Cf. Fabien Granjon, " l’internet militant ", Éd. Apogées.
(5) L’organisation du forum social mondial en est l’exemple le plus fort.
(6) Cf. les cahiers de propositions de l’alliance pour un monde responsable et solidaire,
(7) Cf. The bridge initiative on globalisation
(8) Cf. Villes-Internet et l’ADELS/Territoire
(9) Pour une liste des initiatives, voir le référencement sur le site de cyber-institut
Voir la réaction de Claude Combes
©© Vecam, article sous licence creative common
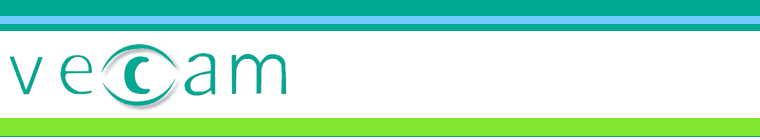

 Réflexion et propositions
Réflexion et propositions Articles / Publications
Articles / Publications Imprimer la page
Imprimer la page