22 - Histoire des communs : l’ombre portée de la Grande Charte
Ce texte suivant est une reprise autorisée par l’auteur de l’introduction du livre The Magna Carta Manifesto : Liberties and commons for All, University of California Press, 2008. Traduit de l’anglais par Laurent Vannini
« [La bourgeoisie] a fait de la dignité personnelle une simple valeur d’échange ; elle a substitué aux nombreuses libertés, si chèrement conquises, l’unique et impitoyable liberté du commerce. » Karl Marx, Le Manifeste du Parti Communiste (1848), trad. Laura Lafargue.
Lors de la révolte des indigènes de la jungle de Lancandona, qui s’imposa à la face du monde en 1994, son porte-parole, le Sous-Commandant Marcos, fit référence à la Grande Charte dans un communiqué. C’était donc la célèbre révolte postmoderne du Mexique citant une source complexe de l’Angleterre pré-moderne de 1215 : voici l’origine de mon livre The Magna Carta Manifesto : Liberties and commons for All. Le présent texte en reprend l’introduction. Bien évidemment, ce livre trouve son origine dans la situation d’urgence qu’imposent les agressions autocratiques du régime de Bush, mais ce qui m’a décidé à poser la plume sur le papier renvoie à une erreur d’interprétation, ou plutôt à une absence de traduction. Au Mexique, tout le monde appelle la constitution mexicaine la Grande Charte (Magna Carta). L’erreur sémantique révèle cependant une vérité profonde : la référence à la Grande Charte navigue entre les deux vents dont parle Marcos, le vent du dessus – les forces de ceux qui font les lois – et le vent du dessous – celles des indigènes, des paysans, des travailleurs. Marcos explique comment le vent du dessus pompe 92 000 barils de pétrole, laissant derrière lui « destructions écologiques, pillages agricoles, hyperinflation, alcoolisme, prostitution et pauvreté », pendant que le vent du dessous oblige les paysans d’Ococingo à couper du bois pour survivre [322]. L’ejido, les communs villageois, ont été détruits et leur protection légale, l’Article 27 de la constitution mexicaine, abrogée.
La même histoire se répète partout dans le monde :
— Nigéria : au cours de l’été 2003, des centaines de femmes ont occupé le terminal pétrolier de Chevron au lieu-dit des Escravos (escravos signifie « esclaves » en portugais). L’Amérique du nord envisage d’importer depuis l’Afrique 25 pour cent de sa consommation de pétrole. Les ingénieurs de Chevron ont élargi la rivière Escravos dans le Golfe du Bénin, avec pour conséquence la destruction des mangroves du village d’Ugborodo. Les femmes ne pouvaient plus ramasser le bois pour cuisiner, ni l’eau pour boire. La prostitution devenait « le seul job décemment payé pour les femmes » [323]. Les forêts, le bois, les mangroves sont détruits, remplacés par le propane, l’essence, le kérosène. Et c’est au nom de ce progrès que les habitants sont expropriés.
— Vietnam : dans les hameaux de montagne, les femmes ramassent dans la forêt le bois de chauffage, les pousses de bambou, les plantes médicinales et les légumes. Ce qu’elles ne consomment pas directement est vendu sur les marchés locaux. Les hautes herbes deviennent du charbon de bois à Trang Ti. Le riz et le manioc, aliments de base, sont cultivés sur les brûlis (des terres nettoyées en fauchant et brûlant le couvert végétal). Un large éventail d’animaux domestiques fournit les protéines. Les réserves des forêts ont été récemment encloses de barrières métalliques. Et ce sont les femmes des hameaux qui en pâtissent le plus [324].
— New York : pour les communautés d’Indiens iroquois et de Canadiens français vivant dans les Adirondacks, le mouvement de conservation des espaces naturels des années 1880 a signifié « la transformation de pratiques considérées comme acceptables en actes illégaux : chasser ou pêcher ont été redéfinis comme du braconnage, la cueillette est devenue une intrusion, faire du feu une activité criminelle et couper des arbres réduit à du vol de bois ». Dans leurs rapports, les agents fédéraux s’étonnent de voir les habitants considérer « les forêts comme une ressource en commun », une niche naturelle « dans lesquelles chacun pouvait se nourrir de ce qu’il trouvait ». La Commission des Forêts « a décidé de semer la terreur, et le fit, envers les gens qui se comporteraient ainsi » [325]
— Irlande : au XVIIe siècle, l’expropriation des plantations, l’extension de la colonisation et la pression démographique détruisirent l’ordre gaélique et mirent la lande à nu. Les Irlandais se lamentaient [326] : « Qu’allons-nous devenir sans les arbres Maintenant que nos dernières forêts sont parties ? » Les forêts étaient le lieu même des visions, de l’aisling et de la fiana, et l’ultime protection des résistants de l’Irlande. C’est pourquoi les conquérants les ont mises à bas. La complainte est significative des débuts de l’histoire moderne, quand le bois était aussi important que ne le furent ensuite le charbon et le pétrole. Trois matériaux correspondant à trois âges historiques, tout du moins si vous divisez l’histoire en fonction des types de ressources énergétiques utilisés.
— Inde : Akbar le Grand considérait la déforestation comme un des succès de son avancée dans le Cachemire. Le gouvernement colonial britannique s’est empressé de mettre la main sur les dharma khandams, ou terres communales afin d’affirmer son contrôle sur les sources de bois de chauffage, sur les feuilles servant au compost et sur le bois de service utilisé en agriculture [327]. Une augmentation très nette des vols de bois a précédé la grande révolte nationale de 1919-1920. Un chant nationaliste de l’époque demandait : « Il y a trois cents ans L’homme des Compagnies arrivait. Il fallait se tenir coi. Il a volé tout le pays. Dit que les forêts lui appartenaient. Est-ce que son père est venu les planter ? »
— Amazonie : depuis les années soixante, toute la région est soumise à un énorme mouvement d’enclosure. Les bulldozers et les scies à chaînes mènent le bal. Les travailleurs et les Indiens résistent. En 1976 ils sont venus avec l’empate – ou l’impasse [328]. Cette lutte est ancienne. Le professeur de Chico Mendes, leader du syndicat des seringueros (les ramasseurs de caoutchouc), travaillait déjà avec Carlos Prestes, le révolutionnaire des années vingt et trente. Cette lutte est ancienne et transatlantique : le Manifeste des Habitants de la Forêt Amazonienne de 1985 a été comparé à celui de Winstanley et de ses Diggers, qui défendaient le statut de communs des forêts anglaises au XVIIe siècle.
Trois tendances émergent de toutes ces histoires. D’abord, dans la période récente d’enclosure, c’est le profit qui est le moteur principal de la destruction des forêts [329]. En second lieu, le pétrole et ses dérivés sont devenus l’élément de base de l’activité humaine et du développement économique mondial. Et enfin, les peuples indigènes du monde entier, tous usagers des communs, sont partout expropriés. Michael Watts a forgé le vocable « pétro-violence » pour désigner la terreur, la désintégration, la dispersion, la pauvreté et la pollution qui accompagnent l’extraction du pétrole [330]. Tendances accentuées par la guerre. En Irak, la pétro-violence autour des champs de pétrole de Bassorah a eu raison de l’écologie communautaire des « peuples des roseaux », ceux qu’on appelait les « Arabes des marais ».
C’est pour éclairer cette exclusion mondiale qui accompagne la destruction des communs que j’ai écrit le livre The Magna Carta Manifesto : Liberties and commons for all. Ce livre commente et précise la longue lutte qui a commencé dans l’Angleterre du XIIIe siècle, et dont la rédaction de la Grande Charte en 1215 constitue un tournant essentiel. Dans ce livre, j’utilise quatre interprétations de la Grande Charte : documentaire, légale, culturelle et constitutionnelle.
L’approche documentaire me conduit à compléter la Charte de 1215 avec des éléments importants comme le « droit des veuves », ou l’intégralité de la Charte des Forêts. On y trouve l’émergence du concept des communs, compris comme une ancre d’espoir dans la tempête. Une telle approche permet de comprendre que les deux textes de la Grande Charte et la Charte des Forêts sont inséparables, comme le confirment les changements apportés au fil des ans, notamment ceux du 11 septembre de l’année 1217.
La descendance légale de la Grande Charte est incomparable. On la retrouve aux États-Unis sous la forme de l’habeas corpus, des jurys lors des procès criminels, de l’interdiction de la torture, et du respect de la légalité des actes, autant de règles juridiques qui dérivent du texte fondateur de la Grande Charte.
On retrouve aussi des traces de la Grande Charte dans la musique, les peintures murales, le théâtre, l’architecture et la sculpture. Parfois, les représentations de ce texte prennent une forme iconique, à la limite de la dévotion due au sacré. Je montre dans le livre combien de telles interprétations culturelles peuvent glisser facilement vers le chauvinisme, le mythe de la supériorité raciale.
Enfin, la Grande Charte a une histoire constitutionnelle, qui découle de sa naissance. Elle est une forme d’armistice entre pouvoirs belligérants, le Roi et ses Barons ; et sa signature mettait fin à une rébellion. La Grande Charte conclut un accord entre l’Église et l’État, le Roi et les Barons, les villes mercantiles et les redevances et impôts, les épouses et leurs maris, les usagers des communs et les nobles. Elle est le fier produit d’une révolte. La Déclaration d’Indépendance des États-Unis, en 1776, a été écrite sur la suggestion de Thomas Paine d’avoir une Grande Charte américaine. Le souvenir de la Grande Charte n’est pas éteint en Grande-Bretagne, et quand en mai 2006 le journal The Guardian lançait un sondage pour désigner une fête nationale, c’est le jour de la signature de la Grande Charte qui emporta les suffrages des Anglais [331].
Si nous voulons considérer l’impact de la Grande Charte dans son intégralité, nous devons prendre en compte ces quatre interprétations. La première incite à l’abolition des formes de richesse qui détruisent l’accès aux communs. L’interprétation légale nous offre protection contre les tentatives de privatisation et les intrusions des autocrates et des militaristes. L’approche culturelle nous permet de dénoncer les fausses idoles et le regard constitutionnel renouvelle le contenu du droit à la résistance. En 1620, c’est en commentant les textes des deux chartes (La Grande Charte et la Charte des Forêts) qu’Edward Coke, Président de la « Chambre des Communes » et procureur général d’Angleterre a ouvert la voie à la Révolution anglaise de 1640. En 1759, William Blackstone, le grand professeur de droit d’Oxford, a réalisé une étude de la Grande Charte qui a servi à préparer les esprits pour la Révolution américaine des années 1770. Pour eux, les deux « Grandes Chartes des Libertés en Angleterre » constituaient un instrument légal unifié, qu’il nous importe de considérer ainsi.
Plutôt que de suivre la ligne de séparation entre les droits économiques et sociaux d’une part et les droits civils et politiques de l’autre, comme cela se fait couramment dans le système des Droits de l’Homme de l’ONU, avec la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme édictée en 1948 d’un côté, et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 de l’autre, la Grande Charte des Libertés nous permet d’approcher les droits politiques en mettant en parallèle la restriction des comportements autocratiques et la défense des droits sur les communs, en autorisant l’usufruit de subsistance sur les biens et les usages nécessaires à une vie décente. Par exemple, les Chartes limitent le droit d’exclure les pauvres de la récolte du miel, qui était à l’époque le produit sucrant le plus répandu (« Tout homme libre peut récolter le miel trouvé dans ses bois » – Article 13 de la Charte des Forêts).
Nous étions au XIIIe siècle. Au dix-neuvième, en Inde, la Loi des Forêts (1878) a été contestée car « les pouvoirs qui seraient concédés à la police étaient arbitraires et dangereux, permettant d’arrêter sans garantie tout personne suspectée d’avoir, à une époque indéterminée, commis une infraction dans les forêts, comme de prendre du miel d’abeilles sauvages ou la peau d’un animal mort » [332]. Au XXe siècle, le paysan kenyan Karai Njama, figure de l’indépendance, se souvient de l’expropriation des familles : « Un jour que j’étais assis sur le seuil de la maison, mon Grand-Père me désigna une petite colline perdue dans la forêt, aux confluents des rivières Gura et Charangatha et me demanda : ‘Vois-tu cette colline ?’, ‘Oui grand-père’, ‘C’est là-bas que j’allais chasser avant l’arrivée des Chomba, les Européens. Cette colline s’appelle toujours la Colline de Karari. Si tu y vas, tu pourras retrouver les gamelles dans mon abri. J’avais beaucoup de ruches dans cette forêt, qui me fournissaient du miel en quantité… Oh, mes chères ruches sont en train de pourrir là-bas ».
Dans la plainte du grand-père de Njama, nous sommes très loin d’entendre la fameuse « tragédie des communs » qui servit de titre à l’article du sociobiologiste américain Garrett Hardin (1915-2003). Les arguments biologiques et mathématiques de ce dernier le menait à conclure « La liberté dans les communs conduit à la ruine de tous », et qu’en conséquence, « l’injustice est préférable à la ruine totale ». Les hypothèses de Hardin reposaient sur l’égoïsme absolu et niaient plusieurs millénaires d’expérience dans la négociation et la mutualisation qui avaient réellement cours dans les communs [333]. Pour le reste, nous entendons surtout le cri des victimes d’un grand brigandage.
Le Prix Nobel de la Paix 2004 a été attribué à la Kenyane Wangari Maathai, dirigeante du mouvement écologiste Green Belt (la ceinture verte) qui a replanté plus de trente millions d’arbres pour assurer la subsistance (bois pour le chauffage, les barrières ou la construction) et l’équilibre écologique, afin que le Kenya ne devienne pas un désert desséché. L’esprit de son action est résumé dans le mot harambee, qui signifie à peu près « restons tous ensemble ! ». Auprès de chaque arbre planté, les communautés locales s’engageaient à défendre pour les générations futures « la générosité que nous avons reçue en naissant et qui est la propriété de tous » [334].
La dépossession du miel, comme celle de la sécurité, la réduction des capacités à vivre de la forêt et la destruction des libertés sont partout allées de pair. Tout comme les droits à la subsistance vont de pair avec les droits civils qui nous protègent de l’arbitraire d’un emprisonnement sans procès.
Le sous-commandant Marcos nous incite à nous souvenir de l’ejido dans la constitution mexicaine quand nous luttons contre le néolibéralisme. Ce message venu du fond de la forêt vierge de Lancandona m’a conduit à me demander : que nous inspire aujourd’hui la Grande Charte ? Alors que je réfléchissais à cela en été 2001, le mouvement mondial forgeait ses nouveaux slogans : « Le monde n’est pas une marchandise » et « Réparation ! » étaient prononcés par les manifestants de Gênes en Italie, suite à la mort de Carlos Guiliani lors de la marche contre le G8. Cet été-là, les États-Unis se sont retirés de la conférence de l’ONU sur le racisme de Durban, en Afrique du Sud. Une semaine après deux avions piratés se jetaient sur les tours du World Trade Center et le Pentagone. Le Président Bush déclarait une « guerre sans fin à la terreur », qu’il comparait avec la Seconde Guerre Mondiale, même si en résumant ses objectifs en quatre libertés, il a oublié de mentionner la liberté de ne plus être dans le besoin et la liberté de ne plus vivre dans la peur.
En même temps que l’assaut militaire contre la Mésopotamie de 2003, s’installait en Irak l’ordre néolibéral : marché libre, droit illimité au profit et l’infâme Ordre n° 39 qui privatisait toutes les entreprises publiques du pays. En même temps que se mettait en place cette infamie, ce sont aussi les libertés civiles héritées du chapitre 39 de la Grande Charte qui disparaissaient, notamment l’habeas corpus, le droit à un jury et l’abolition de la torture, toutes règles de droits englouties à Guantánamo.
Le Président Bush n’est pas le seul à avoir oublié les leçons de l’histoire. Nous autres historiens de l’Angleterre n’avons pas fait notre travail. Autant les historiens néoconservateurs que les historiens féministes, les théoriciens du droit, les historiens de la société et de l’économie, nous avons tous été négligents, ignorant la Grande Charte, ouvrant ainsi le terrain à l’oubli. Tout comme nous avons laissé de côté les règles sur les communs contenus dans la Charte des Libertés, les considérant comme des reliques féodales dépassées. L’argument central de mon livre est au contraire de dire que leur temps est venu.
Le néolibéralisme est une doctrine économique de la globalisation et de la privatisation qui s’appuie sur des régimes sécuritaires et policiers. Il est devenu majoritaire quand Margaret Thatcher et Ronald Reagan vinrent au pouvoir en 1979 et 1980. Accompagnant la privatisation et la propagande néolibérale, se sont installé aussi leur pendant idéologique, le néoconservatisme, qui nourrit la police et le militarisme. L’esthétique dominante de la période fut le postmodernisme, un style caractérisé par l’ironie, l’éclectisme, la vitesse, une subjectivité épistémologique qui le rendait compatible avec une « politique de l’identité », et le refus de voir une unité dans l’histoire. Ce sont ainsi les principales ruptures des années 90 – les migrations planétaires, les nouvelles enclosures, la féminisation de la pauvreté, le développement du travail précaire et le nouvel esclavagisme – qui ont été accompagnées par la politique économique du néolibéralisme et la politique culturelle du postmodernisme. Margaret Thatcher le résumait simplement : « There is no alternative ». La Grande Charte ne pouvait alors qu’être un élément archaïque dans une « grande narration » dépassée. Pourtant, néolibéralisme et postmodernisme ont connu un point de retournement en 1999, quand à Seattle divers mouvements ont mis en cause le chapitre sur la propriété intellectuelle dans les débats de l’Organisation Mondiale du Commerce.
Pour un historien universitaire des États-Unis, ce contexte économique et culturel se retrouve dans le rapport Stansky, du nom du Président du comité chargé de rédiger un « État de l’Art et Perspectives des Études Historiques Anglaises aux États-Unis ». Publié en 1999, ce rapport, par ses recommandations comme par ses omissions, porte la marque du néolibéralisme et du postmodernisme. D’un côté il défend la place des Études historiques anglaises alors qu’elles voient leur cote d’amour diminuer au sein des universités américaines. D’un autre côté il fait référence au snobisme pro-anglais des relations entre les deux pays. Après tout, les plus hautes instances du pouvoir aiment à se parer des lustres de l’Angleterre : un président anobli à Buckingham Palace, un autre qui fut étudiant à Oxford et qui s’est entouré d’universitaires de Rhodes, une République américaine qui se pâme pour une princesse britannique, et deux leaders qui ressemblent vraiment aux chiens courants de l’impérialisme, le pit-bull et le caniche. Le rapport veut montrer que « l’histoire de Grande-Bretagne n’est pas une question concernant simplement une île, mais bien une synthèse de l’histoire du monde ». « Les Études historiques anglaises se sont développées car elles étaient considérées, tant par les étudiants des premiers cycles que par leurs parents, comme une connaissance indispensable, une introduction à toute la tradition occidentale qui ouvrait les portes de la réussite à leurs enfants. C’est le déclin de ces valeurs qui heurte de plein fouet la popularité des Études historiques anglaises. » [335].
Ce concept de la « tradition occidentale » reste largement impensé, et porte avec lui des relents de croisades qui sont sinistres ou stupides [336]. Les « valeurs spécifiques » dont il est question ne sont jamais mentionnées. Lieu de naissance de la démocratie ? Pays de la liberté ? Émergence du droit et de la loi ? Presse libre ? Habeas Corpus ? Procès devant jury ? Tolérance religieuse ? Le Commonwealth ? Oui, nous savons bien combien tout cela fait partie du simulacre politique, et en les entendant nous y reconnaissons les sottises, la fumisterie et le « droit bourgeois ». Mais est-ce une raison pour les ignorer ? Repensons-y. Le déclin de l’habeas corpus, des valeurs de coopération des biens communs, l’érosion du jugement par un jury populaire sont peut-être source d’une baisse de popularité des Études historiques anglaises, mais ce sont avant tout des pertes sèches pour les habitants de la planète.
Il y eu plusieurs moments historiques durant lesquels ces « valeurs spécifiques » on été concrétisées, comme dans les années 1790, quand fut rédigée la Constitution américaine, ou à la fin de la Révolution anglaise lors des Négociations de Putney [337]], ou encore en 1940, quand l’Angleterre seule faisait face à l’impérialisme des nazis. Et de toute évidence, 1215 fait partie de ces moments historiques d’incarnation de ces valeurs. Si nous avions conservé cette capacité à inscrire ces valeurs dans les faits, nous ne détiendrons certainement pas des gens sans jugement, les affamant pour les faire parler, humiliant leurs pratiques religieuses, abusant d’eux dans des chambres de torture ou défendant notre pétrole dans leurs champs en éclairant leurs nuits de nos bombardements.
Notre incapacité à préserver les libertés civiles inscrites dans la Grande Charte m’est apparue clairement quand on m’a raconté l’histoire de Maher Arar, un ingénieur informatique canadien, père de deux enfants, qui s’en revenait de vacances dans sa famille en Syrie, via un aéroport des États-Unis, et qui s’est retrouvé enfermé, sans explications, en septembre 2002, par les autorités américaines, qui l’ont menotté et enchaîné les yeux bandés, puis placé dans une cellule sans lit et sous éclairage permanent, en lui interdisant tout contact avec un avocat ou sa famille, avant de le « renvoyer » en Syrie où il passa douze mois dans une cellule d’un mètre sur deux de large et deux mètres de haut, régulièrement roué de coups avec un câble électrique dénudé. Ce cas constitua la première action civile contre les « restitutions extraordinaires ». En 2005, le gouvernement des États-Unis défendait néanmoins cette technique au nom du « secret d’État ». L’avocat principal du gouvernement lors du procès ne m’étais pas inconnu : j’avais travaillé trente quatre ans plus tôt avec ses parents sur des causes démocratiques telles la réforme des prisons aux lendemains du massacre d’Attica ou le retour à la maison des troupes envoyées au Viêt-Nam, ou encore la défense du syndicat des mineurs du Kentucky.
Nous autres, dans le mouvement sur les prisons, le mouvement pour la paix ou les mouvements de travailleurs luttions contre le racisme et l’exploitation, mais nous ne nous référions jamais à la Grande Charte. Nous n’avons pas transmis la connaissance de l’Habeas Corpus Act de 1679, dont le titre complet, « Une loi pour garantir les libertés des sujets et prévenir les emprisonnements au-delà des mers », pouvait nous renvoyer directement à la pratique honteuse appelée par euphémisme « restitution extraordinaire ». Nous n’étions même pas familiers de la Grande Charte américaine, de la Déclaration d’indépendance de 1776, qui énumérait vingt-sept motifs pour proclamer l’indépendance face à l’Angleterre, dont l’un fustigeait le Roi George III pour avoir laissé passer une loi « pour nous rapatrier d’au-delà des mers afin d’être jugé pour de prétendues offenses ». Nous n’avons pas transmis ce savoir parce que nous ne le possédions pas nous-mêmes, et c’est ainsi que maintenant la pomme est tombée très loin de l’arbre. Mais nos propres erreurs devant l’importance de l’histoire des communs, devant l’importance du droit, ne justifient en rien la situation de Maher Arar et n’affaiblissent en aucun cas la nécessité de voir la justice s’appliquer.
Trois porte-drapeau, sur les deux rives de l’Atlantique, ont néanmoins porté la flamme de la Grande Charte face aux puissants. Le premier est Ian MacDonald, Conseiller de la Reine d’Angleterre, qui a démissionné en décembre 2004 de la Commission spéciale d’appel de l’immigration (Special Immigration Appeals Commission). « Vous enfermez des gens indéfiniment et c’est une dangereuse remise en cause des traditions culturelles du Royaume-Uni. Une tradition qui remonte jusqu’à la Grande Charte »[<338>QC for Detainees Quits over Terror Law, The Guardian, 20 December 2004]]. Le second porte-parole s’est exprimé devant le Parlement Britannique lors du vote du 16 décembre 2004 qui stipulait que les détentions sans jugement de suspects de terrorisme – ordonnées par le Premier Ministre Tony Blair sous couvert de la Loi sur l’antiterrorisme, le crime et la sécurité de 2001, l’équivalent britannique du Patriot Act des États-Unis – étaient incompatibles avec les Droits de l’Homme tels qu’ils étaient inscrits dans la Convention Européenne des Droits de l’Homme, et à ce titre illégales [339]. Tous les détenus furent libérés. Devant la Chambre des Lords, Lord Hoffman expliqua qu’il s’agissait d’un des cas les plus important que le Parlement ait eu à traiter depuis des années : « Il remet en cause la persistance d’une très ancienne liberté dont notre pays a jusqu’à présent été très fier : la protection contre les arrestations et les détentions arbitraires ». Et de conclure : « La plus grande menace contre le pays ne vient pas du terrorisme, mais de lois de ce type », faisant écho aux déclarations du Colonel Rainborough [340]] au tournant de la Révolution anglaise en octobre 1647 : « Je me demande s’il est anglais ou non celui qui doute de ces choses » et qui continue à s’interroger pour savoir si les pauvres ont des droits à la vie à l’instar des plus grands, si le consentement de tous est une des conditions d’un gouvernement juste et si cette condition n’est pas remplie, est-ce que l’obéissance reste obligatoire. Le contrat social avait été violé.
Le troisième porte-parole pour la Grande Charte est Michael Ratner, président du Center for Constitutional Rights (Centre pour les Droits Constitutionnels, CCR) qui engagea une action dès 2001 contre les actes draconiens du gouvernement des États-Unis. Le CCR s’investit dans le procès de Guantánamo, qui portait sur la détention indéfinie, la torture, les disparitions ou les expulsions. Le CCR obtint gain de cause devant la Cour Suprême en juin 2004 dans le cas « Rasul versus Bush », pour lequel le juge Stevens, rédigeant les attendus de la majorité des juges, écrivait : « Les emprisonnements administratifs ont été considérés comme oppressifs et hors-la-loi depuis que le Roi Jean, à Runnymede, a promis qu’un homme libre ne serait plus jamais emprisonné, dépossédé, mis hors-la-loi ou exilé sans jugement par ses pairs devant la loi du pays (Shaughnessy v. United States, 1953) ». Par la plus étrange coïncidence, j’étais justement à Runnymede pendant cette décision, étudiant le terrain à quelques arrêts de bus de l’aéroport d’Heathrow et constatant une distorsion particulière du sens de la Grande Charte. Une question que je détaille dans le livre. Sur un linteau de granit, sur le lieu même de la signature de la Grande Charte, ont été gravés les mots « La liberté par la Loi » (freedom under law). Pourtant Ratner s’exprimait clairement : « Nous devons continuer à défendre les valeurs fondamentales des Droits Humains et de l’autorité soumise à la Loi (authority under law). C’est cela que représente la Grande Charte » [341].
Ratner raconte qu’en rejoignant le CCR en 1972, il considérait la loi comme un outil de changement social, et que la défense de « la loi constitutionnelle la plus élémentaire et des droits humains les plus fondamentaux », comme il continuait à le faire trente-quatre ans plus tard, avait constitué un « grand tournant ». Comme le remarquait Ian MacDonald dans un interview au Guardian : « si on m’avait dit il y a vingt ans que se battre pour les droits inscrits dans la Grande Charte et le respect des règles de lois passerait pour un comportement révolutionnaire, j’aurais éclaté de rire ». Ce grand changement pourrait nous conduire à un retour aux sources, car la Charte des Libertés concerne aussi les droits économiques et sociaux. L’attitude révolutionnaire à laquelle se réfère Ian MacDonald appartient réellement à la Grande Charte, qui fut obtenue suite à des révoltes et une guerre civile. Non seulement les pommes sont tombées loin de l’arbre, mais le verger tout entier a été envahi par de nombreux ravageurs.
C’est en accompagnant les combats des gens de couleurs pour participer « à égalité » aux sociétés américaines ou britanniques, en refusant des brutalités policières que MacDonald et Ratner ont eu leur baptême du feu juridique : l’immigration caribéenne pour Macdonald ou le mouvement des droits civiques pour Ratner. L’histoire de la Grande Charte est intimement liée à la lutte contre l’esclavage, et pour les sociétés occidentales, l’esclavage est inséparable de l’Afrique, ce qui donne une place particulière à la Grande Charte dans les combats des noirs pour la liberté.
Les individus libérés suite à la décision de la Chambre des Lords pendant laquelle Lord Hoffman su trouver l’éloquence nécessaire, étaient, en majeure partie, nord-africains. Son collègue Lord Bingham a lui aussi enchéri : « La protection de l’habeas corpus est souvent considérée comme limitée aux ‘sujets britanniques’. S’agit-il ici des seuls nationaux du Royaume-Uni ? La jurisprudence a clairement répondu ‘non’ à une telle question ». Et de citer la décision de Lord Mansfield dans l’affaire Sommerset de 1772 qui établissait le principe de territorialité : « Toute personne vivant dans le cadre de cette juridiction bénéficie d’une protection équivalente par nos lois ».
Y a-t-il un progrès de l’histoire ? Peut-être, mais il y a aussi de profonds reculs. La durée d’une loi souligne son importance, alors que l’ancienneté d’une tradition suggère son obsolescence. L’appel de la modernité prend le pas sur la vénération de l’ancien. Nous avons tendance à penser que les idées, notamment les lois ou les religions, sont dépendantes du mode de production d’une société donnée ; nous ne les considérons jamais comme des invariants au milieu d’un large changement technologique et une production massive de biens. D’où la nécessité actuelle de s’appuyer sur une philosophie de l’histoire. Ni le néolibéralisme, ni le postmodernisme ne sont capables de la fournir, tant ces théories sont attachées à l’instant présent, qui fait litière à l’oubli.
Le sociologue américain C. Wright Mills nous met en garde envers les « constructions transhistoriques ». Il poursuit : « Regardez avec autant d’attention les petits faits et leurs relations que les grands événements uniques. Mais refusez le fanatisme : mettez en relation tous ces travaux, en continu, et avec attention, si vous voulez vous mettre au niveau de la réalité historique. Ne croyez pas qu’un autre le fera pour vous, quelque part, à un autre moment. C’est à vous de faire ce travail ; formulez les questions dans les termes mêmes de cette réalité ; et c’est à son niveau qu’il vous faudra les résoudre et ce faisant prendre en compte les solutions autant que les difficultés rencontrées » [342]. Que veux dire le « niveau de la réalité historique », si ce n’est la persistance de l’usage des communs, sous ses nombreuses formes, et ceci malgré un millénaire de privatisation, d’enclosures et d’utilitarisme ?
Un de mes objectifs en écrivant ce livre est de remettre la question des communs à l’ordre du jour de la politique constitutionnelle. Du point de vue économique, les communs sont souvent regardés comme un mirage, pourtant l’attention des universitaires les a montrés au contraire avec les pieds sur terre. Un autre objectif est de m’adresser à tous ces pratiquants des communs pour les inciter à penser constitutionnellement, comme c’est déjà le cas au Venezuela, en Bolivie et au Mexique. La Grande Charte est radicale, aux racines des constitutions… et la Grande Charte présuppose l’existence et le respect des communs. En octobre 2006 Maher Arar, en recevant le Letelier-Moffitt Human Rights Award attribué par l’Institute of Policy Studies, a conclu en expliquant que ce qui le faisait aller de l’avant est « l’espoir qu’un jour notre planète Terre sera libérée de la tyrannie, la torture et l’injustice ».
***********************************************************************************

Peter Linebaugh est un historien spécialisé dans le monde du travail, spécialiste de l’histoire anglaise et irlandaise. Il est considéré comme l’un des plus importants historiens marxistes. Après un travail doctoral mené en 1975 sous la houlette du grand historien des communs E.P. Thompson, il a enseigné dans de nombreuses universités aux États-Unis, et exerce depuis 1994 à l’Université de Toledo. Le livre Magna Carta Manifesto a été accueilli très largement au-delà de la communauté des historiens et a montré l’importance du regard transversal (géographie mondiale, longue période historique, utilisation de plusieurs approches disciplinaires) qui est la marque de Peter Linebaugh.
Note des éditeurs : le texte suivant est une reprise autorisée par l’auteur de l’introduction du livre The Magna Carta Manifesto : Liberties and commons for All. Dans ce livre, Peter Linebaugh revisite l’histoire des communs en partant de la signature en 1215 par le Roi d’Angleterre Jean sans Terre de la Grande Charte (Magna Carta Libertatum). Ce texte, imposé au Roi par la révolte des barons, est considéré comme la source des constitutions modernes et l’origine des démocraties parlementaires. Dans ses 63 articles, il dispose, entre autre, que le Roi doit avoir l’aval d’un conseil composé de barons et d’ecclésiastiques avant de lever de nouveaux impôts. La Grande Charte définit également l’habeas corpus, qui met fin aux arrestations arbitraires : tout homme a le droit de connaître les raisons de son emprisonnement et d’être jugé. Peter Linebaugh insiste sur l’aspect juridique du combat historique qui a été mené par les peuples contre l’arbitraire des dominants : les communs méritent l’application du droit, et les combats de libération des communs se renforcent en prenant fait et cause pour les libertés civiles. La propre histoire de Peter Linebaugh, militant du mouvement des Droits civiques aux États-Unis dans les années soixante et confronté au retour des emprisonnements arbitraires durant la première décennie du XXIe siècle (Guantanamo notamment) est ainsi mise en perspective avec les multiples expériences de spoliation des communs, par les gouvernants, par les armées, ou par les entreprises prédatrices, notamment les compagnies pétrolières. En reprenant le fil historique, il insiste sur les autres documents qui accompagnent la Grande Charte, notamment la « Charte des Forêts », qui forme avec Magna Carta la « Charte des Libertés ». Ce document précise les droits d’usage sur les biens communaux et les forêts, notamment par les plus pauvres, les veuves et les exclus. Pour Peter Linebaugh, les « droits politiques » et les « droits économiques et sociaux » forment un ensemble indissociable, que les défenseurs des biens communs doivent comprendre et renforcer.
***********************************************************************************
[322] La « Requête soumise par les Zapatistes au cours du dialogue de février 1994 » faisait clairement une référence à la Grande Charte. Ce document est facilement accessible sur internet, au côté de l’excellent discours de Marcos « Les deux vents du Sud Est : une tempête et une prophétie ».
[323] Norimitsu Onishi, « As oil riches flow, a poor village rise up », The New York Times, 22 décembre 2002.
[324] Tuong Vi Pham, « Gender and the Management of Natures Reserves in Vietnam », Kyoto Review of Southern Asia, octobre 2002.
[325] Karl Jacoby, Crimes Against Nature : Squatters, Poachers, Thieves, and the Hidden History of American Conservatism : Berkeley ; University of California Press (2001), 2-50.
[326] Roy Tomlison, « Forests and Woodlands » in Atlas of the Irish Rural Landscape, ed. F.H.A. Aalen, Kevin Whelan, and Matthew Stout : Cork ; Cork University Press, 1997), 122.
[327] Atluri Murali, « Whose Trees ? Forest Practices and Local Communities in Andhra, 1600–1922 » in Nature, Culture, Imperialism : Essays on the Environmental History of South Asia, ed. David Arnold and Ramachandra Guha (Delhi : Oxford University Press, 1995), 97. See also Ramachandra Guha, The Unquiet Woods : Ecological Change and Peasant Resistance in the Himalaya (Berkeley : University of California Press, 1989)
[328] Susanna Hecht and Alexander Cockburn, The Fate of the Forest : Developers, Destroyers and Defenders of the Amazon (London : Verso, 1989)
[329] Voir en particulier Midnight Notes, Midnight Oil, Work, Energy, War, 1973–1992 (New York : Autonomedia, 1992), 303–33
[330] Michael Watts, « Petro-Violence : Community, Extraction, and Political Ecology of a Mythic Commodity » in Violent Environments, ed. Michael Watts and Nancy Peluso (Ithaca : Cornell University Press, 2001)
[331] « Magna Carta Date Tops Poll as Best Choice for a National Day » The Guardian, 30 May 2006
[332] D. Brandis, Memorandum on the Demarcation of the Public Forests in the Madras Presidency, Simla, 1878
[333] Garrett Hardin, « The Tragedy of the Commons » Science 162 (1968) : 1243–48
[334] Wangari Maathai, The Green Belt Movement : Sharing the Approach and the Experience (New York Lantern Books, 2004), 20–21
[335] Voir www.nacbs.org/report.html. Voir aussi Antoinette Burton, « When Was Britain ? Nostalgia for the Nation at the End of the ‘American Century’ » Journal of Modern History 75 (June 2003)
[336] Silvia Federici, ed., Enduring Western Civilization : The Construction of the Concept of Western Civilization and Its “Others” (Westport : Praeger, 1995)
[337] Durant la Guerre civile anglaise, en 1647, les Négociations de Putney dessinèrent deux approches de la Révolution en Angleterre, entre les Levellers, qui allaient jusqu’à remettre en cause la propriété, et la New Model Army d’Oliver Cromwell. La proposition d’un régime parlementaire égalitaire proposée par les Levellers constitue un moment fondateur pour les perspectives politiques ultérieures. Comme trop souvent dans l’histoire, les dirigeants radicaux des Levellers furent ultérieurement marginalisés, arrêtés et écrasés.[n.d.t.
[339] Parliamentary Debates, Lords, 5 th ser., vol. 56 (2004)
[340] Thomas Rainsborough fut un des principaux porte-parole des Levellers lors des Négociations de Putney en 1647 [n.d.t.
[341] Michael Ratner, « From Magna Carta to Abu Ghraib : Detention, Summary Trial, Disappearances and Torture in America » the Clara Boudin Lecture, City College of New York, spring 2005
[342] C. Wright Mills, The Sociological Imagination (New York : Oxford University Press, 1959)
©© Vecam, article sous licence creative common
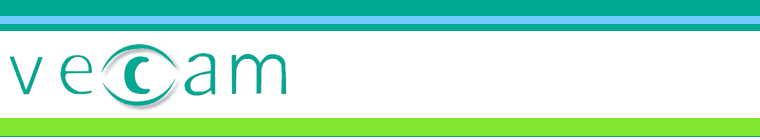

 Réflexion et propositions
Réflexion et propositions Libres savoirs, les biens communs de la connaissance
Libres savoirs, les biens communs de la connaissance Imprimer la page
Imprimer la page