25 - Les communs, ADN d’un renouveau de la culture politique
Article inédit. Titre original : The Commons as the DNA for a New Political Culture. Traduit de l’anglais (États-Unis) par Valérie Peugeot
Alors que nos institutions politiques traditionnelles se débattent avec les problèmes dévastateurs de notre époque – changement climatique, crise financière mondiale, flambée des prix du pétrole, etc. – on ne peut qu’être frappé par la faiblesse des réponses apportées. Prisonniers d’intérêts bien établis, les leaders politiques sont dans l’incapacité de faire appel à nos imaginaires ou de mobiliser nos talents collectifs. Les politiques publiques s’adressent à des institutions bien établies, en particulier aux entreprises, et les citoyens n’ont que peu l’occasion de véritablement participer et d’affirmer leur volonté politique.
L’objet de cet article n’est pas tant de critiquer les profonds dysfonctionnements des institutions politiques existantes que de dessiner les contours d’une perspective pour des alternatives constructives. R. Buckminster Fuller affirma un jour : « on ne change jamais rien en combattant la réalité en place. Pour changer quelque chose, il faut construire un nouveau modèle au côté duquel l’ancien paraîtra obsolète ». Le modèle prometteur que nous voyons émerger est celui des « communs ».
Les communautés, notamment les communautés en ligne, auto-organisées et auto-régulées, nous apprennent une chose : un formidable potentiel de nouveaux talents créatifs et citoyens est prêt à émerger. Les biens communs constituent le terreau dans lequel naissent de nouvelles pratiques sociales (commoning) ; celles-ci nous fournissent des pistes efficaces pour repenser notre ordre social, notre gouvernance politique et notre gestion écologique. Les communs rendent possibles de nouvelles énergies ascendantes, susceptibles de redessiner nos institutions politiques. À condition de rencontrer le soutien nécessaire, les biens communs, j’en suis persuadé, peuvent constituer un facteur profond de régénérescence et de transformation.
Pour la plupart des gens, le paradigme des communs est relégué à l’arrière-plan par la culture politique néolibérale. Et quand il est pris en compte, ce paradigme est plutôt considéré comme une curiosité et non un outil de transformation. Et pourtant, comme je vais m’essayer à le démontrer dans les pages qui suivent, les biens communs nous aident à affronter un grand nombre des pathologies liées à l’économie politique néolibérale. Ils nous fournissent un vocabulaire pour désigner les phénomènes de privatisation rampante et de marchandisation des ressources partagées, « l’enclosure des biens communs », qui constitue certainement l’une des injustices les plus négligées de notre temps.
En évoquant les biens communs, nous pouvons commencer à construire un vocabulaire partagé pour désigner ce qui nous appartient collectivement et que nous devons gérer de façon responsable. Nous pouvons reconquérir la maîtrise d’un patrimoine intergénérationnel qui s’étend de l’atmosphère et des océans jusqu’au génome humain et à l’internet, en passant par l’espace public et le domaine public. Tous ces biens collectifs font l’objet d’une exploitation, d’une privatisation et d’une marchandisation agressive.
Les communs sont essentiels car ils représentent bien plus qu’une abstraction intellectuelle. Ils sont à la source d’un mouvement politique, pour l’heure encore embryonnaire. La sensibilité, la critique sociale et la vision du monde portés par les communs transparaît aussi bien dans le travail des développeurs de logiciel libre qui affirment le droit de partager et de copier du code, que chez les artistes et auteurs qui utilisent les contrats Creative Commons pour partager des photos, vidéos et textes ; chez les militants qui tentent d’empêcher la privatisation de l’eau et d’en assurer l’accès universel ; chez les paysans des pays du Sud qui tentent de défendre leurs semences et leur biodiversité locale ; chez les citadins qui défendent les espaces et bâtiments publics contre les usurpations à des fins commerciales ; chez les militants de la réforme des médias qui défendent un internet et des ondes de radiodiffusion ouvertes au nom de l’intérêt public.
Cet article balaye un large éventail d’hypothèses étayées quant à l’avenir des communs. Il commence par décrire les communs comme paradigme pour la gouvernance de ressources partagées, puis montre comment l’internet est devenu l’espace d’accueil d’une multitude de tribus de commoners qui créent, gèrent et entretiennent leurs propres ressources numériques. Ces communs incarnent un nouveau principe d’inventivité sociale ascendante. Ils tracent une voie bien loin des approches traditionnelles proposées par les marchés et les États. Dans cet espace intermédiaire, émergent toutes sortes d’innovations et de changements sociaux, portés par des formes de gouvernance sociale auto-organisées. Ils s’appuient à la fois sur du droit, de la technologie et sur le monde des affaires.
En construisant une nouvelle culture numérique, les commoners créent un environnement propice à une nouvelle approche de la politique, une approche respectueuse de la participation, de la transparence, de l’équité sociale et de la responsabilité. Mais cet ordre social naissant est encore fragile, vulnérable face à des attaques réactionnaires ; c’est pour cela que nous devons impérativement comprendre en quoi consistent les structures de gouvernance et les pratiques sociales des communs. Les commoners, en tant que force politique émergente, doivent gagner en vigueur, de manière à être capables de protéger les valeurs en promesse contenues dans les communs ainsi que les communautés qui en sont à l’origine.
Une des questions complexes qui émerge est liée aux nouvelles formes d’activités d’affaires dites ouvertes : vont-elles participer à l’enclosure des communs, ou au contraire travailler de façon symbiotique et constructive avec eux ? La question est pour l’heure totalement ouverte, mais ma typologie approximative des modèles d’affaires ouverts me laisse entrevoir les conséquences d’une imbrication entre activités de marché et communs. Je conclurai par une brève méditation sur le potentiel transformateur dont le discours/débat sur les communs est vecteur.
Que sont les Communs ?
Bien que l’on trouve leur trace dès l’Antiquité, les premiers biens communs sont généralement associés aux villages anglais médiévaux, dans lesquels les gens du peuple, les commoners, pouvaient jouir librement des fruits des communs. Ils pouvaient utiliser le bois à brûler des forêts, mener leurs bêtes dans les pâturages ouverts, ramasser des glands pour nourrir leurs porcs, glaner après la récolte pour assurer leur propre subsistance.
Il convient de noter que les communs ne constituent pas une ressource en eux-mêmes, mais évoquent plutôt une triade : la ressource, la communauté des commoners ainsi que leurs pratiques sociales et règles. Les communs sont fondamentalement une organisation sociale pour la gestion de ressources collectives. Ils visent à offrir au mieux une égalité d’accès à tous les commoners ; mais ils sont également source d’identité, de sens collectifs et de tradition. Historiquement, ils ont également été facteur de stabilité sociale et écologique, un contrepoids aux tumultes des marchés capitalistes, dans lesquels, selon la célèbre phrase de Marx, « tout ce qui est solide se dissout dans l’air ».
Si les communs reviennent subitement sur le devant de la scène, cela s’explique en partie par la levée progressive des stigmates culturels qui leurs étaient attachés au cours des dernières décennies. La marginalisation de la théorie des communs a gagné en vigueur à la suite de la publication du fameux essai du biologiste Garrett Hardin en 1968, intitulé La tragédie des Communs [380]. Hardin affirmait que toute tentative de partage d’une ressource par une communauté se traduisait nécessairement par sa surexploitation et sa destruction. Il s’appuyait sur l’exemple abstrait d’une prairie dans lequel tout un chacun pourrait amener autant de bétail à paître que bon lui semblerait.
Les économistes libéraux tout comme les politiciens conservateurs ont longtemps cité la parabole de la « tragédie » pour justifier la privatisation des communs. Selon eux des résultats à la fois responsables et efficaces sont obtenus en assignant des droits de propriété privée sur la terre et en laissant le marché veiller à l’allocation des ressources. De plus ils affirment que ni les gouvernements, ni les individus ne possèdent les qualités et les motivations nécessaires à la gestion des communs.
Il a fallu des décennies pour déboulonner les erreurs de la fable de la « tragédie ». Comme cela a finalement été mis en lumière, la parabole d’Hardin ne porte pas sur un « commun », mais décrit un régime d’accès déréglementé à la terre, un espace dépourvu de toute frontière ou règle de gouvernance. Au contraire, un bien commun dispose à la fois de règles et de frontières parfaitement définies. Il constitue un système d’autogestion, doté de droits consensuels pour contrôler l’accès et l’usage d’une ressource. Les participants à un commun formulent et entérinent les règles, et les font respecter. Ils insistent également sur la nécessité de garder le système ouvert, de manière à ce que les passagers clandestins puissent être identifiés et punis.
Au cours des quinze à vingt dernières années, différents historiens – comme Peter Linebaugh [381] et Edward Palmer Thompson [382] –, des politologues et des militants ont été à la rescousse des communs, pour les sauver de l’oubli dans lequel les conservateurs à l’esprit uniquement orientés vers le monde des affaires avaient tenté de les faire sombrer. La politologue Elinor Ostrom a magistralement réfuté la parabole de la « tragédie » dans son ouvrage de 1990, Governing the Commons [383]. Le travail d’Ostrom a ouvert la voie à une nouvelle forme de recherche interdisciplinaire autour des communs, en particulier sur les ressources naturelles dans les pays en développement. Ostrom et sa collègue Charlotte Hess, par leurs ouvrages et articles ainsi que la constitution d’une « bibliothèque numérique sur les communs » [384], ont effectué un formidable travail de conscientisation autour de la connaissance comme bien commun. La documentation des différentes enclosures modernes des communs par des auteurs comme George Cafentzis, Sylvia Federici, Massimo de Angelis ou moi-même a également contribué à remettre les communs sur le devant de la scène.
L’essor des Communs numériques
Au final, la meilleure objection à la vision du monde basée sur la « tragédie des communs » n’est ni un livre, ni un traité, mais une pratique sociale de masse : Internet. Internet a fait la démonstration que les communs peuvent constituer un paradigme à la fois efficace et socialement séduisant pour créer de la valeur, en particulier de la valeur qui ne peut être ni monétisée, ni capturée comme propriété privée.
Traditionnellement, l’économie orthodoxe déclare que seuls les échanges marchands permettaient sérieusement de créer de la richesse. Selon ce dogme, un texte, une chanson ou un film doit nécessairement être enserré dans une enveloppe de droits de propriété (en l’espèce le droit d’auteur) pour qu’il y ait création de valeur. « Pas de droit de propriété, pas d’étiquette de prix = pas de valeur ».
Avec cette approche, tout ce qui se trouve dans le « domaine public », c’est-à-dire toute œuvre qui n’est plus soumis au droit d’auteur, est sans valeur. C’est pourquoi le domaine public a longtemps été considéré comme une décharge, un réservoir où sont stockés des vieux rapports gouvernementaux, des partitions et des livres des années vingt, en compagnie de quelques autres détritus culturels, sans valeur marchande.
Cette logique a d’abord été contestée par le travail précurseur du hacker Richard Stallman, qui a montré dans les années 80 que la collaboration de masse pouvait déboucher durablement sur la création de logiciels d’excellente qualité. Ainsi, la « Commune Emacs », un collectif de hackers animés par Stallman, a développé un excellent éditeur de texte que certains aficionados utilisent encore aujourd’hui. Le logiciel libre, ainsi que Stallman l’a dénommé, démontre qu’une communauté qui partage un même niveau d’engagement, peut tirer partie des talents décentralisés de bénévoles pour produire une ressource partagée de valeur.
Stallman a été l’un des premiers pionniers d’internet à traiter la question de la gouvernance des communs. Au sein de sa « Commune Emacs », les participants avaient pour obligation de renvoyer leurs remarques à une source centrale, en l’espèce, Stallman. Mais parce qu’il s’agissait d’un engagement volontaire, sans contrainte légale ni sociale, et parce que la gestion centralisée de Stallman créait un goulot d’étranglement contre-productif, la capacité de la communauté à gérer et améliorer du code partagé s’en est trouvée entravée.
Par la suite, la GPL (General Public License), un outil légal de protection des communs du logiciel libre, a constitué l’innovation clé de Richard Stallman et Eben Moeglin. La GPL est une licence qui s’appuie sur le droit d’auteur (copyright aux États-Unis) attaché au code logiciel, une sorte de « hack » de la loi. À la différence du droit d’auteur ou du copyright, la GPL permet à quiconque d’utiliser à sa guise le code d’un programmeur, à une condition essentielle : toute utilisation dérivée du code doit être mis à disposition de la communauté des développeurs et usagers dans les mêmes conditions. Ce qui signifie que tout créateur qui conçoit un programme dérivé doit licencier son propre travail en GPL et ce faisant, en autoriser le libre partage et la réutilisation.
La GPL a constitué une avancée majeure sur le plan conceptuel car elle a permis de s’assurer, du point de vue juridique, que toute innovation en matière de code informatique demeurera dans les communs. Le travail de la communauté est ainsi protégé de toute appropriation privée par des personnes extérieures. C’est ainsi qu’un corpus de code partageable peut se constituer et s’améliorer au fil du temps. Le plus célèbre des logiciels ainsi conçu en bien commun est certainement GNU/Linux, le système d’exploitation libre, qui contre toute attente défie le système Windows de Microsoft et équipe aujourd’hui un nombre incalculable de serveurs, d’ordinateurs personnels et de terminaux numériques en tous genres.
La GPL n’a pas seulement constitué une innovation juridique ou technique, elle a également été une formidable innovation politique. En préservant l’intégrité de la communauté virtuelle et de ses productions, la GPL garantit également des libertés fondamentales. Elle protège « quatre libertés » que Stallman considère indispensables à un programmeur : la liberté d’utiliser un programme quelle qu’en soit la finalité ; celle d’étudier la manière dont le programme fonctionne ; celle de redistribuer des copies dudit programme ; et enfin la liberté d’améliorer le programme et de partager ces améliorations avec les autres.
Dans son livre paru en 1999, Code and Other Laws of Cyberspace [385], le professeur Lawrence Lessig a tiré les leçons du logiciel libre. En établissant un cadre théorique fort, susceptible de sécuriser les libertés en ligne, cet ouvrage est immédiatement devenu une référence. Lessig a remis en cause l’affirmation libertarienne selon laquelle la liberté sur internet est naturelle et auto-régulée, et que des marchés sans entraves encouragent cette liberté. Lessig au contraire affirme que la liberté doit être construite activement et que les communs numériques constituent l’un des vecteurs essentiels de cette liberté. Il précise également que la construction de communs en ligne nécessite des outils qui sont à la fois technologiques (des protocoles internet ouverts), juridiques (des licences ou contrats comme la GPL, les licences Creative Commons, qui favorisent le partage) et sociaux (des normes et idéaux partagés par les acteurs).
La puissance réelle des communs numériques est apparue clairement à partir de 2003 à travers la prolifération des applications logicielles du web 2.0. Avec cette nouvelle étape de développement du web, il devient facile à n’importe qui de partager des choses et la stupéfiante productivité des communautés en ligne a commencé à changer la société. Les gens ont créé Wikipédia, se sont mis à partager des collections de millions de photos et de vidéos (Flickr, YouTube), ainsi que leurs repérages de pages web (Delicious) ou d’actualités (Reddit), et à créer des réseaux sociaux en ligne (Facebook, LinkedIn).
Les biens communs comme nouveau principe de création ascendante
Le récit traditionnel sur le « domaine public dépotoir » a été soumis à rude épreuve au cours de la dernière décennie. La grande valeur des communs est aujourd’hui largement reconnue [386]. Le cyberespace ne peut être assimilé à un lopin de terre dont les ressources finies peuvent être épuisées ; au contraire, le cyberespace peut évoluer à l’infini et gagne en valeur au fur et à mesure que le nombre de personnes qui y participe croît. Les communs numériques débouchent non pas sur une tragédie mais sur une abondance de communs, selon l’expression du programmeur Dan Bricklin. Mieux encore, les communs permettent à la valeur créée socialement d’être reconnue en tant que force macroéconomique et culturelle, ainsi que l’affirme Yochaï Benkler dans son livre La richesse des réseaux [387].
À l’inverse des marchés, qui exigent des nouveaux entrants qu’ils aient amassé capitaux et expertises en quantité avant de pouvoir y pénétrer, un commun numérique tend à être très accessible. En effet un commun numérique peut surgir chaque fois que telle ou telle communauté décide de gérer une ressource sur un mode collectif, en veillant à ce qu’on puisse y accéder de façon équitable, égalitaire et durable. Par comparaison avec le marché, les coûts de transaction et les complications sont minimes.
Internet héberge aujourd’hui une telle diversité de communs que nous voyons émerger un véritable « tiers-secteur des communs ». Celui-ci est constitué d’une constellation hétérogène de communautés autogérées : logiciel libre, archives et sites web collaboratifs, communautés de réseaux sociaux, sites de remix musical et de mashup de vidéos, millions de bloggeurs dans la blogosphère. Les universitaires mettent en place des revues en libre accès et des ressources éducatives libres. Les chercheurs scientifiques développent des outils pour rendre leurs bases de données interopérables et favoriser la recherche et l’usage des publications (au travers du web sémantique et des protocoles linked data). De nombreux entrepreneurs expérimentent des nouveaux modèles d’affaires ouverts, basés sur des plateformes ouvertes et évitant l’écueil d’une application trop rigide du droit d’auteur.
Toutes ces innovations autour de la construction de biens communs apportent de nouvelles formes de création de valeur. Ces communautés s’appuient sur la confiance et la réciprocité sociale et bénéficient de l’effet levier des réseaux. Ce faisant, elles ont tendance à supplanter, ou plutôt mettre hors coopération les marchés traditionnels, ces derniers étant souvent accablés par les frais généraux liés aux équipements capitalistiques, aux frais juridiques, à la publicité, aux recrutements de compétences, etc.
Ce qui pendant un temps fut une curiosité liée à internet commence à générer des implications politiques et culturelles de taille. Les bloggeurs commencent à questionner l’autorité et la crédibilité du journalisme traditionnel, transformant ainsi un produit marchand (« les news ») en une ressource socialisée circulant librement. Grâce à internet et aux technologies numériques, les citoyens s’impliquent chaque jour un peu plus dans la politique et l’autogestion. Ils s’organisent collectivement, parlent en leur propre nom, et initient des actions politiques à partir de leurs propres priorités et projets, et non en fonction de celles établies par les institutions et les politiciens. Ils contournent les intermédiaires traditionnels.
Il suffit d’observer la période qui a précédé la guerre en Irak, pour mesurer le nombre de bloggeurs qui ont fourni une couverture bien plus précise et responsable que le New York Times, le Washington Post ou d’autres organes de presse. Les journalistes professionnels nous ont fourni au mieux des informations tragiquement trompeuses au sujet des armes de destruction massive, ou pire encore, ont recyclé la propagande gouvernementale.
Maintenant que les citoyens peuvent diffuser leurs vidéos auprès d’une audience mondiale à travers YouTube et d’autres sites, ils modifient le fil de la conversation politique autrefois contrôlée par les grandes entreprises, les partis politiques et les journalistes professionnels. Alors qu’il candidatait pour un poste sénatorial en 2004, George Allen traita de macaque – une injure ethnique – un étudiant d’origine amérindienne qui filmait l’une de ses prises de parole publique. La vidéo, postée ensuite sur YouTube, contribua directement à l’échec d’Allen et à la reconquête de la majorité par les Démocrates au sein du Sénat américain.
Sur un mode plus positif, la campagne électorale de Barack Obama au poste de Président, a été profondément infléchie par la participation massive rendue possible par internet. Tout au long de sa campagne, Obama a réussi, grâce à un usage ingénieux des technologies web 2.0, à récolter plus de 400 millions de dollars, dont l’essentiel sous forme de contributions inférieures à 200 $. Les gens pouvaient organiser leurs propres évènements, publier leurs propres chansons et vidéos de campagne, et les diffuser auprès d’autres citoyens.
La citoyenneté fabrique de l’histoire
Les citoyens ne peuvent plus être relégués à la périphérie, ils n’ont plus à plaider leur cause auprès des responsables politiques ou des médias, ils sont en capacité d’exprimer leurs passions par eux-mêmes, sur une scène mondiale, et de lancer directement des actions politiques. J’appelle cette nouvelle citoyenneté enrichie en capacité « la citoyenneté fabrique de l’histoire ». Cette formulation souligne le fait que les citoyens ordinaires peuvent, pour la première fois dans l’histoire, se comporter en acteurs responsables et s’impliquer dans la politique traditionnelle.
Ainsi des étudiants à l’université de Swarthmore en Pennsylvanie ont démontré que les machines de vote fabriquées par Diebold pouvaient être hackées. Et quand Diebold a cherché à dissimuler les preuves au nom du droit du copyright, les étudiants soutenus par d’autres militants ont rendu ces documents publics sur le web, obligeant les gouvernements à se pencher de près sur ces machines [388]. À la suite de quoi de nombreux États ont décidé de ne plus utiliser ces machines pour leurs prochaines élections.
Un collectif de militants, juristes et journalistes a tiré la sonnette d’alarme à propos de Zyprexa, un anti-psychotique à succès, présentant des effets secondaires mortels. Pour ce faire, ils ont ouvert un wiki public sur lequel ils ont publié une documentation mettant en évidence les dangers de ce médicament, contraignant le gouvernement à intervenir. Au final, les autorités ont imposé à Eli Lilly, le laboratoire qui commercialise ce médicament, une amende d’un million de dollars pour avoir supprimé les preuves des risques qui y étaient attachés [389].
Ce qui frappe dans cette citoyenneté fabrique de l’histoire, c’est sa capacité à défier les bureaucraties centralisées des pouvoirs publics comme des grandes entreprises. Dans un nombre de cas incalculable, les commoners disposent de connaissances plus fiables, plus distanciées, ou pour le moins d’une capacité à dire la vérité en public. En s’appuyant sur les réseaux ouverts, les commoners disposent d’un formidable réservoir de talents répartis aux quatre coins du monde : plus d’yeux, plus d’oreilles, plus d’esprits créatifs que ce dont disposent les institutions qui prétendent nous gouverner.
La pensée dominante affirme que seul l’État ou le marché disposent du pouvoir, de la légitimité et de l’expertise nécessaires à l’exercice de certaines fonctions. En réalité, nous constatons chaque jour un peu plus que les biens communs se structurent par eux-mêmes, devenant ainsi source de régulation et de création de valeur. Les communs donnent naissance à de nouvelles formes de pouvoir qui permettent de s’opposer aux marchés fermés et aux institutions politiques qui ne servent qu’une frange, celle des nantis et des connectés. En ce sens les communs constituent un vecteur de transformation politique et culturelle. Ils ouvrent une « zone de transit » pour la consolidation et l’expression de nouvelles formes d’organisation sociale et de pouvoir économique.
Pour autant le secteur des communs n’est ni un mouvement idéologique, ni une approche politicienne conventionnelle, tout du moins dans ses manifestations en ligne. Il ne s’agit ni de postures ni de messages prétendument intelligents, ni de manœuvres tactiques ou de rétention de pouvoir. Il s’agit plutôt de construire un nouvel ensemble de pratiques sociales susceptibles, le temps passant, de changer le contexte même de la vie politique. Il s’agit de changer la manière dont les gens agissent, concrètement et au plus près de leurs vies. À terme, cela débouchera progressivement sur une transformation des attentes et aspirations des gens quant à la marche du monde. En rendant possible de nouvelles formes de relations sociales et d’exigences, en matière de transparence par exemple, l’infrastructure numérique contribue à construire un nouvel ordre social. Les gens attendent de leurs institutions plus d’ouverture et de responsabilité, et disposent de nouveaux outils pour asseoir leur demande. Si comme Cicéron l’a affirmé, « la liberté c’est la participation au pouvoir », alors les communs permettent d’accroître cette liberté du citoyen et transforment leurs attitudes à l’égard de la gouvernance.
En ce sens, le secteur des communs représente une nouvelle culture politique en émergence, une culture susceptible de transformer l’ordre actuel des choses. Projet par projet, le secteur des communs pointe les limites et les dérives des marchés existants et des structures gouvernementales corrompues en construisant des alternatives opérationnelles. Ainsi, se créent de nouveaux sites web pour les informations locales, des plates-formes ouvertes pour des pratiques citoyennes collaboratives ; on assiste à l’émergence de nouveaux lanceurs d’alerte dénonçant les comportements répréhensibles des entreprises ; au plus près de la vie quotidienne, on voit se construire des communautés d’entraide pour les vétérans au retour de la guerre ; des campagnes et des manifestations sur Facebook stimulent le changement ; et ainsi de suite…
La volonté de transformation sociale des commoners a aujourd’hui acquis une visibilité culturelle inédite et ceci grâce aux nouveaux outils numériques. Ils sont mieux armés pour se coordonner, s’organiser et gagner en efficacité politique.
De fait, au moins dans l’univers en ligne, le secteur des communs est devenu une forme alternative de gouvernance. Il concurrence les lois élaborées par les gouvernements et les marchés dominés par les vendeurs. Il dispose de sa propre forme de souveraineté. Ceci est quelque chose de totalement nouveau dans notre histoire politique. Le sous-titre de mon livre Spirale virale le dit clairement : « Comment les commoners construisent leur propre république numérique » [390].
Il y a quelques années, David Johnson, un chercheur spécialiste des questions de l’internet a déclaré dans un brillant article que les communs en ligne constituent une nouvelle forme de métabolisme social et biologique susceptible de générer du « droit » [391]. Ceux-ci disposent de leurs propres mécanismes internes pour gérer leurs affaires et pour interagir avec leur environnement. Ils sont susceptibles de s’auto-réparer et de se définir une identité durable. Les communs constituent une nouvelle forme d’organisme dans notre culture, un organisme susceptible de concurrencer et parfois de dépasser les institutions traditionnelles du monde public, des affaires et des médias.
Assurément, le paradigme des communs est bien plus solide dans le monde virtuel, où les barrières à l’entrée sont faibles et où les phénomènes intrinsèques de rareté des ressources sont marginaux. Au contraire, les communs des ressources naturelles sont en général finis et « rivaux » (l’usage de la ressource par une personne empêche une autre personne d’en faire autant). Aussi les politiques de gestion des communs constitués de ressources naturelles doivent-elles obéir à des critères différents de ceux des communs numériques. Pour autant les cyber-communs et les communs du « monde réel » ne constituent pas des royaumes totalement distincts, puisqu’on voit se construire de nombreuses communautés numériques qui utilisent des plates-formes en ligne pour surveiller et gérer des ressources naturelles ou pour collaborer avec d’autres communautés ayant des objectifs similaires [392].
Je suis convaincu que le secteur des communs, nouveau paradigme d’une gouvernance autogérée, représente une formidable avancée en matière de citoyenneté. Dans l’Amérique du XVIIIe siècle, le peuple avait juste le droit de soutenir les décisions de l’élite des grands propriétaires terriens. Dans l’Amérique du XIXe siècle, la citoyenneté consistait à adhérer à de grands partis politiques centralisés. Dans l’Amérique du XXe siècle, la citoyenneté consistait à devenir un « électeur éduqué », condition pour obtenir un bon gouvernement.
Le secteur des communs élève la citoyenneté à un tout autre niveau. Il rend hommage à l’accès libre, la transparence, la liberté de participer et l’équité sociale par des voies que les gouvernements ne peuvent ni ne veulent emprunter. Le secteur des communs trace le chemin d’un nouveau régime démocratique, d’une nouvelle forme de gouvernance. Le vaste réseau des communs numériques fait émerger une résistance transnationale à l’autorité centrale.
De nombreuses élites politiques sont, de façon compréhensible, déstabilisées par la montée des communs. Elles doutent de l’intérêt de toute cette transparence et cette participation ouverte ; cela peut les mettre dans des situations délicates et contester leur autorité politique. Elles s’inquiètent également du fait que les citoyens disposent d’un accès direct au savoir ; cela représente une remise en cause potentielle de leur expertise jusqu’ici reconnue. Quant à l’action décentralisée, auto-initiée, elle ne peut être contrôlée par une entreprise, une bureaucratie ou un parti, elle leur semble donc « hors de contrôle ». Y compris chez les libéraux [393], nombreux sont ceux qui ne font pas confiance à la citoyenneté décentralisée, probablement parce qu’elle menace leur position de mandataires auto-désignés des masses.
L’ordre établi n’est pas particulièrement heureux de cette tournure des évènements, mais se garde bien de réagir de façon trop marquée. Ce qui préoccupe le plus ces gardiens des modèles d’affaires et de l’autorité publique du XXe siècle, c’est le pouvoir politique grandissant et toujours plus sophistiqué que le monde en réseau est en train de développer. Ce dernier tire son pouvoir de sa capacité à se comporter de son propre chef comme une force de production économique et culturelle. Les amateurs peuvent, grâce à leurs contenus, voler aux médias traditionnels leur capacité d’observation et faire valoir leurs propres intérêts non commerciaux et politiques. Le cadre culturel dominant, tel qu’il a été élaboré par les médias commerciaux, est en train d’être remis en perspective ; sa domination omniprésente sur l’imaginaire des gens se desserre.
C’est bien pour cette raison que le secteur des communs exerce une forme de pouvoir bien plus puissante que celle des acteurs traditionnels. Ce pouvoir est culturel. Il génère une légitimité morale et une autorité sociale bien supérieures à celles de bon nombre d’institutions. Au lieu d’avoir à négocier avec les représentants corruptibles d’une démocratie nominale, le secteur des communs offre aux gens la possibilité d’expérimenter un gain démocratique direct dans leur quotidien (en ligne). Il permet de passer d’une culture du push à celle du pull : plutôt que de grandes entreprises et des institutions étatiques imposent leurs volontés à la populace, les individus et les communautés peuvent choisir par eux-mêmes les informations qu’ils veulent regarder, utiliser et partager [394].
Ce pouvoir démocratique « populaire » et en élaboration continue, ne peut facilement être circonscrit ou récupéré. À l’inverse des médias de diffusion ou des partis politiques, qui peuvent étouffer ou faire taire les voix discordantes, internet (pour l’heure) est radicalement ouvert et difficile à censurer, au moins dans la grande majorité des pays du monde.
Prenons au sérieux la dimension politiquer de la culture numérique
La création d’un secteur des communs est le fruit du travail d’une génération – le point culminant d’un voyage qui a commencé avec le logiciel libre, a franchi un nouveau cap avec les contrats Creative Commons, puis explosé avec l’arrivée du web 2.0. Si nous nous autorisons à reconnaître que les secteurs des communs changent tout à la fois le sens de la gouvernance, l’économie de la création de richesses et la dynamique de la production culturelle, nous devons alors nous confronter à une série de questions stratégiques. À commencer par celle-ci : Comment pouvons nous protéger au mieux et étendre cette nouvelle forme de gouvernance ?
Comment les commoners peuvent-ils protéger cette souveraineté durement gagnée ? Quelle combinaison d’outils technologiques, juridiques et de normes sociales nous assurera que Microsoft, Google, Yahoo ! Cisco, Intel et les autres acteurs puissants du marché n’éclipseront pas les intérêts des commoners avec leurs méthodes habituelles d’enclosure ?
À l’évidence, de nombreuses politiques publiques sont essentielles pour cela. La neutralité du net est vitale : l’exigence que tout le trafic internet soit transporté par les opérateurs de télécommunications et les cablo-opérateurs sans discrimination au regard du contenu ou de l’émetteur. De même pour les protections en matière de cyber-sécurité et de vie privée. Les règles juridiques qui représentent les intérêts du public en regard du droit d’auteur doivent être protégées : fair use (règles d’exceptions qui défendent les usages légitimes, par exemple des bibliothèques ou de l’éducation), doctrine de la première vente (qui permet de revendre et prêter le produit culturel ainsi acquis), existence d’un domaine public, etc. De même que les politiques anti-concentration qui permettent un véritable jeu de la concurrence doivent être promues et appliquées.
Un autre enjeu plus complexe et de nature différente consiste à élaborer de nouvelles politiques publiques éclairées. J’entends par là des politiques susceptibles de protéger l’intégrité même des communs. Toutefois, si les intérêts des commoners ne peuvent être protégés, a fortiori nous aurons du mal à trouver un soutien politique pour des politiques publiques vigoureuses. Aussi à court terme, la tâche essentielle consiste à protéger la proposition de valeur des communs numériques et à conforter les commoners en tant que force politique en émergence.
Ceci appelle une discussion approfondie sur la gouvernance des communs. Quelle lecture avons-nous de la création de valeur qui s’opère dans les communs et, en conséquence, de quels moyens devons-nous nous doter pour protéger et promouvoir le mouvement des communs ? Comment marché et communs peuvent-ils interagir de façon constructive, sur un pied d’égalité, de manière à ce que la créativité des communs se poursuive ? Il s’agit là de questions politiques critiques.
De la définition que nous utiliserons pour les communs découlera la manière de nous y prendre. Un bien commun a de nombreuses significations qui varient selon les gens. Un commun est-il quelque chose que nous pouvons partager sur une plate-forme ouverte ? Ou bien est-il conditionné à l’existence d’une communauté sociale cohérente, agissant en tant que gestionnaire responsable d’une ressource partagée ? Quel est l’espace réservé au libre arbitre individuel au sein d’un commun ?
Les communs peuvent-ils travailler en tandem avec les places de marché, et dans l’hypothèse positive, selon quels procédés ? Ou bien les communs doivent-ils être identifiés comme des adversaires du marché et de sa culture, voire comme un ennemi idéologique du capitalisme néolibéral ? Existe-t-il des archétypes reconnus de la gouvernance des communs au sein du large éventail des possibles communs ?
Comme cette série de questions le montre bien, il y a encore beaucoup de choses à stabiliser. Aujourd’hui nous en savons beaucoup plus sur l’importance des plates-formes du logiciel libre et des contrats juridiques de licence, et sur leur rôle d’infrastructures essentielles à une économie de partage. Mais nous avons encore beaucoup à apprendre sur l’économie morale, la psychologie individuelle et la sociologie de la construction des communs. Alors que les commoners qui discutent en profondeur de ces questions sont de plus en plus nombreux, la probabilité augmente de voir émerger une définition claire des communs.
Elinor Ostrom, à travers son étude des ressources naturelles comme bien commun [395], et Yochai Benkler, avec son exploration du « partage empathique » et de la coopération [396], ont déjà construit un apport théorique essentiel. Dans « Governing the Commons », Ostrom pose le problème de fond en ces termes : « Comment un ensemble de principes qui sont en situation d’interdépendance s’organisent et se gouvernent eux-mêmes de manière à obtenir des bénéfices conjoints continus, tout en résistant aux tentations du passager clandestin, du tire-au-flanc et autres comportements opportunistes ? » [397]
Dans cet ouvrage, elle répond en établissant huit principes essentiels. Ceux-ci comportent, entre autres, la nécessité d’une définition claire des frontières des communs, une appropriation et des règles de précaution qui s’accordent aux spécificités locales, la capacité des populations à modifier les règles des communs, la surveillance de l’accès et de l’usage de la ressource, ainsi que des sanctions graduées pour les passagers clandestins…
Bien que ces principes offrent une heuristique utile, il est important de réaliser qu’il n’y a pas d’inventaire « maître » ou de définition unique des communs, ne serait-ce que parce que chaque commun est le produit de circonstances historiques, d’une culture locale, de personnalités uniques et découle de la ressource en partage elle-même. Lors d’une conférence publique, Elinor Ostrom a une fois illustré cette réalité en présentant une diapositive d’une chaise pliante dans un espace de stationnement enneigé. « C’est un commun ! » a-t-elle déclaré.
Décontenancé, je lui ai demandé ce qu’elle voulait dire. Elle a alors expliqué que dans le quartier de Boston où la photo a été prise, il y avait un accord entre les voisins selon lequel si quelqu’un a pelleté une place de parking après une grosse chute de neige, cette personne a le droit de stationner là pour toute la durée de la période d’enneigement. En plaçant un vieux meuble sur la place de parking, l’habitant indique son droit temporaire d’usage. C’est un commun, expliqua Ostrom, parce qu’il y a une compréhension partagée de la communauté sur le mode d’allocation d’une ressource rare (une place de parking dégagée). Voilà une sorte de commun.
L’exemple de la place de parking est une excellente démonstration de la spécificité de chaque commun. D’une certaine manière, un commun est appelé à exister une fois qu’une communauté décide de gérer une ressource partagée et de respecter les règles de gouvernance qu’elle s’est auto-construite [398]. Sur internet, où les ressources sont intangibles et malléables (des morceaux d’information), la gouvernance des communs peut prendre de très nombreuses formes. Les règles auto-proclamées d’un wiki animé par des fans de Star Wars seront bien différentes de celles de la communauté de hackers Debian, de même qu’une ligue de baseball virtuel aura des règles différentes de celles du réseau politique DailyKos.
En vérité, les communs en ligne se trouvent sur une frontière expérimentale dont les dynamiques n’ont que très peu été étudiées, tant du point de vue empirique que théorique. Comme quasiment tout sur le net tient de l’expérience en temps réel, il est pour l’heure impossible d’élaborer une taxonomie générale ou une théorie des communs numériques. Dans chaque communauté, nous trouvons des notions différentes en matière de liberté, de frontières des communautés et de normes sociales.
Mais on peut en même temps affirmer que tous partagent un objectif essentiel – la protection à travers le temps des normes de la communauté concernée et de sa ressource partagée. Le plus souvent, comme l’énonce le professeur Robert Ellickson [399], les communautés en ligne ont envie de développer leurs propres « ordre sans loi ». Elles inventent des manières informelles de « créer de la règle » sur un mode auto-organisé, et organisent leur application par la force des normes sociales.
Cette dimension sociale est essentielle, car, comme l’a affirmé l’historien Peter Linebaugh, il n’y a pas de communs sans commoning. Les pratiques sociales rendent un commun viable. Même si la GPL constitue un outil juridique essentiel, la GPL seule ne crée pas le commun des logiciels libres. Les communs fleurissent uniquement parce que les gens participent, coopèrent, débattent des règles, affinent leur éthique, construisent et maintiennent une ressource partagée.
Nous avons absolument besoin de développer une nouvelle science politique et une sociologie des communs en ligne. Dans cet ordre d’idées, certains travaux de référence viennent à l’esprit : ceux du professeur Charles Schweik sur les communautés du logiciel open source, notamment sur SourceForge [400] ; le livre Cyberchiefs de Mathieu O’Neil sur les « tribus en ligne » [401] ; l’ouvrage de Johan Söderberg, Hacking Freedom, qui considère que le jeu et l’humour constituent les principes clé des communautés de hackers [402] ; l’étude à la fois sociologique et historique de la gouvernance dans Wikipédia, menée par Jonathan Zittrain [403] ; et les travaux en cours de Yochaï Benkler sur la coopération et la confiance en ligne [404].
Le caractère spécifique de chaque commun
Bien qu’il n’y ait pas de consensus strict ni sur la définition des communs ni sur les sous-catégories qui les composent – et par conséquent sur la manière dont les communs devraient être construits et gouvernés – on trouve cependant des caractéristiques spécifiques, qui vont donner la couleur particulière de chaque commun. On peut citer notamment les choix suivants :
Ouvert versus Libre
Les plateformes internet ouvertes rendent les textes et les vidéos accessibles et partageables ; pour autant constituent-elles un commun ? De nombreuses voix le refusent. En effet, une entreprise qui héberge un site de partage de photos ou de réseau social est là pour faire des affaires et générer de l’argent. Ses conditions d’usage sont rédigées dans cet objectif. Si l’entreprise fait faillite, ou si elle décide d’imposer de nouvelles conditions d’usage aux utilisateurs de son site, que devient la communauté ? Qu’arrive-t-il à la ressource partagée [405] ?
Les entreprises en viennent à détenir et monétiser les produits de la communauté (par exemple en vendant leurs habitudes de visites ou leurs données personnelles à des marketeurs par exemple). Dès lors « l’ouverture » ne coïncide pas nécessairement avec les intérêts des commoners. Il est ainsi arrivé que MySpace interdise à ses usagers d’utiliser des widgets qui venaient de l’extérieur de son site et qui n’avaient pas été approuvés. Se référant aux pratiques prédatrices des propriétaires terriens du sud des États-Unis après la guerre civile, le professeur Lawrence Lessig a qualifié ces sites de « colonies numériques ».
Aussi la distinction entre les plateformes dites « ouvertes » et celles qui sont « libres » n’est pas inutile. Une plateforme ouverte peut laisser le monde des affaires s’emparer du travail de la communauté, alors que dans les communs il existe habituellement des mesures de contrôle. Un site web ouvert peut ressembler à un commun, dans la mesure où il fournit un accès général à une ressource. Mais alors que les communs sont gérés uniquement dans l’intérêt des utilisateurs, le site ouvert peut restreindre fortement les droits juridiques des utilisateurs sur les contenus. Une entreprise peut se servir d’une plateforme ouverte comme outil pour monétiser des contenus, alors que généralement la ressource d’un commun se doit d’être inaliénable (c’est-à-dire ne pas pouvoir être vendu sur la place de marché).
« Ouvert » et « libre » ne sont pas nécessairement à opposer. De nombreuses plateformes ouvertes à caractère commercial respectent un contrat social implicite avec leurs usagers. Les entreprises gérant ces plates-formes sont conscientes qu’en remettant en cause ce contrat (par exemple en imposant des conditions d’usages inacceptables), elles risquent de pousser leurs usagers à quitter le site et ce faisant détruire leur modèle d’affaire. Néanmoins les entreprises ont très certainement un intérêt fort à monétiser les contenus et l’attention des usagers, à travers la publicité, la fouille de données, les licences sur les contenus, etc. Les intérêts des vendeurs et des usagers ne coïncident donc pas systématiquement, et nous ne sommes certainement pas en face d’une authentique gouvernance des communs.
Choix individuel versus communauté
Certaines critiques considèrent que les contrats Creative Commons, en laissant aux individus le choix quant aux usages possibles de leurs travaux (ex : usage non commercial, pas d’œuvres dérivées etc.), freinent la création de communs. De fait, les concédants des Creative Commons ne s’engagent à l’égard d’aucune communauté, ils se contentent de changer les termes habituels du droit d’auteur applicables à des échanges transactionnels. À l’inverse, les utilisateurs de la GPL s’engagent de façon beaucoup plus sérieuse en faveur des communs. Ils ne choisissent pas au gré de leurs envies la manière dont leur travail peut être utilisé, mais font un simple choix binaire : se joindre au commun tel qu’il existe ou non. Le partage inconditionnel est la norme.
Ces différences philosophiques entre la communauté GPL et les utilisateurs des Creative Commons ont tourné à l’affrontement tribal il y a quelques années. Les wikipédiens ont longtemps utilisé la Licence de Documentation Libre élaborée par la Free Software Foundation et se sont opposés aux engagements flous que comportent les contrats Creative Commons, en particulier la licence « pas d’utilisation commerciale, pas d’œuvre dérivée », mais aussi la licence « nations en développement » et le contrat « sampling », ces deux derniers étant aujourd’hui retirés. Cette controverse a été importante, car elle a failli déboucher sur la création de deux corps de contenus libres (légalement accessibles) juridiquement incompatibles, Wikipédia d’une part et les travaux sous licence Creative commons de l’autre. Finalement le conflit a été réglé et les contenus de Wikipédia ont été rendus disponibles également sous une licence Creative Commons « paternité, partage des conditions initiales à l’identique ».
Cette controverse met en exergue le fait que des licences différentes donnent naissance à des « économies des communs » différentes. Et ces économies ne sont pas nécessairement juridiquement interopérables, ce qui implique que les contenus risquent de ne pas être partageables. La prolifération des licences Creative Commons (jusqu’à 18 à une époque, aujourd’hui 7) démontre qu’en privilégiant les choix individuels, on peut fragiliser la construction des communs. L’incompatibilité des licences et les contenus balkanisés représentent « la revanche du choix individuel ».
Construire les communs dans la « maison du droit d’auteur » versus défier le discours sur la propriété ?
Le professeur de droit Niva Elkin-Koren, dans un essai qui propose une « vision critique sur une recherche digne d’intérêt », argumente que les régimes des Creative Commons favorisent les calculs mesquins, égoïstes ainsi que des attitudes à l’égard de la propriété et des transactions individuelles similaires à ceux qui prévalent dans l’économie de marché. Ils ne promeuvent pas une vision cohérente de la liberté susceptible de fortifier les communs en tant que tels. « En utilisant les licences Creative Commons, nous développons un message implicite qui met en avant la norme juridique comme socle du choix individuel » m’a expliqué Elkin-Koren. [406]
Bien entendu, lorsque l’on cherche à construire un mouvement, privilégier le choix individuel est particulièrement utile. Cela respecte les préférences respectives des artistes qui utilisent des médias variés (photographie, vidéo, musique, livre, blogs, etc.) ; tout en encourageant leur participation au mouvement en faveur de la culture libre. Une norme de partage unique, absolue, comme c’est le cas dans la GPL, pourrait paraître rébarbative à plus d’un créateur.
En réalité, comme le professeur Yochaï Benkler l’a souligné, on ne construit pas un commun du numérique comme on construit un mouvement en faveur de la culture libre. Un mouvement grandit à partir de choix individuels et en s’appuyant sur des motivations très variées alors qu’un commun appelle une communauté bien définie et un engagement partagé à l’égard d’objectifs spécifiques.
Le « Global South » et la gauche politique portent eux aussi leurs propres critiques à l’égard des licences Creative Commons en tant qu’outil de construction des communs. Pour les personnes qui vivent dans les pays en sous développement, dans lesquels les institutions publiques sont rares, où les avocats et l’accès aux juridictions est coûteux, les accords sociaux informels sont plus adaptés. Ainsi en Inde, les licences Creative Commons introduisent un cadre de droits de propriété que de nombreux indiens considèrent comme moins avantageux que les régimes de communs sociaux préexistants.
Dans un article juridique qui a fait date, « La vision romantique du domaine public », Anupam Chander et Madhavi Sunder considèrent que le système juridique occidental porterait à croire que le placement des œuvres dans le domaine public est la meilleure façon de les rendre accessibles à tous. « Dans le monde réel », écrivent les auteurs, « les connaissances antérieures, la richesse, le pouvoir et les capacités, rendent certaines personnes mieux à même que d’autres d’exploiter les biens communs. Nous considérons cette conception universitaire couramment répandue des communs comme « romantique »… C’est une approche festive, voire euphorique de la capacité émancipatrice des communs. Mais c’est aussi une vision naïve, idéaliste et bien loin de la réalité » [407]. Toutefois, en superposant domaine public et biens communs, les auteurs ne prennent pas en compte une différence fondamentale : le domaine public se caractérise par l’absence de règles alors que la gouvernance des communs est construite sur des règles.
Quant aux acteurs de la gauche politicienne, nombreux sont ceux qui considèrent que la collaboration des Creative Commons avec des grandes entreprises du secteur technologique est une forme de complicité avec le capitalisme néolibéral. Les chercheurs britanniques David Berry et Giles Moss en appellent à une révolution de la culture plus radicale que celle promue par les défenseurs la culture libre. Ils veulent mettre un point final à la marchandisation de la culture sous toutes ses formes et à l’utilisation pernicieuse du droit d’auteur comme instrument capitalistique. Ce faisant, ils dénoncent les « communs commodifiés [408] », que sous-tend l’usage de licences orientées vers la transaction comme les licences Creative Commons [409].
Marché et biens communs : amis ou ennemis, ou « ça dépend » ?
La question de la relation entre biens communs, marché et monde des affaires appelle une réponse de plus en plus urgente. De fait, marchés et biens communs diffèrent dans leur approche de la valeur, et ceci tant dans la manière de créer de la richesse, que dans celle de la distribuer ou d’instaurer des règles pour organiser les relations entre les populations. Dans un marché, on peut être soit vendeur soit acheteur, l’un comme l’autre se concentrant sur la transaction marchande, régie par des contrats, l’argent et ce que les économistes appellent « l’optimisation de l’utilité ». Un bien commun respecte les relations sociales qui se sont tissées autour d’un objectif commun, et le plus souvent évite les transactions monétaires comme les calculs spécifiques liés au bénéfice individuel.
Sachant cela, comment marché et bien commun peuvent-ils interagir de façon constructive ?
Toute une série de « modèles d’affaires ouverts » (open business models) tentent de répondre à cette question. Encore une fois, la compatibilité entre biens communs et marchés dépend de la définition que l’on veut bien donner aux « communs » comme à « l’open business ». Certains analystes, comme le Professeur Henry Chesbrough considèrent que des activités économiques sont « ouvertes » si elles diminuent ou modifient les contrôles en matière de propriété intellectuelle, ou si elles changent leurs modes d’organisation de manière à récolter les fruits de réseaux ouverts [410].
D’autres considèrent qu’il y a « ouverture » dès lors qu’il s’agit d’un « commun supervisé », à l’image de l’Apple store qui héberge des applications pour l’iPhone. Dans ce scénario, une entreprise recueille les bénéfices de la plateforme ouverte tout en conservant des moyens de contrôle de type propriétaire. Revver, le site de partage de vidéos qui comporte de la publicité ou InnoCentive, la plate-forme ouverte dans laquelle les entreprises posent des requêtes sur leurs projets de recherche auxquelles répondent les chercheurs qui le souhaitent, constituent deux autres exemples de même type.
« La communauté en symbiose avec le marché » constitue un autre modèle, dans lequel une entreprise bâtit un marché sur un bien commun. Eric von Hippel, professeur au M.I.T., explore plusieurs de ces modèles d’affaires dans son livre Democratizing Innovation [411]. Dans ce scénario, les membres du commun collaborent activement avec le monde des affaires, en partageant leurs besoins marchands et les innovations auto-produites, fruits de leurs recherches. Von Hippel se réfère à toute une série de communautés liées à des sports extrêmes (le ski, le skateboard, la voile, etc.) dont les membres enthousiastes sont à l’origine de tout un tas d’idées en matière d’équipement sportif.
Dans ce type de modèle d’affaires ouvert, les commoners produisent tout à la fois de la recherche et du développement, des innovations à la pointe, du marketing viral, et finalement achètent les biens ainsi produits. Le développement d’une relation respectueuse avec les commoners devient alors essentiel pour les entreprises, à moins que ceux-ci ne désirent pas coopérer. The Grateful Dead, le groupe de rock, en laissant ses fans enregistrer et partager ses concerts, constitue un autre exemple de cette démarche. En respectant ses fans, le groupe a récupéré en retour une fidélité sans pareille de leur part, et une grande stabilité des ventes de places de concert, de CD et de produits dérivés.
Le marché à finalité non lucrative constitue une autre catégorie de l’open business. De telles entreprises réussissent à combiner des ventes sur le marché avec une mission à but non lucratif. Dans les sites en ligne, il s’agit d’entreprises qui accueillent de larges communautés de fans, tout en générant des revenus par la vente de publicité. C’est le cas du site de musique Jamendo ou du site d’information politique Talking Points Memo. L’objectif alors n’est pas de maximiser les profits mais de générer suffisamment de chiffre d’affaires pour faire vivre le projet.
Les coopératives non-marchandes constituent un autre modèle d’affaire ouvert qui repose sur les communs. L’objectif de ces coopératives est de protéger de l’appropriation marchande et du commerce la ressource dans son intégrité, et ce faisant d’encourager les libertés créatives et la vie sociale des participants. Les coûts de fonctionnement et de gestion sont alors souvent minimes, et ils sont généralement pris en charge indirectement, par les revenus dégagés d’un travail alimentaire ou d’un poste universitaire.
Comme le suggère cette taxonomie élémentaire des relations entre biens communs et monde des affaires, il existe une large panoplie de modèles, dont l’enracinement dans le monde des communs peut parfois prêter à discussion. Il me semble que le principe suivant peut nous aider à savoir s’il y a effectivement ou non un bien commun à l’œuvre : ce qui est issu des communs, doit demeurer dans les communs… à moins que les commoners n’en décident explicitement autrement.
La force transformatrice des Communs
Qu’à terme nous arrivions ou non à résoudre ces questions, les biens communs constituent en tout état de cause un cadre narratif séduisant. Ils permettent de connecter et coordonner des tribus disparates de commoners et proposent une vision de l’ordre social qui fait sens, tant du point de vue historique que politique ou culturel. Étant porteurs de quelques principes généraux applicables à la plupart des communs, ils peuvent jouer ce rôle unificateur :
— Maintenance d’une ressource sur le long terme ;
— Accès équitable et bénéfice pour un usage individuel (et non marchand) des commoners ;
— Transparence et responsabilité au sein de communs ;
— Capacité à identifier et punir les passagers clandestins, le vandalisme, et les appropriations ;
— Capacité à déterminer si la ressource doit être aliénée en vue d’un usage marchand ou non.
Contrairement aux idéologies traditionnelles, qui fixent une fois pour toutes des principes censés s’appliquer de façon universelle, les biens communs fonctionnent comme une sorte d’échafaudage ou de méta-idéologie. Leurs principes généraux ne peuvent être mis à jour qu’au regard d’un contexte donné, tout comme l’ADN est constitué de manière à ce que l’organisme puisse s’adapter aux conditions locales. Tout importe : les conditions historiques propres à la communauté, les circonstances locales, les normes culturelles, l’éthique collective, et la nature même de la ressource placée en commun. La particularité est un principe fondateur des communs.
Le discours sur les biens communs puise sa force dans sa capacité à dialoguer non pas uniquement avec l’économie, les sciences politiques et la politique, mais aussi avec la culture, les réalités écologiques et la vie de tous les jours. Les communs portent en eux une épistémologie et une ontologie implicites qui diffèrent de celles véhiculées par le marché et l’État. Les communs suggèrent un autre rapport au savoir et à l’être, qui puisent dans l’individu, le social, l’histoire et le tacite. Le savoir n’est ni décontextualisé, ni réifié comme un objet canonique ; il « n’appartient » ni à des experts accrédités ni à des institutions. À l’inverse, le savoir est comme un flux en mouvement continu, ancré dans une pratique sociale.
En traitant des communs, nous rendons possible une nouvelle relation entre nous-mêmes et une ressource donnée, entre nous et l’État, entre nous et les autres êtres humains. Les biens communs proposent une autre approche du monde. Les communs sont tout à la fois un discours et un autre rapport au monde. Ce qui en fait un verbe : la pratique sociale du « commoning ».
Aujourd’hui nous faisons plus que découvrir les communs, nous les inventons. Nous apprenons comment interagir et nous engager en explorant des méthodes à la fois nouvelles et anciennes. Au bout du compte, après le long drame qu’ont constitué le XXe siècle et la consolidation du pouvoir menée par les États et les entreprises, nous sommes en train de redécouvrir des manières élémentaires d’interagir entre humains et d’organiser les vies sociale et économique. Nous ressuscitons des traditions oubliées et des pratiques culturelles issues du commoning.
En affirmant un intérêt collectif sur les ressources, les biens communs nous aident à questionner les justifications usuelles en faveur d’une extension des droits de propriété privée. Les communs nous permettent de comprendre que les droits de propriété privés eux-mêmes sont ancrés dans des relations sociales et communautaires auxquelles il convient de rendre leur véritable sens. Hérésie aux yeux de l’orthodoxie néolibérale, le discours des communs affirme qu’il y a des limites aux revendications de la propriété privée sur la communauté et sur la Terre.
En défrichant de nouvelles critiques à l’encontre de l’emprise des droits de propriété et des marchés, la discussion sur les biens communs nous aide à dépasser les illusions artificielles et les trahisons secrètes du néolibéralisme. Le néolibéralisme nous a promis la liberté et le respect des valeurs humanistes, mais sous condition de demeurer dans le cadre strict des « marchés libres ». Nous savons aujourd’hui où cela nous mène.
Les biens communs ne sont à l’évidence ni le socialisme, ni le communisme. Une affinité peut apparaître entre les communs et ces efforts antérieurs pour promouvoir l’égalité, la communauté et la liberté, mais au bout du compte les biens communs ne traitent ni de gouvernement ni de politique publique. Ils ne parlent que de l’autonomie des commoners, de leurs ressources et de leurs pratiques sociales. En prenant en compte les ressources cachées liées aux communs et aux externalités ignorées du néolibéralisme, l’approche par les communs propose à la fois une économie plus holistique, plus durable, et de nouveaux modèles de culture politique.
La pensée sur les communs aide les commoners à affirmer une forme de solidarité sociale entre eux ; ils ne sont pas les simples individus atomisés soumis au marché, ils fabriquent les liens sociaux. Le discours des biens communs constitue une sorte de « signal social » qui permet à toutes sortes de commoners de s’identifier les uns les autres, une fonction essentielle au vu de la fragmentation des efforts de résistance actuels et de la capacité renouvelée de l’ordre néolibéral à récupérer les dissidents.
Au bout du compte, l’efficacité de la pensée sur les biens communs tient au fait qu’elle n’est pas seulement réactive. Elle ne se réduit pas à une critique des dysfonctionnements. Elle est créatrice et générative. Elle offre des alternatives positives aux marchés et aux politiques néolibérales. Elle propose aux gens des méthodes ascendantes, auto-organisées pour gérer de façon démocratique et durable des ressources, sans nécessairement avoir recours direct à un gouvernement.
Nous ne sommes qu’au tout début d’une Grande Floraison. Je suis convaincu que le mouvement des communs qui émerge nous aidera à récupérer bien plus que les biens qui nous ont été confisqués par les enclosures. Les biens communs nous permettent de retrouver notre identité en tant que créatures de la nature et à reprendre la mesure de notre humanité.
***********************************************************************************

David Bollier est un auteur, un activiste et un chercheur indépendant qui étudie les communs comme nouveau paradigme pour l’économie, la politique et la culture depuis plus de dix ans. Il est cofondateur du Commons Strategy Group, un groupe international de consultants sur les biens communs. Parmi ses nombreux livres, on retiendra Silent Theft : The Private Plunder of Our Commons Wealth (2002), Brand Name Bullies : The Quest to Own and Control Culture (2005) et Viral Spiral : How the Commoners Built a Digital Republic of Their Own (2009). On peut le retrouver sur son blog : http://bollier.org
***********************************************************************************
[380] Garrett Hardin, « The Tragedy of the Commons », Science, December 13, 1968, pp. 1243-1248.
[381] Voir la traduction de l’introduction du livre de Peter Linebaugh dans cet ouvrage : Histoire des communs : l’ombre portée de la Grande Charte.
[382] Edward P. Thompson, Customs in common : studies in traditional popular culture. New Press, 1991. p. 560.
[383] La gouvernance des biens communs : Pour une nouvelle approche des ressources naturelles, Elinor Ostrom, De Boeck, 2010 (traduction française de Governing the commons, 1992).
[384] See, e.g., Charlotte Hess and Elinor Ostrom, editors, Understanding Knowledge as a Commons : From Theory to Practice (Cambridge, Massachusetts : M.I.T. Press, 2007) ; Hess and Ostrom, « Ideas, Artifacts and Facilities : Information as a Common-Pool Resource » in Law and Contemporary Problems, vol. 66, no. 1 & 2 (Winter/Spring 2003), pp. 111-146 ; and Digital Library on the Commons, at http://dlc.dlib.indiana.edu. Voir aussi dans ce livre l’article de Charlotte Hess, Inscrire les communs de la connaissance dans les priorités de recherche.
[385] Lawrence Lessig, Code and other Laws of Cyberspace (New York : Basic Books, 1999).
[386] Voir notamment Jonathan Zittrain, The Future of the Internet and How to Stop It (Yale University Press, 2008).
[387] Yochaï Benkler, La richesse des réseaux, Marchés et libertés à l’heure du partage social, Presse Universitaire de Lyon, 2009.
[388] Voir par exemple, Yochaï Benkler, The Wealth of Networks, pp. 225-232. Un collectif citoyen organisé au travers de l’internet continue de scruter les failes des machines à voter : http://www.blackboxvoting.org
[389] Jonah Bossewitch, « The Zyprexa Kills Campaign : Peer Production and the Frontiers of Radical Pedagogy », Re-public, at http://www.re-public.gr/en/?p=144
[390] David Bollier, Viral Spiral : How the Commoners Built a Digital Republic of Their Own New York : New Press, 2009.
[391] David R. Johnson, « The Life of the Law Online », First Monday, vol. 11, no. 2 (February 2006), at http://firstmonday.org/issues/issue...
[392] Open source ecology est un réseau qui utilise le web pour aider les volontaires à construire des équipements pour l’agriculture éco-compatible ; Le Global Villages Network est une communauté mondiale de villageois innovateurs qui utilisent les réseaux numériques pour accroître leur autonomie économique locale et protéger leur environnement. Ces exemples appartiennent à une forme hybride de gouvernance des communs.
[393] NDT : Liberal fait référence ici au libéralisme politique et non au libéralisme économique. Dans la politique des États-Unis, les libéraux sont proches de ce que nous appelons la gauche en France.
[394] David Bollier, « When Push Comes to Pull : The New Economy and Culture of Networking Technology », The Aspen Institute Communications and Society Program, Washington, D.C. : 2006.
[395] Elinor Ostrom, Op. Cit.
[396] Yochai Benkler, « Sharing Nicely : On Shareable Goods and the Emerging of Sharing as a Modality of Economic Production », 114 Yale Law Journal 273 (2004), at http://benkler.org/SharingNicely.html
[397] Ostrom, Governing the Commons, p. 29.
[398] Cet exemple de la place de parking illustre aussi les tensions qui peuvent naître entre les gouvernements et les communs. Dans ce cas particulier du commun de voisinage de Boston, une personne extérieure qui retirerait la chaise se verrait sanctionnée par des pneus crevés. Ceci pose clairement la question des instances susceptibles de gérer ce parking : les voisins auto-organisés, ou la communauté urbaine ? Et de savoir si les instances collectives élues peuvent outrepasser les choix de gouvernance des voisins, et leur propre sens du savoir-vivre et de l’efficacité ?
[399] Robert Ellickson, Order Without Law : How Neighbors Settle Disputes, Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 1994.
[400] Charles Schweik, The Collaborative Principles of Open Source Commons http://www.umass.edu/digitalcenter/...
[401] Mathieu O’Neil, Cyberchiefs : Autonomy and Authority in Online Tribes, New York : Pluto Press, 2009.
[402] Jöhan Soderberg, Hacking Capitalism : The Free and Open Source Software Movement, New York : Routledge, 2007.
[403] Jonathan Zittrain, The Future of the Internet and How to Stop It, Yale University Press, 2008, chapter 6, pp. 127-148.
[404] Yochai Benkler and Helen Nissenbaum, « Commons-based peer Production and Virtue », The Journal of Political Philosophy, vol. 14, no. 4 (20076), pp. 394-419.
[405] Voir par exemple l’article de Phoebe Connelly sur le destin du serveur GeoCities : « Neo Cities : How Online Communities Are Born – And What Happens When They Die », The American Prospect, 17 août 2009, http://www.prospect.org/cs/articles...
[406] Interview with Niva Elkin-Koren, January 30, 2007.
[407] Anupam Chander and Madhavi Sunder, « The Romance of the Public Domain », California Law Review, vol. 92, no. 1131 (2004), p. 1341. (traduction partielle dans ce livre : La vision romantique du domaine public).
[408] Commodifié est employé ici au sens de transformation en un bien pouvant être échangé sur un marché (n.d.t.)
[409] David Berry and Giles Moss, « On the ‘Creative Commons’ : A Critique of the Commons Without Commonality », Free Software Magazine, July 15, 2005, at http://www.freesoftwaremagazine.com...
[410] Henry Chesbrough, Open Business Models : How to Thrive in the New Innovation Landscape, Cambridge, Massachusetts : Harvard Business School Press, 2006.
[411] Eric von Hippel, Democratizing Innovation, Cambridge, Massachusetts : M.I.T. Press, 2005.
©© Vecam, article sous licence creative common
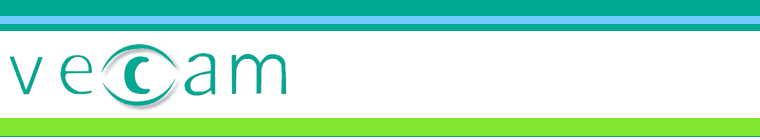

 Réflexion et propositions
Réflexion et propositions Libres savoirs, les biens communs de la connaissance
Libres savoirs, les biens communs de la connaissance Imprimer la page
Imprimer la page