10 - Les paysans sont-ils les protecteurs des semences locales ?
Cet article a été écrit en janvier 2009 spécialement pour ce livre. Il vise à donner des références pour mieux comprendre le contexte hautement évolutif des législations concernant les semences.
Un bien commun peut-il avoir un propriétaire ? Existe-t-il une forme équitable de propriété intellectuelle sur le vivant ? Le Certificat d’Obtention Végétale en serait-il le modèle ? Les semences sont-elles un « patrimoine commun de l’humanité » ? Devons-nous revendiquer des « semences libres » de toute entrave à leur commercialisation ? Le progrès scientifique est-il bon en soi, en dehors du cadre juridique qui le gouverne ? Ces questions traversent les mouvements sociaux, souvent de manière passionnelle, sans avoir encore trouvé de réponses consensuelles. Le but de cet article est d’apporter une touche d’éclairage, depuis la France, pays « inventeur » du système semencier formel en passe de conquérir la planète.
La biodiversité ne se conserve pas et ne se reproduit pas, elle se renouvelle
Avant d’être un bien commun en compagnie duquel nous co-évoluons, la semence est l’organe de reproduction d’organismes vivants autonomes, les plantes. Chaque fois qu’un enfant vient au monde, chacun regarde s’il a les yeux de sa mère, la bouche de son père… pour finalement admettre que, s’il ressemble un peu plus à ses parents, il reste un individu unique ressemblant à tous ses semblables en général et à aucun d’entre eux en particulier. Ainsi va la biodiversité : c’est le renouvellement permanent qui est la source et la condition de la création de formes nouvelles, à chaque génération chez les organismes à multiplication sexuée et à chaque mutation génétique ou échange de gènes pour l’ensemble des organismes vivants. Ce renouvellement permanent précède le temps de l’équilibre, opéré grâce à l’émergence de caractères nouveaux et à la sélection naturelle et/ou humaine. Le renouvellement de la biodiversité est garant de la vie elle-même, qui disparaîtrait si tous les organismes vivants étaient semblables et incapables de s’adapter aux évolutions de leur environnement. Les graines voyagent mais donnent naissance à des plantes qui ne sont pas mobiles : une fois enracinées, seules leur diversité et leur grande variabilité génétiques au sein d’un même territoire leur permettent de s’adapter à la diversité des terroirs et des climats. C’est pourquoi les paysans ont toujours adapté leurs semences ou plants[124] en combinant le prélèvement dans leurs propres cultures et l’échange entre eux de petites quantités destinées à renouveler cette diversité et cette variabilité. Ces échanges ont donné naissance à de multiples variétés, que l’on peut considérer comme des biens communs, résultats du travail et des savoirs des communautés rurales qui les ont sélectionnées et entretenues.
L’industrie contre la biodiversité
Le système semencier formel remplace ces échanges par le marché de masse. Or celui-ci a horreur de la diversité ; il ne supporte que des lots standardisés, homogènes et stables. Un siècle d’ « amélioration des plantes » a répondu à cette demande avec les méthodes de sélection eugénistes[125] en vogue au siècle dernier : multiplication à l’identique de l’individu élite et éradication des hors-type. Un nouvel acteur a remplacé le paysan pour sélectionner et multiplier hors du champ de production agricole ces nouvelles semences élites : l’industrie semencière, appuyée par les industries agroalimentaires et des pesticides. Les variétés homogènes sont en effet indispensables aux transformations industrielles. Et si les semences sont toutes identiques, les paysans ne peuvent plus les adapter à la diversité des terroirs qu’ils cultivent : ils doivent au contraire homogénéiser les conditions de culture par l’usage des engrais chimiques et les pesticides industriels pour lesquelles les variétés ont été sélectionnées.
Les hybrides F1 et le catalogue pour interdire les semences paysannes
Pour imposer ses semences, l’industrie a cherché à éliminer son principal concurrent, la semence reproduite chaque année avec la récolte du paysan. Elle a eu pour cela recours à deux stratégies, l’une technique, l’autre juridique.
Les semenciers américains ont travaillé surtout le maïs, qui est une plante allogame, c’est-à-dire dont la fécondation doit nécessairement résulter de croisement entre plusieurs plantes différentes pour éviter la dépression consanguine. Cette particularité leur a permis de mettre au point les « hybrides F1 » économiquement stériles [1], première plante sans descendance fabriquée par l’homme bien avant le célèbre OGM Terminator. Adaptés à l’engrais chimique et à la mécanisation des récoltes, ces hybrides ont remplacé dans les champs d’agriculture industrielle les maïs-population traditionnels dont les paysans pouvaient ressemer la récolte.
En Europe, les semenciers ont investi sur le blé, plante essentiellement autogame [2]. Un catalogue obligatoire a été mis en place pour recenser les variétés dont les semences sont commercialisées ou échangées à titre gratuit. Ne peuvent y être inscrites que des variétés stables et homogènes : tout échange de semences paysannes diversifiées et variables est alors interdit et le semencier a ainsi un droit exclusif à produire des semences. En effet, si le paysan ressème sa récolte, la biodiversité réapparaît progressivement. Les semenciers disent que leurs variétés « dérivent dans le champ du paysan ». En effet, en pollinisation libre, les plantes autogames ne se reproduisent qu’en sortant des caractères homogènes et stables de la variété inscrite au catalogue. La semence commerciale ne peut pas être obtenue sans revenir aux semences de base sélectionnées et détenues par le semencier. Certains pays rajoutent ou remplacent le catalogue par la certification obligatoire des semences commerciales.
Le brevet sur la variété et le Certificat d’Obtention Végétale (COV)
L’ouverture des marchés aiguise la concurrence et provoque, avec la concentration de l’industrie, l’augmentation de ses capacités de recherche. L’émergence des biotechnologies met à l’ordre du jour la protection des innovations par des Droits de Propriété Intellectuelle (DPI).
Le brevet américain protège les lignées parentales des hybrides F1. Ces hybrides sont de réelles inventions, ils n’ont plus rien à voir avec les variétés reproductibles de maïs-population des paysans qui ont servi de base de sélection. Le brevet sur la variété [3] permet aussi, pour les variétés reproductibles, d’interdire par contrat au fermier de reproduire sa semence. Mais ce contrat est peu applicable tant que la variété n’est décrite que par ses caractères morphologiques, qui « dérivent » dans le champ du paysan ce qui rend très difficile la preuve de la contrefaçon. Enfin, conformément au libéralisme nord-américain, ce brevet n’interdit pas la production ni l’échange des semences paysannes issues de variétés non protégées.
L’industrie européenne dispose du catalogue pour interdire les semences paysannes, mais celui-ci n’empêche pas un semencier de récupérer les lignées de ses concurrents pour commercialiser leurs variétés. Par ailleurs, l’essentiel des premières variétés de blé protégées est directement issu des épis prélevés par les semenciers dans les champs des paysans. Cela conduit l’industrie à compléter, en 1961, le catalogue avec le Certificat d’Obtention Végétale qui, comme le brevet sur la variété aux États-Unis, interdit la reproduction d’une variété sans l’autorisation de son obtenteur. Mais contrairement au brevet, le COV protège les découvertes et pas uniquement les inventions [4] : l’obtenteur peut s’approprier la variété qu’il a prélevée dans le champ d’un paysan, puis homogénéisée, stabilisée et décrite suivant les mêmes critères morphologiques que pour le catalogue. Cette légalisation du biopiratage aurait été acceptée en échange du « privilège » du fermier qui, en 1961, continue à utiliser librement sa récolte comme semence. En fait, le COV ne permet pas plus que le brevet sur la variété d’amener la preuve d’une contrefaçon. Cela engendre aussi le « privilège de l’obtenteur » d’utiliser librement les variétés de ses concurrents pour en créer de nouvelles. En effet, contrairement au brevet qui rend obligatoire la description de l’invention, donc des ressources génétiques utilisées, le COV ne permet pas de retrouver la trace des variétés utilisées pour en créer une nouvelle. Ces « avantages » du COV sur le brevet, largement soulignés par la propagande, ne sont donc que le résultat de la légalisation du biopiratage. Par contre, le COV permet de garder secrètes, contrairement au brevet, les techniques de sélection utilisées.
En 1991, alors que les premiers OGM sortent des laboratoires, les obtenteurs réunis au sein de l’UPOV [5] étendent la protection du COV aux « variétés essentiellement dérivées » (VED) afin de contraindre le propriétaire d’un transgène breveté à partager ses royalties avec le propriétaire de la variété protégée dans laquelle il l’a inséré. En 1998, une Directive européenne autorise la double protection, du COV sur la variété et du brevet sur le gène [6]. Cette extension du COV aux VED permet aussi de faire de la semence de ferme une contrefaçon : tout comme avec le brevet, elle est désormais interdite ou soumise au paiement de royalties. Mais le COV ne permet toujours pas aux obtenteurs d’amener la preuve de la contrefaçon et les obtenteurs multiplient les stratagèmes pour récupérer leurs royalties : prélèvement par les entreprises de triage des semences de ferme, taxe à l’hectare, Contribution Volontaire Obligatoire (CVO) payée par tout agriculteur qui n’a pas acheté de semences (même s’il a utilisé une variété non protégée ou qu’il a lui-même sélectionnée [7]), contrats d’intégration…
Le fichage génétique des plantes
Avec le « marquage moléculaire », l’industrie trouve enfin l’outil qui lui manquait pour traquer les contrefaçons jusque dans les champs, comme les cow-boys marquant leurs veaux au fer rouge. Qu’il s’agisse de ressemis volontaire ou de contamination fortuite, une simple analyse génétique lui permet de récupérer ses royalties. C’est ainsi que Monsanto a fait condamner le canadien Percy Schmeiser dont le champ de colza conventionnel a été contaminé par du colza transgénique breveté. Avec le séquençage génétique à haut débit, l’ensemble des gènes des plantes sont peu à peu identifiés. L’identification moléculaire des variétés inscrites au catalogue, protégées par un brevet ou un COV, ou conservées dans les banques de gènes, est déjà engagée [8]. Toutes les contrefaçons pourront ainsi être poursuivies. Autre intérêt pour l’obtenteur : limiter fortement la possibilité qu’ont ses concurrents d’utiliser sa variété pour en créer une autre, privilège pourtant présenté comme un des principaux avantages du COV par rapport au brevet accusé de limiter l’innovation par le phénomène des « brevets en cascade » résultant de l’interdiction de cette utilisation.
Les OGM clandestins
L’identification officielle de la variété entraîne l’obligation d’information. Refroidis par le refus des OGM par 80 % des européens, les semenciers trouvent aujourd’hui avec le COV un moyen efficace pour contourner cette obligation. La définition légale des OGM s’arrête à la transgénèse : les autres technologies de manipulation génétique [9] sont ainsi exemptées des obligations d’évaluation des risques et d’étiquetage. Grâce au COV qui, contrairement au brevet, contourne l’obligation d’information sur les méthodes de sélections utilisées, nous mangeons déjà sans le savoir des blés mutés, des choux enrichis de gènes de radis et autres merveilles concoctées dans les laboratoires. La campagne aujourd’hui orchestrée en Europe pour promouvoir les avantages du COV sur le brevet n’a d’autre but que de remplacer les OGM visibles par ces OGM clandestins.
Si le COV de 1991 a quelques avantages sur le brevet, ce n’est certainement pas par son caractère éthique. Les inventeurs du brevet s’en sont aperçus : les USA ont adopté le cumul des deux régimes chez eux et l’imposent, comme l’Union Européenne, dans tous les accords bilatéraux qu’ils négocient.
La confiscation des ressources génétiques
La biodiversité cultivée est la matière première des semenciers. Cependant, en interdisant les semences paysannes, les lois promulguées à la suite de leur travail de lobby menacent cette biodiversité cultivée de disparition. C’est pourquoi les États ont organisé la collecte de ces semences avant qu’elles ne disparaissent. En 1983 la FAO [10] déclare que les « ressources phytogénétiques sont un patrimoine commun de l’humanité, et doivent être préservées et librement accessibles pour être utilisées dans l’intérêt des générations présentes et futures ». Les semences paysannes de tous les champs du monde, au moment même où leur usage traditionnel de renouvellement par les communautés paysannes est rendu difficile, deviennent ainsi une ressource librement accessible pour l’industrie. En devenant monnayable sur le marché de l’humanité, autrement appelé marché mondial, ce patrimoine devient aliénable. D’un côté les semences issues du travail et des savoirs paysans sont décrétées communes à tous mais non commercialisables lorsqu’il y a un catalogue ou une certification obligatoire, de l’autre leur exploitation commerciale en fait des biens marchands privatisés par l’industrie semencière grâce aux droits de propriété intellectuelle.
Au départ, les collections publiques ainsi constituées sont accessibles à tous. Mais aucun moyen n’est donné aux petits paysans pour leur permettre d’avoir accès à ce trésor prélevé dans leurs champs. Au contraire, la confidentialité de l’information, l’absence d’identification correspondant à la culture et de multiples barrières administratives le leur interdisent. En 1992 à la Convention de Rio, les pays du Sud qui hébergent la plus grande part de la biodiversité mondiale revendiquent un partage des bénéfices issus de l’exploitation commerciale de leurs ressources. L’industrie semencière en profite pour leur imposer la reconnaissance des DPI sur le vivant qui engendrent ces bénéfices. Depuis, seuls quelques très rares brevets n’ont pas contourné l’obligation de partage et tous les COV l’ont contourné vu qu’ils n’indiquent pas l’origine des variétés utilisées [11]. Et tout le monde en a profité pour placer les collections sous la souveraineté des États. Au nom du principe du libre consentement préalable, ceux-ci en interdisent de plus en plus l’accès aux paysans dont les parents ont pourtant fourni tout ce qui s’y trouve sans recevoir la moindre contrepartie ; mais ils maintiennent un accès privilégié à l’industrie au prétexte qu’elle met à disposition une infime partie de ses propres collections.
La biologie synthétique ou le remplacement du monde naturel par le virtuel
Après avoir sélectionné par croisement naturel des plantes élites, puis en avoir manipulé le génome, l’industrie s’est mise à fabriquer des gènes synthétiques, sur la base de séquences virtuelles numérisées dans ses ordinateurs. Les transgènes des OGM sont des copies approximatives de fragments de gènes naturels, fabriquées par synthèse chimique. La prochaine étape annoncée est la plante entièrement synthétique. Au prétexte de manque d’argent, les banques de gènes nationales sont abandonnées, réduites à des collections de gènes [12], numérisées [13] ou privatisées. Dans le même temps, les centres d’origine et de diversification [14] des principales plantes alimentaires sont méthodiquement contaminés par des OGM brevetés [15]. Depuis 2008, une « banque de l’apocalypse », accessible aux seules multinationales semencières, conserve toutes les semences du monde dans les glaces d’une île norvégienne [16]. Ces semences congelées ne seront jamais replantées pour garder leur capacité germinative. La biologie synthétique n’a pas besoin de graines vivantes mais uniquement des séquences génétiques numérisées, récupérables sur des graines mortes, et destinées à la reproduction par synthèse chimique : est-ce pour cela que les multinationales ont décidé de laisser mourir les graines des banques ?
Les droits collectifs des paysans, des jardiniers et des communautés
La biodiversité cultivée est un bien commun inaliénable : héritage des communautés paysannes qui l’ont sélectionnée et renouvelée pendant des millénaires, nous l’empruntons à nos enfants. Jusqu’à la récente apparition de l’industrie semencière, toutes les variétés cultivées étaient reproductibles et ont d’abord été des variétés locales. Elles ont toutes été sélectionnées et conservées dans une région déterminée, par une communauté humaine déterminée, dans le respect de droits d’usage collectifs, souvent non écrits, négociés au sein de ces communautés : droit de conserver, ressemer et échanger les semences en suivant certaines règles agronomiques et sociales, ou des règles concernant les protections contre les flux de pollen exogène, la consommation alimentaire ou le vol du stock semencier, les guerres, les plantes invasives, le remplacement des variétés adaptées localement par des cultures momentanément plus profitables ou imposées de l’extérieur. Il devient nécessaire aujourd’hui d’étendre ces droits et règles à la participation des communautés paysannes aux décisions concernant la gestion des ressources publiques, l’accès aux semences de leurs parents enfermées dans les banques de gènes, la protection contre les contaminations transgéniques, contre les semences industrielles subventionnées, les délocalisations et la biopiraterie, la protection de savoirs paysans ou communautaires. Cela nécessite une obligation d’information sur l’origine et la méthode de sélection utilisée pour toute semence commercialisée. Ces droits ne sont ni des droits de propriété, ni des droits individuels, mais des droits collectifs d’usage.
Les caractéristiques susceptibles d’identifier une variété paysanne ne se réduisent pas à ses caractères morphologiques ni à son génome numérisé, mais concernent aussi ses caractères agronomiques, gustatifs, nutritionnels, culinaires, d’adaptation aux techniques de transformation, culturels, religieux, paysagers… tous issus de leur ancrage territorial, social et économique. Aucune variété n’existe sans un lien fort avec la communauté humaine qui l’a sélectionnée et renouvelée. La réduire à ses caractères morphologiques ou numérisables permettant de la faire rentrer dans un catalogue, ou un patrimoine de l’humanité désincarné, revient à la séparer des autres caractères liés à son ancrage territorial, économique, social et culturel pour faciliter son appropriation par le commerce anonyme et les DPI. C’est une négation des droits collectifs des communautés qui aboutit à leur destruction et à celle de leur environnement économique, social et culturel.
Dans les pays riches, les communautés rurales traditionnelles ont pour la plupart disparues, remplacées par l’agriculture industrielle. Mais aujourd’hui, de nouvelles communautés apparaissent, souvent constituées en réseaux – non nécessairement ancrés dans un territoire, mais reliés par un modèle agricole, économique et social autonome et relocalisé. Ces communautés se construisent autour de nouvelles variétés paysannes qu’elles sélectionnent et renouvellent à partir des ressources encore accessibles des collections publiques. Elles doivent déterminer les règles d’usage de leurs semences. Tant que ces règles ne sont pas déterminées collectivement, il revient à chacun de leurs membres d’engager sa responsabilité : va-t-il obéir aux lois du marché et céder des semences à celui qui ne saura ou ne pourra pas les cultiver correctement, à celui qui favorisera une concurrence déloyale, qui détruira la communauté à l’origine de la variété, la biopiraterie, l’appropriation de la variété, la fabrication d’OGM… ? Ou décidera-t-il que la variété est suffisamment stabilisée et connue pour être diffusée partout sans risque ? Ou qu’elle est encore trop jeune et fragile et qu’il ne peut en céder la semence qu’à celui qui est digne de la soigner et dans la quantité qu’il peut soigner correctement ?
Ces droits collectifs sont inaliénables, non marchands : un droit d’usage qui est vendu peut être acheté par un particulier et devenir privé. Ils sont négociés, d’abord au sein de chaque communauté, ensuite entre les communautés. La liberté du commerce ne peut être envisagée qu’après ces négociations.
Semences libres ou bien commun des communautés ?
La semence paysanne ne peut pas faire partie d’un quelconque patrimoine de l’humanité : la gestion dynamique de la biodiversité ne se gère pas au niveau de la planète, mais au niveau des territoires et des communautés. Au contraire des variétés industrielles standardisées, les semences paysannes utilisées sur un territoire ou dans un modèle agricole et social donné sont sélectionnées et multipliées sur ce territoire et/ou dans ce modèle agricole et social pour pouvoir s’y adapter naturellement. Ces semences peuvent circuler d’un territoire ou d’un modèle à un autre : cela permet de renouveler leur diversité interne (en éveillant des caractères qui disparaissaient dans leur milieu d’origine), la diversité du stock semencier dans lequel elles sont introduites, ou de donner naissance à de nouvelles variétés adaptées au nouveau lieu et à la culture de ses habitants. Mais avant d’être développées à grande échelle dans un nouveau territoire, elles doivent d’abord y être adaptées par plusieurs multiplications/sélections successives. Les échanges de semences paysannes exogènes se font, sauf cataclysme exceptionnel, en petite quantité. Le commerce de ces semences est donc soit local, soit réduit à des petites quantités, contrairement au commerce mondial qui approvisionne par exemple la planète entière avec des semences industrielles de maïs multipliées au Chili.
Les semences sont aujourd’hui soit le bien commun d’une communauté, soit un produit industriel marchand protégé par un droit de propriété intellectuelle. Les premières doivent rester soumises aux droits collectifs d’usage de la communauté qui les cède et de celle qui les reçoit. Seules ces communautés peuvent décider si ces semences sont libres ou non. Les secondes ne doivent pas être plus libres que le renard dans le poulailler : leur circulation doit être soumise à l’évaluation et l’acceptation par les communautés locales d’éventuels risques pour la santé, l’environnement et les systèmes agraires et culturels locaux. Les OGM et autres biotechnologies doivent être interdits.
Les échanges entre communautés, les guerres et le commerce ont dispersé des graines loin de leur région d’origine. Certaines espèces, comme les potagères qui sont cultivées, même en condition naturelle, dans des jardins très artificialisés assez semblables d’une région à l’autre, ou bien les plantes pérennes – arbres fruitiers, vignes –, évoluent moins vite lorsqu’elles voyagent. Avec le commerce mondial, de nombreuses variétés anciennes ont ainsi perdu tout lien avec leur communauté d’origine qui a parfois disparu. Elles sont libres de droits d’usage communautaire et la sélection conservatrice les maintient libres de DPI… jusqu’à ce qu’elles s’enracinent à nouveau ou qu’un semencier se mette à les trafiquer. Si les variétés libres de droit font partie d’un patrimoine commun de l’humanité, ce n’est pas pour autant le cas de la majorité des variétés paysannes liées à des droits collectifs locaux.
Savoirs privatisés ou recherche participative ?
La diversité enfermée dans les collections ne se renouvelle pas. Elle s’érode avec le temps. Au prétexte de manque d’argent, sa destruction est programmée. La majorité des paysans du monde pratique une agriculture vivrière : ils renouvellent encore la biodiversité en utilisant leurs propres semences parce qu’ils n’ont pas d’argent pour acheter celles des semenciers. C’est pourquoi les obligations d’inscription au catalogue ou de certification des semences ne concerne généralement que les semences vendues ou échangées « en vue d’une exploitation commerciale », ce qui exclut la sélection, la recherche et les échanges informels de semences liés aux agricultures vivrières qui survivent aussi dans l’occident riche sous forme de jardinage « amateur » [17]. De même, le TIRPAA [18] reconnaît la contribution passée, présente et future des communautés autochtones et des agriculteurs à la conservation des ressources phytogénétiques, ainsi que leurs droits qui en découlent : de protéger leurs connaissances traditionnelles, de partager les avantages, de participer aux décisions nationales concernant les ressources ainsi que de conserver, ressemer, échanger et vendre les semences de ferme. Mais la responsabilité de la mise en œuvre de ces droits est laissée aux États.
Cette ouverture est-elle un simple affichage ou traduit-elle une véritable volonté ? Avec la fable du COV qui libèrerait la semence du brevet, la propagande de l’industrie relance aujourd’hui le concept de « patrimoine de l’humanité » pour justifier une nouvelle campagne de collecte de l’ensemble de la biodiversité sauvage et cultivée et des savoirs populaires associés. À force de croiser dans tous les sens les ressources disponibles, elle arrive au bout des innovations ainsi possibles. Mais aujourd’hui, l’industrie s’est affranchie de la barrière des espèces et, comme la pharmacie, elle utilise l’ensemble des gènes issus de la biodiversité sauvage tout autant que cultivée. La connaissance des savoirs traditionnels associés aux plantes lui permet pour cela de ne pas travailler à l’aveuglette. Avec la propagande autour des crises alimentaire, climatique et énergétique, son projet est de s’emparer des trois quarts de la biodiversité mondiale encore sauvage comme elle s’est emparée du quart cultivé. Cette volonté va au-delà de l’appropriation brutale de terres, de forêts, de rivières ou du sous-sol, pour s’étendre au vivant lui-même. Cette appropriation serait de surcroît « légitime » si on accepte de considérer la biodiversité comme patrimoine commun de l’humanité et non des communautés qui vivent sur les territoires et entretiennent et renouvellent les ressources naturelles. Cette expansion de la confiscation des biens communs passe par un glissement du brevet sur les organismes vivants vers le brevet sur les gènes, les atomes, les nanoparticules ou les bits, ainsi que sur les services technologiques d’exploitation de la biodiversité.
La question posée à la société civile n’est pas celle de la valeur marchande des ressources et des savoirs populaires, mais de la légitimité de leur collecte destinée à les rendre disponibles pour l’industrie et la recherche. Les savoirs sont aussi des biens communs : peuvent-ils être marchands ? Une recherche « scientifique » dont le seul moteur est la privatisation au travers d’un droit de propriété intellectuelle peut-elle produire des résultats bénéfiques pour la société ? Ou seulement pour les détenteurs du DPI, contre la société ? Les OGManipulés et les OGMutés existeraient-ils sans le brevet sur le gène et le COV ? Une recherche publique ne doit-elle pas être financée par le public ? Et si les utilisateurs de résultats de recherche sont appelés à participer à son financement, doivent-ils rémunérer des personnes privées ou une gouvernance sociétale de la recherche ? Les brevets sur les particules élémentaires et leur exploitation industrielle sont-ils plus acceptables que le brevet sur le vivant ? Le droit à une recherche sur le vivant et des sélections participatives libérées de tout DPI ne devient-il pas aujourd’hui central ?
Semons la biodiversité
Si les États trahissent leur mission de service public en autorisant la confiscation et la destruction de la biodiversité, il devient urgent de vider les banques de semences pour reconstruire dans tous les champs du monde des collections vivantes et des maisons populaires de la semence sous la responsabilité directe de la société civile.
Il ne s’agit pas de revenir à l’agriculture de nos grands-parents, même si leurs semences sont la meilleure base des sélections paysannes modernes. Les acquis d’un siècle d’amélioration des plantes peuvent aussi être valorisés, pour autant qu’ils ne soient pas dépendants des engrais et pesticides chimiques, des énergies fossiles ou de biotechnologies dangereuses pour l’environnement, la santé ou la vie sociale. Un tel tournant ne peut venir que d’un régime juridique excluant tout droit de propriété intellectuelle sur le vivant et sur les connaissances, et reconnaissant le droit à la souveraineté alimentaire et les droits d’usage collectifs des paysans et des communautés sur leurs semences comme autant de restrictions légitimes à la sacro-sainte « liberté du commerce ». Ces droits collectifs sont la pierre angulaire de la survie d’un bien commun comme la biodiversité contre les droits de propriété intellectuelle et la liberté du commerce qui la remplacent par des clones synthétiques issus du monde virtuel.
Personne ne nous donnera ces droits, la société civile organisée peut et doit les prendre : pour que la disparition programmée de la biodiversité échoue, il faut d’abord la semer. Quitte à désobéir !
***********************************************************************************

Guy Kastler est militant écologiste et syndicaliste paysan qui a construit ses premières armes lors de la révolution culturelle de 1968. Ouvrier agricole, vigneron, puis berger fromager dans l’Hérault, Guy Kastler est chargé de mission à l’association d’agriculture biologique Nature & Progrès, délégué général du Réseau Semences Paysannes, Faucheur Volontaire d’OGM et représentant de la région Europe pour la campagne Semences de La Via Campesina International.
***********************************************************************************
[1] Le croisement de deux lignées autofécondées différentes donne une première récolte normale mais, n’étant pas stabilisée, elle dégénère si on la réutilise comme semence.
[2] Une plante autogamme s’auto féconde : ses principaux caractères sont conservés lorsqu’on ressème la récolte. Avec les variétés anciennes qui ont gardé une certaine diversité génétique, le maintien de leurs caractères s’obtient par une sélection conservatrice rigoureuse à chaque génération. Avec les variétés modernes au « pool génétique » de plus en plus étroit, le retour au croisement initial est nécessaire.
[3] Adopté dès 1930 pour les plantes à multiplication végétatives (fruits, fleurs.) et seulement en 2001 pour les légumes et les céréales.
[4] En terme de propriété intellectuelle, on distingue l’invention, qui découle de l’ingéniosité des hommes, des découvertes, qui consistent à repérer des éléments existant préalablement dans la nature. Seules les inventions peuvent être brevetées, les découvertes scientifiques appartenant en principe aux communs de la science, même si les tendances récentes remettent en cause cette distinction.
[5] L’Union pour la Protection des Obtentions Végétales réunit les États qui reconnaissent la validité juridique des COV.
[6] Le brevet européen ne s’applique qu’à la fonction décrite d’un gène, et non à toutes ses utilisations.
[7] Un projet de loi sur les obtentions végétales, voté par le sénat français en février 2006 prévoyait d’étendre à l’ensemble des espèces cultivées cette CVO aujourd’hui prélevée sur le seul blé tendre. Par peur du débat parlementaire, les semenciers ont tenté, en vain, de profiter du vote des lois « Grenelle » pour permettre sa promulgation par décret. Et une loi du 29 octobre 2007 autorise les obtenteurs à pénétrer dans les champs des paysans soupçonnés de contrefaçon ou à vérifier leurs comptes.
[8] Le marquage moléculaire du transgène est utilisé par les propriétaires de brevets sur les OGM. Les obtenteurs y ont de plus en plus recours. En France, un projet de loi voté par le Sénat en 2006 et les dernières propositions européennes de réforme des règlements semences veulent légaliser l’identification des variétés par « les caractères issus du génotype » ou le marquage moléculaire.
[9] Les mutations provoquées par rayonnement nucléaire, produits chimiques ou voyages dans l’espace, fusions cellulaires, stérilité mâle cytoplasmique, polyploïdie artificielle, nanotechnologies… sont exclus du champ d’application de la directive européenne 2001/18 sur les OGM. Le protocole de Carthagène n’exclut pas les fusions cellulaires.
[10] Agence de l’ONU chargé de l’alimentation. Résolution 8/83 signée par 113 pays.
[11] En octobre 2010, la réunion de la Convention sur la Diversité Biologique de Nagoya a refusé une nouvelle fois de contraindre les détenteurs de brevets à rendre publique l’information sur les ressources qu’ils ont utilisées.
[12] Lorsque tous les gènes d’un groupe d’échantillons sont présents dans quelques-uns d’entre eux, on ne garde que ces derniers et on jette les autres.
[13] On remplace les graines par l’enregistrement virtuel de leur séquence génétique.
[14] Régions du monde où poussent naturellement les parents sauvages des plantes domestiquées, comme le Mexique pour le maïs, le « croissant fertile » pour le blé, l’Inde pour l’aubergine…
[15] Voir dans ce livre l’article de Adelita San Vicente Tello et Areli Carreón Mainmise sur les semences de maïs dans son berceau d’origine et de diversité biologique.
[16] Voir www.semencespaysannes.org, communiqué de presse du 25 février 2008, « l’Arche de Noé Végétale, qui aura la clef de la porte ? »
[17] Seule la France a tenté de réglementer le marché pour amateurs avec un registre annexe au catalogue sur lequel peuvent être inscrites les variétés destinées exclusivement à ce marché.
[18] Traité International sur les Ressources Phytogénétiques pour l’Alimentation et l’Agriculture.
©© Vecam, article sous licence creative common
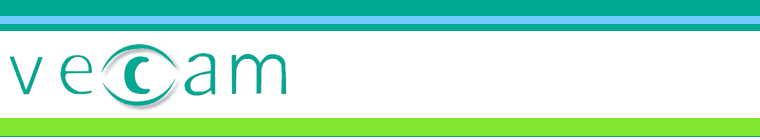

 Réflexion et propositions
Réflexion et propositions Libres savoirs, les biens communs de la connaissance
Libres savoirs, les biens communs de la connaissance Imprimer la page
Imprimer la page