Biens communs, sphère publique et « gauche de transformation sociale »
La remise en cause de la propriété privée des principaux moyens de production et d’échange a toujours été au cœur de la doctrine des différents courants de la gauche de transformation sociale. La forme que devrait prendre la propriété collective à opposer à la propriété privée a en revanche beaucoup varié avec le temps et l’une d’entre elles – les « biens communs » - connait aujourd’hui un regain d’intérêt dans les mouvements sociaux comme dans les milieux académiques. A un moment de crise et de recomposition pour les courants de la gauche de transformation sociale il nous parait utile de prendre ces discussions au sérieux.
Déclin et renouveau des « biens communs »
Au XIXème siècle, lors de l’émergence des théories socialistes et communistes, l’aspiration la plus répandue était celle de coopératives ou associations ouvrières de production qui devaient permettre de s’émanciper du salariat. Ces associations étaient fondées sur un capital commun, inaliénable et indissoluble, qui tirait des « communs » paysans, issus du monde féodal, le principe d’une séparation entre une propriété collective et inaliénable et une capacité d’usage qui permettait à la personne de participer à la production matérielle. Des mutuelles et société de secours et d’assistance gérées par les travailleurs complétait le rôle des coopératives et assuraient les tâches de solidarité face à la maladie ou la vieillesse. A la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle une autre vision va s’imposer, la propriété collective devenant une propriété publique où l’Etat (au sens large du terme, de l’état central aux collectivités locales) va jouer un rôle central. Deux éléments majeurs permettent de comprendre cette évolution :
- La fin du XIXème siècle va voir émerger un monde tout à fait nouveau grâce aux apports de la deuxième révolution industrielle, l’émergence de la « grande entreprise » sous le modèle allemand, le développement des réseaux techniques - les chemins de fer puis l’électricité et le téléphone – alors que s’achève la première période de mondialisation et que s’affirment les grandes puissances qui vont se partager le monde ; dans ce contexte la social-démocratie puis le mouvement communiste vont développer une vision du socialisme qui devait poursuivre la tâche de développement de ces réseaux techniques et de la grande industrie en s’appuyant sur un Etat planificateur,
- A la même époque, les aspirations populaires et les besoins de l’industrie moderne convergent pour développer un service public d’éducation gratuit et obligatoire ainsi que - d’abord en Allemagne – des systèmes de protection sociale couvrant les risques de maladie, d’accident du travail ainsi que les retraites ; émerge donc l’idée de droits universels qui ne se limitent pas aux droits démocratiques tels qu’énoncés la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de la Révolution française mais incluent les « droits positifs », les droits sociaux et économiques (droit à l’éducation, au logement, etc.) qui seront reconnus par la Déclaration universelle des Droits de l’Homme des Nations-Unies, en 1948.
Dans ce contexte, les « communs » du XIXème siècle - les héritiers de la société féodale ou les sociétés coopératives ouvrières de production – ont été les victimes d’une double tare : ils ne correspondaient pas aux critères de progrès et d’efficacité que seuls devaient permettre la planification étatique et la grande entreprise et ils ne permettaient pas de penser des droits sociaux à portée universelle.
Il faudra presque un siècle pour que la question des biens communs revienne au centre des discussions des mouvements sociaux – à travers le mouvement altermondialisme – et des sphères académiques tout du moins. Plusieurs raisons sont à la base de ce retour en grâce, le bilan négatif des expériences d’économies administrées et plus généralement la crise de l’idée de progrès telle qu’elle pouvait être pensée au début du XXème siècle, le rejet des privatisations qui se sont multipliées dès les années 1980 et enfin l’émergence de nouvelles catégories de « bien communs », les biens communs de la connaissance et les biens naturels tels que les océans, l’atmosphère ou le climat qui sont menacés aujourd’hui par les activités humaines.
Ces nouvelles catégories de biens communs ont ceci de particulier qu’ils vont de pair avec la définition de nouveaux droits universels : un « droit d’accès à la connaissance » pour les bien communs qui relèvent de ce registre et pour ce qui est des biens communs naturels d’une troisième, voire d’une quatrième, génération de « droits fondamentaux ». Après les droits civils et politiques et les droits économiques et sociaux, commencent à être définis des droits généraux comme "le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé" qui a été intégré à la Constitution de la République française en 2005, voire, de façon plus large encore, les « droits des non-humains », dont la planète-terre, que défendent aujourd’hui auprès de l’ONU la Bolivie et l’Equateur.
Ce lien aux droits fondamentaux va donner un nouvel essor à la notion de « biens communs » comme un moyen de penser une propriété collective en sortant de l’opposition binaire loi du marché – sphère publique comprise comme sphère institutionnelle gérée par l’Etat au sens large.
« Prendre soin » des biens communs
Il serait tentant de commencer par une définition plus précise de la notion de « biens communs ». Mais dès que l’on tente la moindre typologie des biens communs les différences et les lignes de tension sont si nombreuses qu’elles rendent vaine cette tentative. Les communautés d’appartenance sont à des échelles qui rendent les comparaisons impossibles : un village ou un groupe humain très restreint pour la répartition de l’eau dans les oasis, l’accès aux pâturages collectifs dans les zones de montagne ou aux affouages (coupes de bois communaux) dans la France du Nord-est, l’humanité pour les logiciels libres ou d’un ensemble plus vaste dont les être humains ne sont qu’une composante comme le climat ou la planète-terre… La finalité de la production et le rapport au marché sont un autre axe différenciant entre ce qui n’est produit que pour la consommation domestique ou celle du tout petit groupe humain – affouages ou produits des forêts primaires pour les populations de chasseurs-cueilleurs - et ce qui est susceptible d’être commercialisé sur un marché qui peut être mondial comme la production de coopératives ouvrières ou paysannes. Le caractère public ou discret – voire secret – des productions ou des savoir-faire les permettant va séparer ceux qui, comme les développeurs de logiciels libres, exigent la lisibilité totale du code et une documentation qui permette de le comprendre et de le modifier et ceux qui, comme les défenseurs des semences paysannes, ne veulent partager qu’avec ceux « en qui ils ont confiance »… et ce ne sont là que quelques exemples illustrant la diversité et l’ampleur des différences au sein de ce que l’on appelle les « communs ».
Il existe cependant un principe qui unit tous les biens communs qui est le fait qu’il est nécessaire d’en « prendre soin ».
Pour développer cette idée un petit détour par les débats sur les biens communs peut être utile. La « tragédie des communs » est peut être l’article le plus lu et le plus discuté sur le sujet. Ecrit pour « Science » en décembre 1968 par Garrett Hardin, cet article théorisait la disparition inéluctable des biens communs de par la surexploitation qui en serait faite par des utilisateurs qui auraient intérêt à exploiter au plus vite la ressource commune avant de s’attaquer à ce qui leur appartient en propre. Deux solutions pourraient permettre d’éviter cette « tragédie » : privatiser les communs pour que chaque possesseur les exploite en prenant en compte leur entretien ou les nationaliser et confier leur gestion à la puissance publique. Il existe cependant une troisième issue, comme l’a montré Elinor Ostrom, première femme à recevoir le prix Nobel d’économie en 2009, en étudiant plusieurs exemples de gestion des biens communs : la gestion des ressources par les acteurs locaux à travers des normes sociales et des arrangements institutionnels.
Si l’on revient à nos exemples l’on peut voir que, par delà leurs différences, seule la gestion directe par les communautés intéressées et leur « entretien » par ces communautés permet la pérennité des biens communs. Si les petits paysans cessent de croiser et sélectionner leurs semences ou leurs variétés animales, celles-ci seront accaparées par les multinationales comme Monsanto ou les organismes paraétatiques comme l’INRA. Si les millions de contributeurs à wikipedia cessent d’écrire ou de mettre en forme les articles, la plus grande encyclopédie du monde disparaîtra ou sera reprise par un groupe privé ou une structure publique. Si les habitants d’un village ne veulent plus aller couper du bois dans les forêts communales, les communes vendront les parts de bois à des entreprises qui revendront le bois de chauffage. Etc. etc.
Nous pouvons ainsi dessiner une distinction entre les biens communs et la sphère publique. La sphère publique est celle de la délégation. Elle représente les activités non privatisées qui sont confiées à des institutions spécialisées, les services publics comme l’école ou les hôpitaux, les organismes de recherche, les institutions politiques (gouvernement, collectivités locales), etc. En dernière analyse la sphère publique regroupe tout ce qui relève de l’Etat au sens le plus large du terme. Les biens communs sont, eux, l’espace de l’implication directe des acteurs. Une implication de nature très différente entre des coopérateurs qui travaillent tous les jours dans leur entreprise, des villageois qui vont couper du bois quelques journées dans l’année et des lecteurs ou des contributeurs occasionnels de wikipedia... mais une implication quand même. Un dernier exemple venant du monde de la cartographie permet de montrer que nous ne sommes pas dans un choix binaire mais dans un choix ternaire. Google est une multinationale privée qui a acquis une position dominante dans le monde de la cartographie sur le web avec les « Google Maps » et « Google Street View » que tout le monde connait. Face à ce quasi-monopole privé il existe des organismes public issus le plus souvent de la cartographie militaire (nos fameuses cartes « d’état major »). En France il s’agit de l’IGN qui a perdu la bataille face à Google parce qu’il entendait – exigence de rentabilité demandée par l’Etat oblige – vendre ses cartes numériques alors que Google les laisse accessible gratuitement jusqu’à une certaine audience. Devant ce choix des « militants du Web » ont décidé de créer une alternative, « Open Street Map » une carte coopérative libre qui rencontre un succès grandissant et a eu ses titres de gloire comme le fait d’avoir été les seuls à pouvoir construire en quelque jours une carte de Port-au-Prince détruit par le tremblement de terre du 12 janvier 2010.
Retour sur la gauche de transformation sociale
Ce rapide tour d’horizon permet de voir qu’aujourd’hui coexistent deux types d’alternatives à la propriété privée, la sphère publique et les biens communs, mais ces deux alternatives ne sont pas défendues du tout de la même façon suivant les milieux militants. Dans les forums sociaux, le mouvement altermondialiste, les mobilisations environnementales, dans beaucoup de mouvements sociaux du sud, mais aussi dans les mobilisations contre les lois liberticides sur l’Internet, la défense et l’extension du domaine des biens communs est une priorité. A l’inverse le discours militant des partis et courants politiques de la gauche de transformation sociale va se polariser sur la sphère publique (défense des services publics, nationalisation des banques, etc.). Une explication facile serait de se limiter à constater que cette césure tient au lieu d’où l’on s’exprime : des mobilisations le plus souvent internationales d’un côté, des combats électoraux nationaux ou locaux ou l’on s’adresse à des institutions politique de l’autre… La carence du côté des courants politiques nous parait plus profonde et mérite qu’on essaie de la corriger.
Une précaution tout d’abord. Ce court texte vise à mettre le doigt sur ce qui nous paraît être une carence et il est donc avant tout un plaidoyer pour la défense des biens communs. Il ne s’agit cependant en aucun cas de considérer que ceux-ci remplaceraient la sphère publique : si l’on considère que la caractéristique commune aux biens communs est l’implication directe des acteurs on voit bien que dans un monde ou l’avancée des sciences et technologies est chaque jour plus rapide les besoins de spécialisation ne cessent de croitre et qu’il faut donc accepter de « déléguer » à ceux qui maîtrisent ces compétences (médecins, ingénieurs, pilotes, etc.). Mais l’aspiration à la participation et au contrôle des institutions s’exprime dans les deux sphères, celle, bien sur, des biens communs mais aussi dans la sphère publique ce que l’on peut constater tous les jours pour l’école, la santé ou la contestation citoyenne des projets d’équipement des administrations publiques.
L’intérêt premier de la défense et l’extension du domaine des biens communs est que ceux-ci sont – au regard de l’expérience historique – un des cadres les plus favorables à l’exercice d’une réelle propriété sociale et d’une démocratie directe qui ne se réduise pas au court moment de la lutte ou de l’expérience révolutionnaire. La délégation de pouvoir à des institutions politiques peut être corrigée par la démocratie participative, par l’introduction de mécanisme de révocation des élus ou par une extension des droits référendaires, mais l’expérience montre les difficultés à mettre en place et plus encore faire durer des innovations politiques comme la démocratie participative telle qu’elle a été inventée à Porto Alegre. Parce qu’il faut en prendre soin et s’y impliquer, les biens communs sont le moyen d’exercer un socialisme de la pratique (le terme socialisme est ici utilisé de façon générique, il pourrait être remplacé par communisme, écologie politique, écosocialisme…) et pas seulement de la transformation des structures de pouvoir. En cela ils permettent de renouer avec toute une tradition du socialisme du XIXème siècle, de Owen à Fourier, qui placent les pratiques sociales (dans l’éducation, les entreprises coopératives, les rapports hommes / femmes, la vie communautaire) au cœur du processus d’émancipation ainsi qu’avec les aspirations comparables qui ont émergé des mouvements contestataires des années 1960/1970.
Les biens communs de la connaissance et les biens communs de la planète permettent, comme nous l’avons vu, de penser de nouveaux droits fondamentaux et, dans certains cas, de permettre leur exercice sans passer par la sphère publique. L’Internet en est un exemple intéressant. Les premières tentatives d’offrir grâce aux technologies numériques des bases de connaissance et de nouveaux moyens de communication à un large public – un accès à vocation universelle – ont été réalisées par des services publics, le Minitel en France, ou par des entreprises privées, comme AOL dans les années 1990. Comme nous le savons tous, l’Internet a dépassé ces premières expériences et s’est imposé dans le monde entier au point que beaucoup d’acteurs défendent l’idée que le droit d’accès à l’Internet soit considéré comme un droit fondamental. Dès les années 1980, l’Internet se développe grâce à une communauté d’ingénieurs et d’universitaires qui vont construire le réseau avec des logiciels libres, sur une base de gratuité et d’ouverture, et vont se doter d’un mode de gestion original, international et ouvert à tous. Des caractéristiques qui permettent définir l’Internet comme un bien commun pour l’humanité, un bien commun qui n’est pas - pour l’essentiel - géré par les Etats mais par une communauté technicienne qui s’autogère ce qui va générer conflits et débats. Ceux-ci s’expriment de deux manières : la volonté de contrôler, de « civiliser » l’Internet en multipliant les dispositifs de type Hadopi instaurés au nom de la défense de la propriété intellectuelle ou de la lutte contre le terrorisme et la pédophilie et la proposition de remettre le système interétatique au cœur de la gestion d’Internet. S’il ne faut développer aucun angélisme (la gestion actuelle de l’Internet permet aux Etats-Unis, pour des raisons juridiques et surtout culturelles, d’y jouer un rôle déterminant) ces enjeux sont au centre de mobilisations qui se développent dans différentes régions du monde contre l’ACTA (l’accord international contre la contrefaçon) et ils expliquent l’émergence de nouveaux courants politique comme les partis pirates ou de nouveaux mouvements sociaux comme « Students for a Free Culture » qui ont eu un impact important aux Etats-Unis entre 2007 et 2010.
Ces deux entrées, la démocratie et l’appropriation collective par les pratiques sociales et l’émergence et la défense de droits fondamentaux non gérés par la sphère politique devraient - de notre point de vue - être un des axes centraux d’intervention d’une gauche de transformation sociale parce qu’ils permettent d’être en phase avec des aspirations et des mobilisations qui émergent dans nos sociétés et surtout parce qu’ils sont des pas en avant vers une socialisme qui ne se confonde pas avec le renforcement de structures étatiques. Cette intervention pourrait se faire de deux manières : pour des lois et des règlements qui ne restreignent pas les libertés mais au contraire favorisent le développement des communs, qu’ils soient « anciens » (coopératives de production, coopératives d’achat, prés collectifs, affouages, etc.) ou plus récents (connaissance, nature) mais aussi par tout ce qui peut permettre l’implication de tous dans ces formes de propriété collective ce qui va de pair avec la diffusion de systèmes de valeur basées sur le partage et l’attention à l’autre. Les conditions de cette implication demanderaient un développement spécifique pour analyser les différentes formes d’incitation qui s’accompagnent toujours de systèmes de valeur (incitation à maintenir et améliorer la production pour les communs agricoles et les coopératives de production, logique de don / contre-don pour les communautés du logiciel libre, généralisation de pratiques individuelles et sociales appuyées sur des valeurs communes pour l’attention portée aux biens communs naturels, etc.).
Des débats à poursuivre
La défense des biens communs est au cœur de ce court texte, mais cette défense est aussi une incitation à ouvrir des débats sur toute une série de questions connexes qui méritent d’être discutées plus profondément.
La première d’entre elles est d’ordre terminologique, mais elle permet de souligner des problèmes stratégiques. Ce texte insiste sur la distinction sphère publique et biens communs et fait évoluer la distinction binaire propriété collective – propriété privée vers une distinction ternaire privé – public – commun. Mais la réalité est évidemment plus complexe et les hybridations et chevauchements entre privé, public et communs sont la règle plus que l’exception. Dans ce contexte, coexistent différentes définitions. Certains, comme François Houtard dans son dernier ouvrage « From ‘Commun Goods’ to the ‘Common Good of Humanity‘ », incluent les services publics dans les biens communs. D’autres, comme Roger Martelli, font l’inverse en cherchant à définir une sphère publique qui ne se confonde pas avec l’Etat. Tous cherchent en fait à élargir la sphère des activités auto-organisées en « faisant communs », « commoning » en anglais… Mais derrière ce point d’accord, se dessinent des problèmes stratégiques différents : comment répondre à une crise multidimensionnelle (finances, alimentation, climat…) grâce à la défense de biens communs pour toute l’humanité pour François Houtard et comment constituer un espace public qui se distingue à la fois du marché et de l’Etat pour Roger Martelli avec la double préoccupation de ne pas en rester à une diversité d’acteurs investis dans les communs en contournant la question du pouvoir et de penser une transition du public/étatique vers un public/collectif.
La deuxième question qui mériterait d’amples développements est celle des modes de gestion des communs. Dans ce texte nous avons tenté de montrer que « prendre soin » des communs voulait dire s’y impliquer et donc de pouvoir être associé d’une manière ou une autre à sa gestion. S’il y a autant de façon de le faire qu’il y a de type de commun, la gestion des grands communs issus de l’Internet, l’Internet lui-même ou Wikipedia, sont intéressants car ils ont des traits similaires aux modes de fonctionnement des mouvements militants les plus récents, les « Indignés » ou « Occupy » et qui sont basés sur trois principes : y participent qui veut, les décisions sont basées sur le consensus et elles sont renvoyées à la périphérie, au plus local possible. Des modes de fonctionnement qui posent de multiples problèmes, en particulier leur opacité et leur caractère procédural qui tend à évacuer les débats politiques. Mais cela oblige à revisiter une question centrale de notre monde contemporain, quels sont les éléments constitutifs de la « vraie démocratie » que les Indignés, et derrière eux une masse toujours croissante de nos concitoyens, appellent de leur vœux ?
De nombreuses autres questions méritent d’être discutées au delà de ces deux premières. Citons dans le désordre la question de la gratuité – que permet en particulier les communs de la connaissance - et de ce qu’elle implique comme projet de société (rien de moins que de permettre une contribution de chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins !) ; celle des acteurs impliqués dans le développement des communs et donc du ou des sujets de la transformation sociale ; celle des savoir-faire – qui disparaissent dès qu’ils ne sont plus pratiqués – et de la façon dont ils pourraient ou devraient faire communs ; celle des rapports humains – non humains que les communs de la planète nous amène à repenser...
©© Vecam, article sous licence creative common
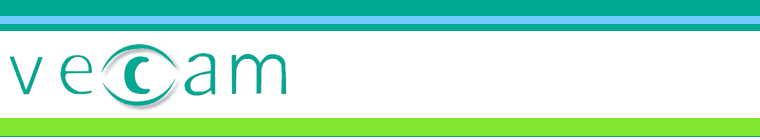

 Réflexion et propositions
Réflexion et propositions Contributions à débattre
Contributions à débattre Imprimer la page
Imprimer la page