Existe-t-il des alternatives aux logiques de l’industrie pharmaceutique ?
Philippe Pignarre est directeur des éditions Les Empêcheurs de penser en rond. Auteur de Le Grand secret de l’industrie pharmaceutique, La Découverte, Paris, 2003.
Les brevets qui donnent un monopole d’exploitation aux industriels inventeurs d’un médicament pendant 20 ans (monopole maintenant étendu à 25 ans dans de nombreux pays) sont désormais l’objet d’importantes controverses. Le droit des brevets doit-il uniformément s’appliquer dans tous les pays et à tous les médicaments comme le préconisent les accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) signés à Marrakech en 1994 ? Beaucoup de pays n’étaient pas d’accord. Ainsi l’Inde ne reconnaissait pas les brevets sur les médicaments : cela a permis à ce pays pauvre de développer une importante industrie pharmaceutique capable de mettre sur le marché à des prix très bas, pour sa propre population mais aussi pour d’autres pays pauvres, toutes les nouvelles molécules, sans devoir passer sous les fourches caudines des grands laboratoires pharmaceutiques américains, européens ou japonais. Depuis janvier 2005, l’Inde doit malheureusement appliquer la législation internationale en tant que membre de l’OMC et cela concerne rétroactivement tous les médicaments brevetés à partir de 1994. Des luttes importantes ont commencé en Inde autour de cette nouvelle législation.
En fait, l’histoire nous apprend que les européens ont euxmêmes mis beaucoup de temps avant d’accepter que la législation sur les brevets s’applique aux médicaments. Il a fallu attendre 1967 en France et encore plus tard dans d’autres pays comme la Suisse. Ces pays ont attendu de disposer d’une industrie pharmaceutique significative, capable de participer aux processus d’innovation, avant d’accepter que cette législation s’applique chez eux. Dans l’intervalle les petits laboratoires français ont beaucoup copié les molécules inventées dans d’autres pays, ce qui leur a permis de s’initier aux méthodes de mise au point des médicaments. Ce que les pays riches se sont accordés à eux-mêmes, ils ne sont pas prêts à l’accorder aux autres !
La question du sida a mis ce problème crucial sur la place publique. Comment les populations des pays les plus pauvres pourraient-elles disposer des trithérapies si les laboratoires inventeurs gardent le monopole de leur commercialisation et la liberté d’en fixer le prix ? Les plus gros laboratoires pharmaceutiques ont même intenté en 1999 un procès au gouvernement d’Afrique du Sud qui envisageait de commercialiser des génériques de médicaments encore protégés par un brevet. Devant le scandale international et la réaction des ONG, les laboratoires ont dû retirer leur plainte, mais ils se sont tournés plus discrètement vers les instances de régulation internationale et le gouvernement des États-Unis pour que leurs brevets ne soient pas mis en cause.
Le résultat de cette politique est un désastre sanitaire : seulement 5 % des personnes qui dans le monde auraient besoin des trithérapies y ont accès. En revanche les pays, comme le Brésil, qui ont décidé de passer outre le droit des brevets et ont su résister aux menaces du gouvernement des États-Unis, ont pu fabriquer eux-mêmes les trithérapies à des prix extrêmement bas et prendre en charge un nombre de plus en plus considérable de patients. Dans ce pays, la décision de fabriquer des génériques des trithérapies dans le sida a permis de ramener le coût du traitement annuel de 12000 à 300 euros en moyenne par patient.
Devant les protestations internationales et le combat de nombreuses ONG, des possibilités d’échapper à la stricte application du droit des brevets sont désormais reconnues en cas d’urgence sanitaire : un accord a été signé le 31 août 2003 qui permet la création de « licences obligatoires » gratuites pour les pays les plus pauvres. Il faut d’abord que les pays riches transposent cette possibilité dans leurs lois. Quant aux pays pauvres qui voudront suivre cette voie, ils devront lever de multiples obstacles et s’engager dans des demandes d’autorisation extrêmement complexes destinées à retarder et limiter le plus possible la possibilité de commercialiser des génériques. Ce sera particulièrement le cas pour les pays les plus pauvres qui n’ont pas les moyens technologiques de fabriquer localement ces médicaments et sont condamnés à les importer. Et de surcroit devront-ils régler la question de savoir d’où les importer puisque depuis janvier 2005 les pays comme l’Inde doivent aussi appliquer la législation sur les brevets de médicaments ? Ces pays devront aussi avoir les moyens de s’affronter aux États-Unis qui incorporent dans chacun de leurs accords commerciaux bilatéraux une clause complémentaire qui interdit le recours à cette possibilité de déroger au droit des brevets. Cette législation dite de la licence obligatoire est extrêmement contraignante : la demande doit être soumise à l’OMC, elle peut être contestée par un autre État, elle doit préciser la quantité de médicaments importés, le pays demandeur doit prouver que son système administratif et douanier empêchera toute ré-exportation, les circonstances doivent être « exceptionnelles », etc.
L’industrie pharmaceutique a un autre problème : la plupart des molécules avec lesquelles elle gagne le plus d’argent (les nouveaux antidépresseurs antisérotoninergiques, les antimigraineux de la famille des triptan, les hypolipidémiants de la famille des statines, les nouveaux hypnotiques, etc.) tombent tous dans le domaine public avant 2007 alors qu’elle n’a rien inventé qui puisse venir avantageusement les remplacer. Ces molécules ne seront plus protégées par brevet et pourront faire l’objet de copies identiques ou quasi-identiques (génériques). Face à cette perspective de voir ses immenses profits mis en cause, l’industrie pharmaceutique multiplie les manoeuvres, les recours juridiques et les pressions pour obtenir un allongement de la durée de protection.
Les gros laboratoires pharmaceutiques fabriquent et commercialisent parfois eux-mêmes leurs propres génériques pour intimider et décourager les laboratoires spécialisés dans les génériques, tout en espérant ne pas avoir à les promouvoir auprès des pharmaciens. Les brevets ont un autre effet pervers : ils poussent les laboratoires pharmaceutiques à limiter au maximum la durée et le nombre d’études cliniques afin de demander le plus vite possible une autorisation de mise sur le marché et profiter ainsi au mieux du temps durant lequel ils auront le monopole de l’exploitation (avant l’arrivée des génériques). Du coup, ce n’est qu’une fois un médicament sur le marché que l’on s’aperçoit d’effets secondaires pouvant être mortels et que le caractère trop limité des études cliniques n’ont pas permis de déceler avant la commercialisation. C’est ce qui s’est passé avec le Vioxx des laboratoires Merck qui provoque des accidents cérébraux ou cardiaques chez 15 patients sur 1 000 et qui a dû être retiré du marché 4 ans après sa commercialisation.
Mais la question des brevets met en jeu une autre question : celle de l’organisation même de la recherche. Les États-Unis ont expérimenté ce que l’on peut appeler une « remontée » des brevets en amont, au sein de la recherche académique (Sheldon Krimsky, La recherche face aux intérêts privés, Les Empêcheurs de penser en rond). On pouvait autrefois distinguer la recherche publique et la recherche privée, non seulement en fonction de leurs modes de financement, mais aussi en fonction de leurs objectifs. Les chercheurs du public avaient pour vocation de publier leurs travaux dans de grandes revues scientifiques à comité de lecture (les plus célèbres sont Science et Nature) ou à communiquer leurs résultats lors de congrès de leurs disciplines : leur but était de répandre la connaissance sans restrictions, et d’enseigner. À l’inverse les chercheurs du privé sont soumis aux intérêts financiers de leurs employeurs : on exige d’eux le secret et on leur interdit fréquemment de publier leurs résultats. Leur seul objectif est de déposer des brevets avec tous les droits que cela induit. Les brevets étaient jusqu’à présent déposés sur des produits manufacturables.
Tout cela est en train de changer. Les législateurs des États- Unis ont voté en 1980 une loi (qui porte le nom de ses initiateurs Bay-Dole) autorisant les universitaires à déposer des brevets, à créer des sociétés de biotechnologie, et à devenir actionnaires de groupes pharmaceutiques. Parallèlement, la Cour suprême de ce pays a décidé que les bactéries génétiquement modifiées étaient brevetables en tant que telles, indépendamment de leur intégration dans un processus d’exploitation. Désormais les lignées cellulaires, les gènes, les animaux et tous les organismes vivants modifiés par les humains peuvent être brevetés. Si on compare la recherche à une autoroute, on peut dire que les péages-brevets ne se situent pas seulement aux sorties des bretelles, mais qu’ils s’accumulent tout le long du chemin. Comme on le voit, la question des brevets est en train de devenir une des questions politiques les plus importantes : c’est elle qui cristallise désormais tous les abus possibles liés à la propriété privée.
Cela doit nous amener à réfléchir à d’autres moyens pour inventer et développer des médicaments qui soient indépendants de l’industrie pharmaceutique et de sa logique des brevets.
De ce point de vue, l’Afm (Association française contre les Myopathies), surtout connue par le Téléthon qu’elle organise chaque année, représente une expérience passionnante. Le premier message de l’Afm pourrait être résumé ainsi : on ne peut pas compter sur l’industrie pharmaceutique, ni sur l’État, pour mettre au point les thérapeutiques dont nous avons besoin. C’est pourquoi il n’est pas correct de leur dire : « c’est à l’État de le faire ». L’Afm sait bien que l’État ne le fait pas ! C’est justement tout le sens de ses initiatives !
L’Afm est entrée dans des lieux jusque-là interdits : les laboratoires de recherche. Les chercheurs ont souvent détesté cela. La plupart d’entre eux préfèrent négocier avec les pouvoirs publics, ou avec les patrons, plutôt qu’avec le « public » quand il commence à apparaître sous la forme de ce type d’associations. Ils auraient voulu que l’argent n’aille pas à des projets mais à leurs laboratoires et ils auraient voulu gérer eux-mêmes cet argent sans que les associations s’en mêlent. C’est ce que l’Afm a justement toujours refusé. L’Afm est une des rares associations à ne pas avoir donné le pouvoir à son conseil scientifique. On peut désormais penser que l’on n’inventera rien de nouveau pour constituer les usagers en partenaires actifs sans apprendre de ce qu’a fait l’Afm. Cela concerne aussi bien les relations avec les chercheurs, la définition des appels d’offre, les modes de financement des travaux scientifiques, le type de contrôle sur les budgets alloués, la question des brevets sur les découvertes ainsi faites (pas de dépôts de brevets en général, mais nécessité de trouver les moyens qui permettent d’accélérer la recherche de traitements adéquats et d’être en bonne situation pour négocier avec des équipes du privé).
Ainsi, l’Afm a un conseil d’administration composé exclusivement de membres des familles de malades et un comité scientifique séparé qui ne joue qu’un rôle consultatif. C’est le conseil d’administration qui prend les décisions, alloue les budgets, décide des grands projets. Cela ne s’est pas fait tout seul car les scientifiques auraient souvent aimé avoir plus de pouvoir, comme dans de nombreuses autres associations. Comme l’écrivent Vololona Rabeharisoa et Michel Callon dans leur livre sur l’Afm, contrairement aux interprétations selon lesquelles l’Afm agit contre le milieu scientifique, l’association cherche à travailler de concert avec lui, mais en tant que véritable partenaire et non seulement comme tiers-payant. La relation que l’Afm cherche en permanence à établir avec les chercheurs est une relation à la fois d’équité et d’altérité. Si les scientifiques ne savent pas coopérer, ce n’est pas une raison pour se passer d’eux : il faut les convaincre de le faire. S’ils ont tendance à privilégier leurs propres intérêts, ce n’est pas une raison pour baisser les bras : il suffit de les inciter à réorienter leurs programmes. Il n’existe aucune fatalité » (Vololona Rabeharisoa, Michel Callon, Le Pouvoir des malades. L’Association française contre les myopathies et la recherche, Presses de l’École des Mines). Cela ne se fera pas sans mal : ce sont toutes les habitudes de pensée des scientifiques et des hommes politiques qui sont bouleversées par ce qui constitue une véritable expérimentation sociale : « Les critiques proviennent d’abord des responsables des organismes publics de recherche qui se plaignent de voir leur propre action déviée, si ce n’est contrecarrée par des financements extérieurs sur lesquels ils n’ont aucun contrôle, et dont ils ne sont pas sûrs qu’ils aillent aux meilleures équipes sur les thèmes les plus pertinents. » Certains membres du comité scientifique, dont le rôle n’est que consultatif, tenteront bien de se révolter : l’Afm ne cèdera pas.
L’État également aurait bien aimé se mêler de cette affaire et s’emparer des millions d’euros collectés (100 millions en 2004) grâce au Téléthon ! Les dirigeants de l’Afm ont heureusement toujours su résister à ce type de pressions, en particulier lorsque le ministère des handicapés prétendait nommer 50% des membres du conseil d’administration !
L’exemple des médicaments montre qu’il n’y a pas « un marché » qui dicte des lois inexorables et face auquel nous serions impuissants. Le marché des médicaments est adossé à l’État et ne peut fonctionner que par un impressionnant appareil de lois et règlements. Sans ces lois et règlements, il n’y a pas de marché mais le chaos. Il est donc tout à fait possible d’intervenir pour que soient modifiés ces lois et règlements afin de ne pas laisser les industriels faire payer aux consommateurs le coût du déclin de l’innovation. Cela commence par la nécessité de s’opposer à l’allongement du temps de protection que donnent les brevets, la nécessité de s’opposer à l’autorisation de la publicité pour les médicaments de prescription en direction du grand public. Cela continue avec la nécessité de décourager les industriels d’investir dans la mise au point de me-too inutiles en annonçant des prix à la baisse pour ce type de nouveaux médicaments (les me-too sont des variations autour de molécules dont on connaît les propriétés. Ils ne peuvent être utiles que dans les maladies infectieuses à cause des variations des agents infectieux).
Mais au-delà même de la nécessité d’intervenir sur les conditions de fonctionnement du marché des médicaments, nous devons privilégier tous les dispositifs qui permettent de faire proliférer les expertises, qui créent des publics intelligents et qui nous permettent de ne pas nous enfermer dans la seule logique des mesures administratives. C’est le chemin que nous ont montré, chacune à leur manière, les associations Act Up et Afm.
Ainsi, s’il faut réfléchir aux moyens de financer des projets de recherche alternatifs, le plus important sera à cette occasion, de fabriquer de nouveaux liens entre les chercheurs, les associations de patients et les ONG. Des liens dans lesquels chacun ait envie d’apprendre de l’expérience des autres. C’est évidemment renoncer à l’idée que l’État pourrait retrouver sa fonction de bon père protecteur. Nous ne pouvons compter que sur notre intelligence collective. Nous pouvons reprendre la formule de Gilles Deleuze et Félix Guattari : « nous avons besoin que les gens pensent ».
Philippe Pignarre
©© Vecam, article sous licence creative common
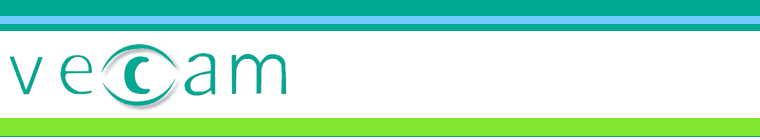

 Réflexion et propositions
Réflexion et propositions Pouvoir - Savoir (le livre)
Pouvoir - Savoir (le livre) Imprimer la page
Imprimer la page
