Le médicament comme bien commun, une réflexion en développement
Florent Latrive est journaliste au service Économie du quotidien Libération, coéditeur avec Olivier Blondeau du livre Libres enfants du savoir numérique, et auteur du livre "Du bon usage de la piraterie aux éditions Exils". http://www.freescape.eu.org/piraterie/
La fusion récente des laboratoires SanofiSynthélabo et Aventis a défrayé la chronique française. On a même vu un gouvernement pourtant libéral intriguer en coulisses et, au risque de provoquer les hurlements des « marchés », aider à la constitution de ce nouveau géant de la pharmacie mondiale, le nº3 du secteur derrière l’américain Pfizer et le britannique GlaxoSmithKline. Des ministres aux dirigeants du nouveau groupe, la satisfaction cocardière était de mise : réjouissezvous, Français, car non seulement l’entreprise est d’importance, avec ses 120 000 salariés, mais elle s’apprête à démontrer sa puissance avec la mise sur le marché dans les mois à venir d’une de ces « molécules porteuses d’espoir » que le patron de la firme, JeanFrançois Dehecq, affirme vouloir apporter à des « millions de patients » [1]. Un vaccin contre le sida ? Un traitement contre la maladie du sommeil ? Non, un médicament destiné à lutter contre l’obésité, baptisé Rimonabant.
Il n’est pas question d’éreinter par principe l’entreprise pour s’essayer à la mise au point d’un traitement qui pourrait aider des millions de gens. Mais le Rimonabant est bien le symbole d’une industrie pharmaceutique dont les efforts de recherche et développement sont quasi intégralement dévolus aux pathologies des pays du Nord. La liste est longue de ces molécules vedettes, aux chiffres d’affaires en milliards d’euros, et dont les ventes sont scrutées à la loupe par les analystes financiers : du Viagra contre l’impuissance aux statines contre le cholestérol, les labos du monde entier visent tous la même martingale, ces médicaments destinés à des maladies courantes (plus de patients), chroniques (le patient consomme plus longtemps ses pilules) et propres aux citoyens des pays développés (plus riches).
Dans le même temps, des maladies responsables de millions de morts dans le monde, et surtout dans les pays du Sud, comme par exemple le KalaAzar [2]. Les rares traitements disponibles comportent de lourds effets secondaires ou sont vendus à des sommes astronomiques. Voir la page consacrée au Kala Azar sur www.dndi.org, demeurent totalement ignorées, et attendent toujours la mise au point d’un traitement efficace et accessible. Et les médicaments efficaces et indispensables vendus par ces mêmes laboratoires ne parviennent pas à tous ceux qui en ont besoin. Les trithérapies, qui ont permis aux malades du sida du Nord de voir leur condamnation à mort commuée en perpétuité, ne sont toujours acheminés aux malades du Sud qu’en nombre très réduit, notamment pour des raisons de prix : en Afrique, plusieurs millions de malades attendent toujours un traitement et au Botswana, près d’un tiers de la population est contaminée. « Cette rétention des traitements apparaîtra aux historiens futurs aussi moyenâgeux que la saignée », déclarait ainsi l’exprésident américain Bill Clinton [3].
Esbroufe marketing d’un côté, prix trop élevés pour les pays pauvres de l’autre : le médicament, l’une des clefs de l’accès aux soins, est ainsi devenu une marchandise, un produit soumis aux aléas et aux injustices d’un marché du soin, où les patients sont autant de clients. Nul hasard ici, mais la simple résultante d’un mécanisme, celui des brevets qui garantissent à l’industrie pharmaceutique la propriété intellectuelle sur les traitements qu’elle commercialise. Cette « propriété » conférée aux labos est devenue la norme dominante et a transformé le médicament en marchandise. Si en 1954, l’inventeur du vaccin contre la polyomélite, Jonas Salk, refusait de breveter son invention car « on ne brevète pas le soleil », en 1998, trenteneuf parmi les plus grands labos du monde portaient plainte contre le gouvernement sudafricain, accusé de vouloir édicter une loi autorisant de passer outre leurs précieux brevets.
Le brevet assure un monopole sur l’invention protégée : son titulaire peut en fixer le prix, et décider à quelles conditions celleci est produite. Dans le cas des médicaments, c’est la molécule qui est protégée : impossible pour quiconque de la copier sans l’autorisation du labo détenteur du brevet. Les « Big Pharma » affirment que ce mécanisme leur est indispensable, car le coût du développement se situe en amont de la production, au moment de la mise au point, de la recherche des effets, des longues études cliniques pour comparer l’efficacité du nouveau traitement avec celle de placébos. Souvent peu chers à fabriquer, mais onéreux à concevoir avant même la mise en production de la première boîte, les médicaments sont limités dans leur reproduction par l’artifice de la propriété intellectuelle. Sans ce verrou juridique, toute entreprise pourrait proposer ses propres versions des traitements, à prix plancher, comme le prouvent les coûts réduits des « génériques », ces molécules identiques aux originales qui apparaissent après l’expiration du brevet, vingt ans après son obtention par le titulaire.
C’est bien cette dépendance au brevet et au marché qui oriente les investissements des laboratoires. À cette aune, les fléaux touchant les pays les plus pauvres, jugés peu lucratifs, n’apparaissent pas sur leur radar. Entre 1975 et 1999, sur 1400 nouveaux médicaments commercialisés, 13 seulement concernaient les maladies tropicales infectieuses [4]. De même, l’industrie pharmaceutique préfère concentrer ses efforts sur les molécules les plus prometteuses financièrement, quitte à délaisser les traitements les plus innovants. Quand les pilules destinées à faire baisser le taux de cholestérol représentent un marché de plusieurs milliards de dollars au niveau mondial, mieux vaut sortir sa propre version que de prendre le risque d’investir sur des molécules répondant à des besoins non encore satisfaits. C’est le syndrôme « me too » (« moi aussi »), dont le symptôme le plus flagrant est la multiplication des clones du Viagra dans les pharmacies. Entre 1982 et 1991, 53 % des médicaments approuvés par la Food and Drug Agency (FDA) aux États-Unis offraient « peu ou pas de gain thérapeutique » [5]. Et sur les 31 blockbusters lancés entre 1992 et 2001, 23 étaient des « metoo » ! Pour le professeur de neurologie Peter Landsbury, la question se pose : « Avons-nous réellement besoin de cinq versions indifférenciées du Viagra quand elles détournent des ressources qui pourraient être utilisées pour développer des médicaments innovants soignant des maladies mortelles ? »
Cette dérive ultramarchande n’a pourtant rien d’inéluctable. L’idée même d’accorder des brevets sur les médicaments est un phénomène relativement récent : qu’il s’agisse de la crainte d’introduire un mécanisme d’appropriation dans un domaine aussi sensible que la santé, ou pour des motifs économicoprotectionnistes, l’introduction de telles règles dans les droits nationaux ne s’est généralisée que ces dernières années. Et comme le montre la petite phrase de Jonas Salk, elle ne va pas de soi pour nombre de chercheurs.
Mais il faut aussi remarquer que le mécanisme de la propriété intellectuelle luimême n’était pas à l’origine destiné à conférer un pouvoir aussi exhorbitant : si le titulaire d’un brevet sur un traitement dispose bien d’un monopole et peut ainsi restreindre l’accès à son bien et le monnayer, ce droit de « propriété » est sévèrement limité par le droit. La propriété intellectuelle n’a ainsi rien de commun avec la propriété physique, celle sur une voiture ou une maison. Elle dessine un régime équilibré entre le contrôle accordé à l’inventeur et la plus grande circulation possible de son invention [6]. Elle trace une frontière entre la propriété et le bien commun afin d’assurer une balance entre les intérêts particuliers de l’inventeur et l’intérêt général, balance éminemment cruciale dans le domaine du médicament et de la santé.
Afin de réaliser cet équlilibre, le brevet a été borné et assorti de nombreuses limites. Limite dans le temps, tout d’abord : vingt ans après son attribution, il entre dans le domaine public et tout un chacun peut se saisir de l’invention pour la reproduire à loisir, et à moindre coût. Limite géographique, ensuite : l’Inde ne reconnaît les brevets sur les médicaments que depuis janvier 2005 et a laissé prospérer une industrie de la copie de molécules génériques pendant plusieurs dizaines d’années. Limite « éthique », enfin : la plupart des législations sur la propriété intellectuelle autorisent les États à édicter à tout instant une licence obligatoire sur un brevet ; autrement dit, à l’ignorer en cas d’urgence sanitaire. C’est ainsi que les États-Unis euxmêmes ont menacé la firme Bayer d’une licence obligatoire sur la ciprofloxacine pendant la crise de la maladie du charbon, afin de forcer le labo allemand à baisser ses prix.
Élément indispensable à un régime de santé publique mondiale juste, l’équilibre entre les dimensions de « propriété » et de « bien commun » du médicament a été rompu ces dernières années et une conception extrémiste de la propriété intellectuelle a fini par s’imposer dans les négociations internationales. Signé dans le cadre de l’OMC en 1994 notamment sous l’influence des multinationales pharmaceutiques, l’Accord sur les Aspects de droits de propriété intellectuelle liés au commerce (Adpic) a ainsi mondialisé les brevets sur les médicaments : à terme, tous les pays sont tenus de s’y plier, indépendamment de leurs besoins propres et de leur niveau de développement. Un nombre croissant d’accords bilatéraux ou régionaux de libreéchange ont encore durci ces contraintes : des obligations juridiques supplémentaires y allongent la durée du brevet audelà de 20 ans et les possiblités de recours à des licences obligatoires deviennent pour certains pays pauvres encore plus rigides que pour les nations développées.
Les dérives du système international des brevets dans le domaine des médicaments sont désormais porteuses d’inégalités NordSud toujours plus béantes. Elles sont responsables d’une orientation de la recherche et développement en décalage avec les besoins sanitaires, en particulier des pays pauvres. Et provoquent un dysfonctionnement criant dans l’accès aux soins, avec le renchérissement des prix des traitements. Comment réformer le financement de la R&D dans le domaine de la santé et amender la législation internationale sur la propriété intellectuelle pour parvenir à un régime juste et solidaire dans ce domaine ? C’est aujourd’hui l’enjeu d’une question à 45 milliards de dollars, soit le montant dépensé chaque année par l’industrie pharmaceutique en R&D. Et c’est l’objet des réflexions et propositions d’un nombre croissant de chercheurs, d’ONG et de citoyens, du Sud comme du Nord.
[1] Voir le site de Sanofi, www.sanofi.com
[2] Infection parasitaire responsable de millions de morts en Inde et en Afrique de l’Est. Les rares traitements disponibles comportent de lourds effets secondaires ou sont vendus à des sommes astronomiques. Voir la page consacrée au Kala Azar sur www.dndi.org
[3] William Clinton, « AIDS is not a Death Sentence », The New York Times, 1er décembre 2002
[4] JeanPaul Moatti, « Médicaments et pays en développement : en finir avec l’hypocrisie ! », La Recherche, février 2004
[5] Peter Landsbury, « An innovative drug industry ? Well, no. » The Washington Post, 16 novembre 2003
[6] Florent Latrive, Du bon usage de la piraterie, Exils, 2004. Voir le chapitre 1, « Qu’est ce qu’un pirate ? ». www.freescape.eu.org/ piraterie.
©© Vecam, article sous licence creative common
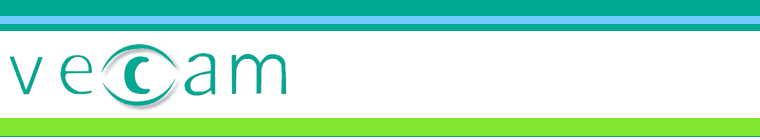

 Réflexion et propositions
Réflexion et propositions Pouvoir - Savoir (le livre)
Pouvoir - Savoir (le livre) Imprimer la page
Imprimer la page