Formation, logiciels libres et partenariat public-privé
Pascal Renaud est chercheur à l’IRD, Institut de recherche pour le développement, membre du conseil d’administration de Vecam.
La formation, l’enseignement, l’éducation, la recherche scientifique reposent sur un accès au savoir aussi large que possible. Il en va de même pour les technologies de l’information et de la communication. Les bases des sciences de l’ordinateur ont été établies dans un contexte ou les méthodes, (algorithmes, interfaces…) étaient librement diffusés1. Aujourd’hui comme hier, les ingénieurs en informatique sont formés avec les logiciels libres ou tout du moins à code ouvert.
On peut donc s’étonner de constater que les programmes internationaux destinés à lutter contre la fracture numérique, ne prennent que rarement en compte le rôle pédagogique des logiciels libres et qu’ils donnent peu de place à la formation technique. Il est à cet égard significatif que le Sommet mondial sur la Société de l’Information ait révélé l’incapacité de l’ONU à s’opposer à cette tendance. Le plan d’action de Genève nie le caractère spécifique des logiciels libres et finalement c’est l’enseignement des sciences et techniques de l’informatique qui est presque oublié. Cette attitude apparaît comme une des conséquences de la stratégie de partenariat public –privé avancée par un nombre croissant d’organisations internationales.
Le plan d’action de Genève
En 2003, dans le cadre de la préparation du Sommet mondial sur la Société de l’information2, l’UNITAR3, institut de formation appartenant au système des Nations Unies, a fait une proposition d’amendement au Plan d’action en débat, pour mettre en évidence la contribution indispensable des logiciels libres ou open source dans la formation aux sciences et techniques de l’informatique, rappelant que - celle-ci est indispensable à la réduction de la fracture numérique.
Cette relation établie entre logiciel libre et formation n’a pas résisté aux restructurations successives du texte. Et finalement, la notion même de logiciel libre a été totalement noyée dans une formule vide de sens4.
Cependant, en niant le rôle spécifique des logiciel libres et du code ouvert, le Plan d’action de Genève passe sous silence ce qui est à la base de la formation et de la production de connaissance en informatique. Il est peu probable que sans le libre et le domaine public du logiciel, nous aurions internet, le web et peut-être même Windows… On doit donc s’interroger sur les raisons qui conduisent les organisations internationales à vouloir réduire la fracture numérique sans s’intéresser sérieusement aux logiciels libres et à la formation des ingénieurs et techniciens.
Si on observe l’évolution historique de la coopération internationale en informatique, on constate que l’aide est tout d’abord orientée vers la formation5. La France par exemple, concentre son effort sur la formation d’ingénieurs avec la création dès 1970 à Libreville de l’Institut africain d’informatique6. Le but de cette école inter-États est alors de remplacer les expatriés des services informatiques par des cadres locaux et d’alimenter les universités africaines en enseignants de qualité. Un effort similaire est fait dans les pays anglophones.
Une rupture intervient au milieu des années 90. Internet, jusqu’alors confiné aux universités et à la recherche, devient un service grand public. L’équipe Clinton – Gore - est décidée à en faire un atout de la politique de reconquête des États-Unis. Dans la foulée de son projet d’infrastructure nationale d’information (NII – National Information Infrastructure), elle lance l’Initiative Leland7, pour « apporter les avantages et bénéfices de la révolution de l’information globale aux habitants du continent africain ».
Dans le même temps, la Banque mondiale choisit de se positionner au plus vite sur ce secteur de pointe. Il s’agit pour elle de valider sa nouvelle stratégie de soutien au secteur privé. Elle emboîte donc le pas à l’USAID et lance InfoDev8. C’est alors qu’apparaissent successivement dans sa littérature les concepts d’info-pauvres, puis de fossé ou de fracture numérique, et enfin d’opportunité numérique. ces termes sont destinés à justifier une action spécifique dans le domaine des technologies de l’information auprès des acteurs de la coopération internationale, jusqu’alors plus habitués à travailler sur l’alimentation, la santé et l’éducation.
Les réticences internes, tant à l’USAID qu’à la Banque mondiale, conduiront les responsables de ces institutions à confier ces programmes à des équipes nouvelles, fortement motivées par les TIC (Technologies de l’Information et de la Communication). Mais ces deux programmes ne vont pas seulement innover parce qu’ils engagent l’aide internationale sur un nouveau créneau, celui de l’informatique. C’est surtout parce qu’ils vont proposer un nouveau schéma institutionnel qui associe directement les grands industriels de l’informatique et des télécoms à la définition de la stratégie de coopération. Ce schéma stratégique est le partenariat public-privé.
Basé sur le modèle de Davos, où se côtoient à égalité des responsables de l’action publique, généralement élus, et les dirigeants d’entreprises, ce partenariat public-privé, doit mobiliser des ressources nouvelles pour compenser la baisse de l’aide publique au développement. Les nouveaux partenaires de la générosité se feront un peu tirer l’oreille, préférant intervenir directement à travers leurs propres fondations. Mais, même si les partenaires privés se sont révélés plus difficiles à convaincre que prévu. Bon gré, mal gré, ce nouveau partenariat s’impose aux agences internationales qui sont confrontées à la baisse de leurs ressources budgétaires.
Quelques années plus tard, lorsqu’en pleine bulle boursière, l’idée émerge d’un « Sommet mondial sur la Société de l’Information » (SMSI), ses promoteurs veulent organiser un Sommet de l’ONU basé sur le partenariat multiacteur. Ils se mettront d’accord sur trois composantes. Ils accepteront les ONG mais chercheront surtout à définir un Plan d’action ambitieux basé sur le partenariat public – privé.
L’éclatement de la bulle boursière réduira les ambitions de départ et les industriels se montreront bien discrets sur le plan des engagements financiers. Mais le SMSI produira un véritable monument du PPP, puisque son Plan d’action évoque dix fois le terme de « partenariat public – privé » sur dix-huit pages. Dans le même temps, malgré l’activisme de la société civile, le Plan de Genève videra de tout sens la référence aux logiciels libres.
Partenariat public – privé et formation
La particularité du PPP n’est évidemment pas que des entreprises privées soient bénéficiaires des actions de coopération. Elles l’ont toujours été. C’est qu’elles soient associées à la définition des programmes et de leurs objectifs. Lorsque la France des années 70 participe à la création de l’IAI, il est plus que probable qu’elle a immédiatement demandé à cet institut de s’équiper en matériel français. Mais, ce n’est pas pour autant qu’elle a conclu avec lui un partenariat stratégique. Elle n’a pas confié aux fournisseurs le soin de définir les programmes ou d’organiser les diplômes...
Une telle situation, où le partenaire privé, fournisseur de l’État ou d’un service public de formation, devient promoteur de la formation, évaluateur et finalement certificateur de diplômes, est en contradiction avec toute la tradition humaniste sur laquelle reposent nos principes d’éducation. C’est pourtant le schéma qui est observé dans les programmes de formation mené par les principaux bailleurs de fonds multilatéraux et se réclamant du partenariat public-privé. Deux exemples illustrent ce mécanisme. Le premier, « Initiative Internet pour l’Afrique », est un programme financé par le PNUD9 (ainsi que l’USAID10) qui consiste à implanter des « académies Cisco11 » dans 24 pays parmi les moins avancés. Le second, « Université virtuelle africaine » est financé par la Banque mondiale et présidé par un cadre dirigeant de Microsoft.
Avec 80% du marché mondial des boîtiers d’interconnexion pour les réseaux informatiques et télécoms, Cisco est, comme Microsoft, un des principaux leaders du marché - de l’informatique. Les académies Cisco proposent un enseignement standard à travers des relais locaux implantés dans 145 pays. Le « produit éducatif » inclut la formation, l’évaluation et les diplômes : Cisco Certified Network Associate (CCNA) et Cisco Certified Network Professional (CCNP).
Quant à l’Université virtuelle africaine (UVA12), son président, Jacques Bonjawo, « senior manager » au Siège mondial de Microsoft à Redmond13, nous explique que les universités africaines faisant face à de « graves difficultés financières », n’ont plus les moyens d’assumer correctement leur mission. Il en déduit que les étudiants doivent se tourner vers l’Université virtuelle africaine qui constitue « une chance pour l’Afrique14 ». Notons que cette chance bénéficie, outre la tutelle de Microsoft, de l’appui de grandes universités du Nord, du financement de la Banque mondiale, et vient de recevoir un don de 7,68 millions de dollars du Fonds africain de développement. De nombreuses universités publiques aimeraient bénéficier d’une telle chance en Afrique…
Entendons-nous bien. Il n’y a rien d’exceptionnel, ni de condamnable à ce que Cisco dispose d’un réseau de formation, c’est le cas de tous les grands industriels de l’informatique. Il est aussi tout à fait légitime que des universités se groupent pour proposer un service d’enseignement à distance. Là où il y a confusion des genres, c’est lorsque Cisco ou Microsoft sont chargés par des institutions intergouvernementales d’assurer des tâches d’éducation. Dans ce contexte, les universités du Sud n’ont guère d’autre choix que de devenir des filiales de distribution de produits de formation conçus au Nord.
L’autonomie du dispositif de formation vis-à-vis des industriels est une question stratégique, au Nord comme au Sud. Elle impose de refuser, non pas des dons de matériel ou même de logiciels, mais toute contrepartie éducative ou pédagogique à ceux-ci et donc tout partenariat stratégique. Ces principes n’échappent généralement pas aux autorités des pays concernés. Mais ont-ils le choix lorsque leur budget d’éducation est très dépendant de l’aide internationale ?
L’informatique libre est un des atouts clés pour une formation indépendante et donc pour la construction du potentiel technique nécessaire à la réduction de la fracture numérique. Les responsables en sont généralement conscients, mais outre le manque de cadres techniques, il y a la pression directe de ces nouveaux partenaires. Un haut responsable de l’informatique d’un gouvernement d’Afrique de l’Ouest, m’indiquait il y a quelques mois qu’il n’était pas question pour lui de prendre une position officielle en faveur des logiciels libres « j’aurais immédiatement un coup de téléphone du premier ministre »… Ce qui ne l’empêche pas d’agir plus discrètement. Ces « résistants » trouvent des appuis auprès de certaines agences de coopération ou de certains services au sein de ces agences. En Afrique francophone, il faut citer l’INTIF15 et le Projet ADEN16. Dans la zone Asie Pacifique, l’APDIP17, programme régional du PNUD, héberge un organisme de promotion de l’open source : l’IOSN18. Les C3LD (Centre Linux et Logiciels libres pour le Développement) de l’Agence universitaire de la Francophonie vont aussi dans ce sens.
Quelles alternatives
Le partenariat public-privé n’en est encore qu’à ses débuts. Il se développe naturellement, venant compenser le désengagement des États, États-providence comme États-paternaliste, au profit d’organisations internationales qui ne peuvent assumer leurs nouvelles responsabilités sans le renfort des « global leaders » du privé. Il s’inscrit dans la tendance néolibérale et constitue une des formes de privatisation de la coopération internationale.
Quelles sont les stratégies alternatives ? Comment, en s’appuyant sur la dynamique de la société civile, faire échec à la domination d’intérêts privés dans l’éducation ? Cette question, essentielle pour les pays en développement, concerne aussi les pays les plus développés. Ces derniers sont confrontés à la montée en force du partenariat public- privé dans la recherche, notamment dans les domaines de la médecine et de la pharmacie mais aussi dans l’éducation. Les solutions qui seront trouvées au Sud auront aussi des répercussions au Nord.
1 Voir l’ouvrage de Philippe Aigrain : Cause Commune, édition Fayard – transversales.
2 Une deuxième phase du SMSI aura lieu à Tunis en novembre 2005.
3 United Nations Institute for Training and Research, Genève.
4 Tant dans la Déclaration de principe que dans le Plan d’action, le terme de logiciel libre apparaît dans la formule suivante « Les logiciels propriétaires, les logiciels à code source ouvert et les logiciels libres ».
5 Renaud P. Internet Nord-Sud : Fossé ou Passerelle Numérique ? Tic & Développement, vol 1 – http://www.tic.ird.fr
6 Onze pays francophones sont associés à l’IAI dès sa création : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Centrafrique, Gabon, Niger, Sénégal, Tchad, Togo.
7 Du nom de Mickey Leland, ancien sénateur démocrate du Texas, engagé dans l’action humanitaire en Afrique : http://www. usaid.gov/regions/afr/leland/newbio.htm
8 Information pour le développement : http://www.infodev.org
9 Programme des Nations Unies pour le développement : http://www.undp.org
10 United States Agency for International Development (Coopération américaine).
11 http://www.undp.org/rba/ict4dev.html
12 Site de l’Université virtuelle africaine : http://www.uva.org
13 http://www.osiris.sn/article1234.html
14 Géopolitique Africaine No. 17 (hiver 2004-2005) : http://www.african-geopolitics.org/...
15 Institut des technologies de l’information dépendant de l’Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF).
16 Appui au Désenclavement numérique, projet de la France.
17 Asia-Pacific Development Information Programme, il s’agit d’un programme régional du PNUD : http://www.apdip.net
18 International Open Source Network : http://www.iosn.net
©© Vecam, article sous licence creative common
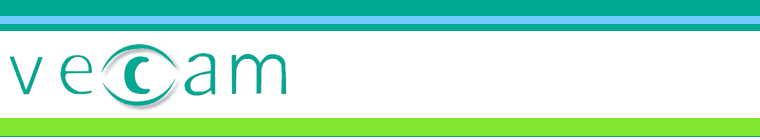

 Réflexion et propositions
Réflexion et propositions Pouvoir - Savoir (le livre)
Pouvoir - Savoir (le livre) Imprimer la page
Imprimer la page